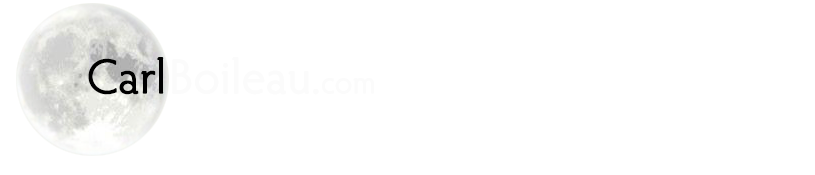Warfare : un film immersif, une mission vaine

Dans un contexte où le cinéma d’action peine à se renouveler, Warfare, réalisé par William Mendoza, propose une relecture réaliste et immersive du genre militaire en s’ancrant dans un cadre géopolitique précis : l’Irak, en pleine insurrection post-invasion américaine. Le film tente de recréer, avec un réalisme oppressant, une journée particulièrement éprouvante de la bataille de Ramadi en 2006, durant laquelle un peloton de Navy SEALs se retrouve encerclé dans un immeuble. On y reconnaît des décors désertiques, des villes détruites, des checkpoints improvisés et une tension constante entre soldats occidentaux et populations locales.
Comme l’a précisé Mendoza, cette mission ne relevait pas exclusivement des SEALs, mais s’inscrivait dans une stratégie de contre-insurrection plus large visant à reprendre progressivement les secteurs de la ville pour y établir des points d’ancrage. Ce contexte militaire, bien que fondamental, reste volontairement en arrière-plan, au profit d’une immersion à hauteur d’homme dans le chaos du terrain.
Et pour cause : Warfare est basé sur des événements réels, uniquement à partir des souvenirs directs des soldats qui y ont survécu. Mendoza cherche à recréer ce qui s’est passé avec la pureté d’un documentaire vérité, visant une vraisemblance transcendante dans le chaos sanglant et aléatoire de la guerre. Le film refuse toute surintellectualisation ou recul stratégique, pour coller à la subjectivité brute des hommes sur le terrain.
Mais ce choix narratif a ses limites. Si j’ai trouvé Warfare original et même captivant par son approche sensorielle, au ras du sol et au rythme de la peur et de l’adrénaline, j’ai aussi été contraint de faire mes propres recherches sur Internet après le visionnement pour comprendre les objectifs réels de cette mission ratée. Tellement cette question est mal expliquée dans le film qu’elle finit par créer un flou narratif frustrant. C’est comme si le réalisateur refusait délibérément de nous fournir les repères stratégiques nécessaires, afin de limiter notre perspective à celle des soldats, eux-mêmes plongés dans un brouillard opérationnel et moral.
Narrativement, le film suit une structure en trois actes : exposition tendue, escalade chaotique, puis dénouement brutal. Les combats de rue, l’explosion d’un blindé par une mine télécommandée, la confusion morale des opérations et la détresse des civils sont autant de reflets directs de cette époque. Mais au-delà de l’action, Warfare met surtout en lumière l’expérience humaine : peur, isolement, automatisme de survie. Les personnages, archétypaux mais bien interprétés, ne sont pas là pour porter un discours, mais pour incarner une situation, une impasse.
Visuellement, le film est maîtrisé. Caméra portée nerveuse, éclairage naturel, grain rugueux de l’image : on sent l’influence du cinéma documentaire. À cela s’ajoute une opposition marquée entre les scènes de terrain, oppressantes, et les directives radios du commandement, froides et cliniques, presque désincarnées. Ce contraste accentue le fossé entre la logique militaire d’état-major et la réalité des hommes sur le terrain.
Dans sa toute dernière scène, Warfare opère un changement de perspective aussi bref qu’inattendu, mais bienvenu. On y découvre le sort de la famille irakienne, jusqu’alors maintenue dans la passivité, piégée par les événements et abandonnée à elle-même. Elle finit par tout perdre. Après avoir passé tout le film rivé au point de vue des soldats américains, ce léger déplacement du regard vers les véritables victimes du conflit surprend. Ce geste discret mais chargé de sens laisse entrevoir, en toute fin de récit, une pointe éditoriale assumée. Une lucidité furtive qui rehausse l’intelligence temporelle de l’œuvre et lui évite de sombrer entièrement dans l’oubli auquel ce genre ultra-spécifique, film de guerre immersif presque en temps réel, est souvent condamné.
Au final, Warfare ne révolutionne pas le genre, mais il en propose une déclinaison brute et désenchantée. En refusant les codes du spectaculaire hollywoodien et en privilégiant une plongée viscérale dans la guerre urbaine, Mendoza capte une vérité inconfortable : celle d’une guerre sans vision claire, où les soldats avancent à tâtons dans une violence qui les dépasse. Le film ne nous apprend rien sur la guerre elle-même, si ce n’est que ses acteurs, exécutants impuissants ou victimes collatérales, y sont broyés dans l’indifférence générale. Et au bout du chaos, du sang et des pertes humaines, demeure une sensation de vide. Comme une gifle finale : Tout ça pour ça. Voilà, peut-être, la seule véritable morale de ce film.

Warfare
- -2006 pendant la Guerre d’Irak. Un peloton de Navy SEALs américains est en planque dans la maison d’une famille irakienne pour une mission dangereuse à Ramadi. Avec des snipers, les militaires surveillent tous les mouvements de « l’ennemi » dans les moindres détails mais ils ne peuvent empêcher une embuscade. Une pluie de balles va causer de graves blessures et la mission se retrouve complètement bouleversée. Tandis que les militaires mettent tout en œuvre pour sauver les blessés en attendant désespérément d’être secourus, leur situation est de plus en plus désespérée. Combien de temps pourront-ils encore tenir ?