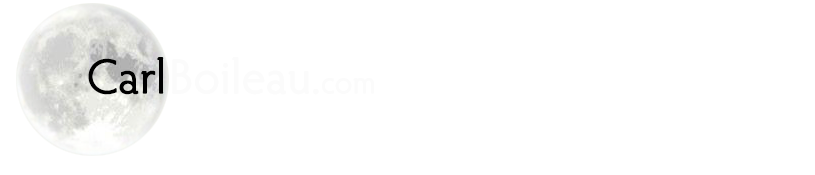Anora : la chute d’une Cendrillon moderne au cœur du rêve américain

Poursuivant son exploration de l’Amérique des laissés-pour-compte, Sean Baker signe avec Anora un film cru et lucide. Il continue de scruter le tissu social américain en s’intéressant aux marges, à ses invisibles, et plus précisément ici, à une travailleuse du sexe de Brooklyn, propulsée malgré elle dans l’univers clos d’un oligarque russe en cavale. Mais là où l’on aurait pu craindre une chronique misérabiliste ou un conte moral convenu, Anora réussit le pari d’embrasser la complexité humaine avec une tendresse farouche et une ironie douce-amère.
Lorsqu’un film décroche à la fois la Palme d’or et l’Oscar du meilleur film, je ne me pose pas de questions : je me fais un devoir de le visionner, par principe. Mais ce type de double consécration crée instantanément une attente immense, presque écrasante. Le film se retrouve investi d’un poids collectif ; les spectateurs, souvent sceptiques, veulent juger si la récompense repose sur une vraie vision artistique ou sur une posture politique. Je l’ai donc regardé, et la question que tout le monde se pose s’est imposée à moi :
Ce film méritait-il la Palme d’or ?
Le film est incontestablement bon… Mais de là à le désigner meilleur film de l’année, je demeure perplexe. Cette reconnaissance semble moins saluer l’œuvre elle-même que l’approche singulière de Sean Baker : un cinéma de terrain, sans compromis, qui donne la parole aux oubliés. On a parfois l’impression qu’à travers Anora, ce sont les années d’un travail cohérent, discret et engagé qui reçoivent enfin une validation institutionnelle.
N’étant pas familier avec la filmographie de Baker, j’ai donc découvert un cinéaste au style affirmé, désireux de bousculer les codes des récits amoureux contemporains tout en rejouant des figures classiques. Anora, au fond, c’est Cendrillon contemporain en survêtement Puma, ou encore Pretty Woman passée à la moulinette trash du réalisme social. Et cela fonctionne.
La première moitié du film est, à mon sens, la plus facile à suivre : une mise en place lente mais précise, presque chirurgicale, jusqu’à l’élément déclencheur de la fuite d’Igor. Ce long prologue faussement tranquille installe une tension sourde, nourrie par un réalisme poisseux, ponctué de fulgurances d’humanité. J’aurais aimé que cette tonalité s’étire davantage, tant elle donne au film sa respiration la plus juste.
La deuxième partie, en revanche, surprend, voire déroute. Les hommes de main de l’oligarque russe, qu’on aurait cru être des personnages secondaires de passage, deviennent soudain les figures centrales d’un vaudeville hystérique. Cette portion, longue, saturée de cris, d’énervement slave, de « fucking » en boucle, finit par user la tension dramatique. On a l’impression que le récit s’emballe et perd de sa finesse, flirtant par moments avec la répétition et la saturation.
Et pourtant, même dans ce chaos narratif, la caméra de Baker conserve une acuité rare. Elle capte sans relâche les tensions, les hésitations, les contradictions des personnages, comme s’il s’agissait d’un documentaire tourné à chaud. C’est cette proximité constante, presque intrusive, qui donne à Anora sa force d’observation, et qui rappelle que, derrière la comédie, se joue un drame social bien réel.
Anora est aussi une fresque de la comédie humaine. Je me suis même surpris à rire à plusieurs reprises, face à l’absurde des situations, au décalage constant entre les intentions des personnages et la réalité grotesque qu’ils produisent. Baker manie avec une étonnante justesse le va-et-vient entre tragédie sociale et burlesque, sans jamais sacrifier la crédibilité de ses figures.
Le personnage d’Anora, campé avec une justesse bouleversante par Mikey Madison, incarne cette Amérique écartelée entre précarité et rêves de grandeur. Les dialogues, d’un réalisme tranchant, sont portés par des comédiens parfaitement dirigés, avec un sens du rythme et une musicalité rare.
À travers ce personnage, Sean Baker met en lumière une réalité souvent évacuée du débat public : celle de la prostitution comme choix contraint dans un système économique inégalitaire. Le film ne moralise jamais, mais il dévoile la frontière floue entre autonomie et exploitation, entre désir d’ascension et marchandisation du corps. Dans une société où tout se vend, y compris les relations humaines, Anora incarne à la fois la lucidité et la fragilité de celles et ceux qui survivent en capitalisant sur leur propre image.
Cette représentation divise d’ailleurs les féministes : certaines y verront une héroïne libre, naviguant avec intelligence dans un monde masculin brutal ; d’autres y liront une banalisation dangereuse de la prostitution, reflet d’un système patriarcal où le corps des femmes demeure une ressource au service du pouvoir et du plaisir des hommes. Baker ne tranche pas, mais il met en tension ces lectures opposées, forçant le spectateur à interroger ses propres biais.
La direction artistique se distingue par son naturalisme brut : la lumière crue des clubs, la vulgarité feutrée des hôtels de luxe, la violence latente des interactions humaines… Tout dans la mise en scène évoque un monde au bord de l’implosion, une société à la dérive dont les derniers masques tombent les uns après les autres.
Reste la fin. Brutale. Déconcertante. Anora se termine en queue de poisson, sans réelle conclusion, comme si le récit refusait délibérément de clore l’histoire. Était-ce une manière de figurer le vide d’une société sans repères ? Je cherche encore à en comprendre le sens. Ce n’est pas nécessairement un défaut, mais cela laisse un goût d’inachèvement. Dans la scène finale, le rêve d’Anora est terminé : elle est revenue à la dure réalité austère de sa classe sociale.
Malgré quelques longueurs scénaristiques et une fin un brin frustrante, Sean Baker parvient à maintenir l’attention du spectateur grâce à une mise en scène nerveuse, des dialogues mordants et des séquences comiques qui frôlent parfois le burlesque. Sous ses airs de comédie, Anora n’en demeure pas moins une critique féroce des dérives d’une société où sexe, pouvoir et argent dictent les rapports humains.
En somme, Anora est une œuvre à la fois intime et politique, drôle et cruelle, traversée par une énergie brute et une sincérité rare. Elle confirme que Sean Baker est l’un des réalisateurs en vogue du cinéma contemporain, dans le sens noble et cinématographique du terme.
Palme d’or méritée ? La question reste ouverte. Mais le film, lui, mérite pleinement d’être vu — et débattu.

Anora
- -Anora, jeune travailleuse du sexe de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu’elle rencontre le fils d’un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant ; mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé : les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage…