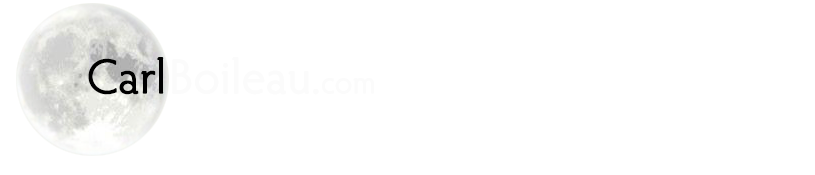The Conjuring: The Last Rites – Le chant funèbre d’une franchise mécanique

Pour comprendre la déception que suscite The Last Rites, il faut revenir à l’origine du « Conjuring universe ». Tout avait commencé en 2013 avec The Conjuring de James Wan. Ce premier film, retraçant une enquête d’Ed et Lorraine Warren, avait marqué par son ambiance tendue et sa mise en scène redoutablement efficace. Malheureusement, le succès a entraîné une prolifération de spin-off : Annabelle et ses suites, The Nun, The Curse of La Llorona, chacun centré sur des démons ou artefacts secondaires. Cette stratégie a transformé la saga en une véritable machine commerciale, diluant progressivement la qualité narrative dans une succession de produits formatés.
C’est dans ce contexte qu’arrive The Last Rites, annoncé comme une conclusion marquante, mais qui s’avère un spectacle sans relief. Je me suis vite ennuyé, incapable de retrouver l’intensité du premier film. Aujourd’hui, la formule est épuisée et la peur a disparu. Le plus ironique reste la présence de James Wan lui-même, qui fait ici un caméo totalement inutile. Loin de rappeler le souffle créatif qu’il avait su insuffler à l’origine, cette apparition se révèle plutôt malaisante. Elle souligne tristement la distance entre la vision initiale et l’usure commerciale actuelle, comme si le fantôme du créateur venait constater en silence la déchéance de son propre univers.
Le réalisateur Michael Chaves, de son côté, démontre un savoir-faire certain pour reproduire l’ambiance instaurée par Wan, mais sans son originalité. Il maîtrise la surface : les décors, les jeux d’ombre, le rythme des tensions, mais tout reste artificiel. Son travail ressemble à une pâle copie appliquée, parfaitement… mécanique. Un qualificatif qui résume non seulement la mise en scène, mais aussi le scénario, le jeu des acteurs et la logique industrielle qui broie la saga depuis trop longtemps.
La mise en scène abuse en effet des jumpscares mécaniques. Ils surviennent à intervalles prévisibles, perdant aussitôt tout effet de surprise. L’ambiance sombre, parfois bien travaillée dans certains décors, ne parvient jamais à masquer le manque de créativité. À force d’enchaîner clichés et effets faciles, la peur se dilue et laisse place à une fatigue visuelle plus qu’à une angoisse durable.
Les acteurs, quant à eux, livrent une prestation particulièrement décevante. Leur jeu si artificiel donnait constamment l’impression de sentir la caméra derrière eux. Loin d’incarner des personnages crédibles, ils deviennent des marionnettes figées, incapables de transmettre la moindre émotion authentique. Même Ed et Lorraine Warren, pourtant piliers de la franchise, semblent vidés de toute profondeur, tandis que les nouveaux venus disparaissent aussitôt qu’ils apparaissent.
Et ce terme, « mécanique », résume à lui seul l’ensemble de l’expérience. La réalisation fonctionne à la chaîne, sans âme. La recette du scénario suit un cahier des charges prévisible. Les acteurs s’exécutent comme des rouages forcés. Même la logique commerciale de l’univers, avec ses spin-off à répétition, n’est qu’une mécanique de profit, huilée pour engranger mais incapable de réellement innover.
En cours de visionnement, je me suis aussi rappelé à quel point la culture catholique omniprésente dans cette franchise m’irrite plus qu’elle ne me laisse indifférent. Voir une fois de plus des prêtres combattre des démons à coups d’eau bénite, de prières et de Bible m’a semblé stupide et caricatural. Cette opposition entre « les méchants démons » et « la bonne religion catholique » est profondément manichéenne. Elle réduit toute complexité du mal à une fable simpliste, destinée à flatter un âge mental incapable de dépasser ce niveau psychologique élémentaire. Pire encore, cette insistance finit par donner l’impression d’une propagande catholique insidieuse, où seule la foi et ses symboles offrent une issue possible pour résister et survivre aux forces du mal.
La présence des fantômes en est l’exemple parfait : inutile, artificielle, mécanique encore une fois. Le mystère, qui aurait pu se construire par la suggestion, s’évanouit aussitôt qu’ils apparaissent à l’écran. Le moment où l’on découvre leurs visages ridiculement maquillés détruit ce qui restait d’aura mystérieuse. Là où il aurait fallu du trouble, du silence, du non-dit, le film choisit le grotesque fabriqué à la chaîne. On passe de l’inquiétude diffuse à la farce involontaire, et tout ce qui aurait pu intriguer sombre dans le ridicule.
Visuellement, on retrouve bien quelques décors soignés. Ce qui fonctionne réellement, c’est l’atmosphère lugubre mais familière de ce qui est désormais considéré comme de vieilles maisons. Le film exploite cette banalité inquiétante : transformer le quotidien d’une famille lambda, issue d’un milieu ouvrier, en décor de maison hantée. Mais cette façade esthétique ne cache pas la vacuité du scénario. Même le climax, supposé offrir une apothéose, s’effondre dans la banalité. Rien ne surprend, rien ne saisit. Malheureusement, cette réussite esthétique reste superficielle et ne suffit pas à masquer l’absence de souffle créatif. Même la confrontation finale, censée boucler la boucle, tombe dans une exécution trop réglée, trop… mécanique.
En définitive, The Conjuring: The Last Rites n’est pas un désastre absolu, mais il confirme la lente décomposition d’un univers horrifique devenu produit de consommation courante. Cet univers aurait dû s’arrêter après le premier film, qui se suffisait à lui-même. En tout cas, pour moi, le « Conjuring universe » c’est bel et bien terminé.
Note critique : 2,5/5 – Un film mécanique, fatigué et inutile, conclusion d’une franchise vidée de sa substance.

Conjuring : L'Heure du jugement
- -Alors qu’ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu’ils n’auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend. Un ennemi qu’ils croyaient à jamais enfoui... Découvrez comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l’Amérique.