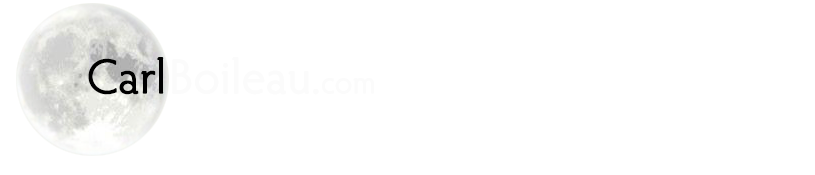Élections municipales 2025 : campagne beige, choix clair, je vote Projet Montréal

Huit ans après la prise du pouvoir de Projet Montréal, la métropole s’apprête à choisir son prochain visage politique. La campagne 2025, aussi beige qu’indécise, laisse planer un air de fatigue collective. Pourtant, au milieu de l’usure et du cynisme, un choix clair s’impose encore : celui de poursuivre la vision urbaine, démocratique et écologique amorcée il y a plus d’une décennie.
Comme à chaque élection municipale, je me permets d’y aller de mon texte préélectoral, un exercice que je poursuis plus par devoir citoyen que par esprit partisan. Ceux qui me connaissent savent que j’aime jouer cartes sur table. Cette franchise peut déranger, mais elle me ressemble : je crois profondément que la transparence, même brutale parfois, est la forme la plus honnête d’engagement politique. C’est d’ailleurs un trait qui m’a toujours défini, autant comme élu que comme citoyen.
Depuis que j’ai quitté la scène municipale, j’observe la politique montréalaise d’un œil plus distant, presque désintéressé. La ferveur des campagnes s’est estompée et, à vrai dire, peu de choses dans le débat public actuel me ramènent spontanément à l’enthousiasme des débuts de Projet Montréal.
Pour ceux qui l’ignorent, j’ai été conseiller municipal à Montréal sous la bannière de Projet Montréal, formation à laquelle j’ai contribué à ses débuts. J’y ai siégé durant les années charnières où le parti posait les bases de ce qui allait devenir la grande transition écologique et démocratique de la ville.
Et pourtant, cette année, je ne peux rester totalement indifférent. Peut-être parce que j’ai personnellement connu plusieurs des protagonistes de cette campagne : Luc Rabouin et Gilbert Thibodeau étaient des citoyens de mon district (De Lorimier) lorsque j’étais en fonction ; Craig Sauvé, un ancien collègue à Projet Montréal, travaillait alors comme attaché politique pour notre formation (concrètement le deuxième dans l’histoire du parti après Émilie Thuillier), et Soraya Martinez Ferrada, aujourd’hui cheffe d’Ensemble Montréal, fut ma cheffe de cabinet durant mon passage à Vision Montréal.
C’est sans doute cette proximité, à la fois humaine et politique, qui m’incite à reprendre la plume. Car derrière l’apparente tiédeur de cette campagne se cachent des enjeux bien réels, souvent passés sous le radar médiatique : le recentrage de la gauche municipale, l’avenir du modèle participatif, la place du français dans notre métropole et, surtout, le choix du type de leadership que Montréal souhaite pour les prochaines années.
Je sais que ma position d’électron libre risque de contraindre le partage de cet article dans les réseaux partisans; ainsi soit-il. J’assume ma démarche indépendante, qui s’avère d’ailleurs ma marque de commerce : celle d’un regard libre, souvent critique, mais toujours sincère. Car après tout, on peut aimer un parti sans lui appartenir, et reconnaître ses fautes sans renier ce qu’il a apporté à la ville.
Une campagne beige et un électorat indécis
Cette année particulièrement, la campagne est beige, sans couleur, sans souffle. On a l’impression que personne n’y croit vraiment, ni les candidats ni les électeurs. L’indifférence règne, comme si Montréal s’était résignée à la gestion plutôt qu’à la vision.
Et les chiffres le confirment. Selon un sondage Segma et Radio-Canada publié à la mi-octobre, 37 % des électeurs ne savent toujours pas pour qui voter, à deux semaines du scrutin. L’analyste politique Stéfanie Tougas résumait bien la situation : « Qui va gagner les élections ? J’ai envie de dire que ce sont les indécis. »

Le dernier sondage place Soraya Martinez Ferrada d’Ensemble Montréal en tête avec 26 % des intentions de vote, suivie de Luc Rabouin de Projet Montréal à 18 %. Un écart réel, mais fragile, dans un climat d’usure et d’indifférence.
Madame Tougas souligne que Soraya Martinez dispose d’une machine électorale efficace et du vote des propriétaires et des anglophones, tandis que Rabouin souffre d’un déficit de notoriété et hérite d’un taux d’insatisfaction de 55 pour cent envers l’administration Plante.
Bref, la campagne 2025 est à l’image de son protagoniste principal : prudente, posée, un peu trop sage. Beige, diront certains. Et c’est bien cette absence de souffle qui explique la lassitude actuelle. On parle plus de gestion que de direction, plus de prudence que de vision.
Pourquoi je voterai pour Luc Rabouin

Pour ma part, je vais voter pour Luc Rabouin à la mairie de Montréal. Non seulement parce que j’ai personnellement confiance en lui et en ses compétences d’administrateur, mais aussi parce que je veux protéger ce que Montréal a fait de mieux au cours des deux derniers mandats : un vaste réseau cyclable fonctionnel, un urbanisme repensé autour de la qualité de vie et une vision verte qui, à mon humble avis, doit absolument se poursuivre.

Au début de l’année, je reprenais ma carte de projet Montréal afin de pouvoir voter pour Luc Rabouin à la direction du parti. À cet effet, je vous invite à lire cet article qui expliquait ce choix en profondeur
Luc Rabouin, bien qu’idéologique dans son approche (comme tout membre de Projet Montréal qui se respecte), n’est toutefois pas dogmatique. C’est un profond démocrate, un homme réfléchi et à l’écoute. À mes yeux, il représente peut-être le meilleur atout démocratique que Montréal ait connu depuis longtemps. Il conjugue convictions écologiques et pragmatisme économique, sans céder ni au populisme ni à la rigidité partisane.
À quelques jours du scrutin, il semble toutefois condamné à devoir poser des gestes forts pour se démarquer et rattraper son retard apparent. Or, s’il veut véritablement rallier l’électorat montréalais, c’est du côté de la démocratie participative qu’il devrait selon moi miser : rouvrir les espaces de dialogue, redonner aux citoyens le sentiment d’avoir voix au chapitre. Ce serait le prolongement naturel de ce qu’il incarne déjà : un leadership calme, réfléchi, ancré dans l’écoute plutôt que dans la posture.
Un tel virage aurait, à mon sens, un double effet salutaire. D’abord, il permettrait de ramener vers lui une partie de l’électorat progressiste actuellement tenté par Transition Montréal, formation qui séduit par un discours de gauche plus tranché, mais dont la crédibilité municipale reste encore à démontrer. En réaffirmant la vocation participative de Projet Montréal, Rabouin pourrait réactiver la fibre militante de ceux qui regrettent l’époque fondatrice du parti, celle des quartiers verts et des assemblées citoyennes ouvertes.
Ensuite, ce recentrage démocratique lui offrirait une occasion de se distinguer clairement du dogmatisme perçu de Valérie Plante, qui a parfois confondu gouvernance participative et communication verticale. En adoptant un ton plus pragmatique, plus conciliant, Rabouin pourrait ainsi rassurer un électorat centriste et modéré, las des querelles idéologiques mais toujours attaché à une gestion responsable et visionnaire.
Bref, miser sur la démocratie participative serait à la fois un retour aux sources et un repositionnement stratégique, une façon de rassembler la gauche dispersée sans effrayer le centre, et de rappeler que la véritable modernité politique passe moins par le dogme que par le dialogue.
Enfin, et c’est un point que peu de médias abordent, Luc Rabouin est le seul des principaux candidats à ne pas être officieusement fédéraliste. Dans une ville souvent tiraillée entre ses loyautés fédérales et sa spécificité québécoise, cette position a le mérite d’être singulière. À l’inverse, Soraya Martinez Ferrada, ex ministre de Justin Trudeau, s’inscrit logiquement dans la continuité d’une vision fédéraliste, tandis que Craig Sauvé reste profondément ancré dans la culture centralisatrice, du NPD… donc de facto fédéraliste.
Sur Soraya Martinez Ferrada

J’ai connu Soraya Martinez Ferrada lorsque j’étais à Vision Montréal, elle était alors ma cheffe de cabinet. C’est une femme sympathique, rationnelle et posée, et je reconnais qu’elle représente une amélioration marquée par rapport à l’archaïque Denis Coderre, l’ancien chef de cette formation devenue Ensemble Montréal.
Je garde d’ailleurs un souvenir amusé de nos échanges. Soraya riait souvent de mes envolées revanchardes contre le NPD, à commencer par son réseau militant à l’intérieur même de Projet Montréal qui, à mes yeux, aura largement contribué à en déséquilibrer l’esprit d’origine et, ultimement, à provoquer mon départ personnel du parti. Sur ce point, nous avions trouvé un terrain de convergence inattendu. Non pas tant parce qu’elle partageait mes convictions profondes, mais parce que nous avions ici le même adversaire politique : cette frange d’apparatchiks néo-démocrates qui, sous couvert de progressisme, imposaient une logique ultra partisane à la culture municipale.

Et si certains doutent encore de la nocivité de cette influence, qu’ils en parlent à Guillaume Lavoie. Lui aussi a goûté à la médecine du réseau néo-démocrate lors de la course à la chefferie face à Valérie Plante, où les manœuvres internes et les coups tordus ont remplacé le débat d’idées. L’épisode en dit long sur la manière dont ce courant a appris à verrouiller le pouvoir plutôt qu’à le partager.
Derrière leurs grands discours vertueux, ce réseau s’est souvent révélé bien plus hypocrite et manœuvrier que ses slogans ne le laissent croire, prompt à frapper sous la ceinture dès qu’un désaccord menaçait leur contrôle du parti. Leur prétendue moralité cache mal un opportunisme redoutable, celui d’un courant prêt à tout pour préserver son influence, quitte à sacrifier le débat démocratique qu’il prétend défendre.
Soraya comprenait instinctivement mon ressentiment envers cette infiltration du réseau NPD dans les affaires locales. Elle n’y adhérait pas, et c’était là notre principal point commun. Elle voyait la politique comme un champ d’action concret, pragmatique, pas comme un espace de catéchisme idéologique.
C’est d’ailleurs ce qui la caractérise, Soraya n’est pas une idéologue. Son approche est avant tout administrative, presque technocratique, elle cherche le pouvoir par sens du devoir et de l’efficacité, non pour transformer la société. Contrairement à ce que prétendent certains militants de Projet Montréal, je ne la vois pas comme un danger réel pour démanteler le réseau cyclable ou défaire les acquis urbanistiques de l’administration actuelle. Elle ne s’inscrit pas dans une logique de rupture, mais plutôt dans une stratégie de positionnement, cherchant à rallier le vote anti Projet Montréal.

Une pancarte électorale pour le moins originale
Le problème, c’est que son parti, Ensemble Montréal, n’existe essentiellement que par réaction. Il ne porte pas de vision claire pour la ville, si ce n’est son opposition systématique à l’administration en place. Cette nébuleuse électoraliste, rassemblant d’anciens libéraux, d’ex coderristes et de nouveaux venus cherchant une bannière, manque cruellement de cohérence idéologique. Et c’est bien là le risque, celui d’un pouvoir sans projet, d’une gestion sans direction.
Sur Craig Sauvé

Il faut également parler de Craig Sauvé, le candidat surprise à la mairie de Montréal. Son initiative de créer une nouvelle formation, Transition Montréal, positionnée plus à gauche que Projet Montréal, est sans doute le fait saillant inattendu de cette campagne.
J’éprouve à son égard une forme d’ambivalence. D’un côté, je salue le courage politique que représente cette initiative, surtout dans un contexte où le débat public municipal tend à s’uniformiser. De l’autre, je crains que cette démarche ne soit le coup de dé qui fera basculer la mairie vers Soraya Martinez. Chaque voix qui se détourne de Projet Montréal pour soutenir Craig affaiblit la seule formation capable de maintenir une orientation progressiste forte à l’Hôtel de Ville.
Je dois toutefois dire, en toute honnêteté, que je respecte profondément Craig Sauvé. Même si je déteste aujourd’hui ce qu’est devenu le NPD, il a toujours été, au sein de ce réseau, l’un des plus droits et honnête envers moi. Je le crois sincère dans ses convictions progressistes, habité d’une réelle volonté d’agir pour le bien commun plutôt que par calcul. Toujours souriant, accessible, et d’un naturel désarmant, c’est probablement celui des quatre candidats avec qui vous voudriez un jour prendre une bière, ou même faire le party. Cette humanité-là, trop rare en politique, mérite d’être reconnue.
Même si Craig Sauvé semble aujourd’hui parfaitement à l’aise de se présenter enfin comme lui-même, presque libéré, en défendant des idées proches de celles du NPD, parti fédéral pour lequel il s’est d’ailleurs récemment porté candidat, il est difficile de ne pas percevoir, en filigrane, une forme de règlement de comptes personnel avec Projet Montréal. Écarté par notre ancienne formation, il a choisi de rebâtir son propre véhicule politique, Transition Montréal, un parti à son image, plus tranché sur le plan idéologique, mais aussi plus personnel dans sa démarche. Sa candidature a donc des airs de revanche douce-amère, à la fois acte de foi et affirmation d’indépendance.

La couleur orange des affiches électorales de Craig Sauvé évoque clairement la filiation idéologique avec le NPD qu’il assume désormais sans détour.
Et certains faits récents tendent à confirmer cette impression. Luc Rabouin a dû publiquement prendre ses distances avec Valérie Plante après que celle-ci a évoqué, dans une sortie pour le moins maladroite, que Craig Sauvé aurait tenté un retour dans les rangs de Projet Montréal avant de lancer sa propre candidature. Cette déclaration, inutile et désastreuse, allait directement à l’encontre des intérêts du parti, ne servant qu’à exposer les tensions internes au lieu de ramener le débat sur les enjeux de fond.
Cette sortie confirme d’ailleurs une impression que je nourris depuis longtemps : Valérie Plante ne s’est jamais réellement investie dans Projet Montréal par conviction profonde, mais plutôt par calcul politique. Elle n’a commencé à s’y impliquer qu’à la veille des élections de 2014, au moment où le parti, après des années de dur militantisme anonyme, commençait enfin à percer dans l’opinion publique. Son engagement coïncidait moins avec un élan idéologique qu’avec une fenêtre d’opportunité. Et la voir aujourd’hui quitter le navire sans égard pour la stabilité de sa succession en dit long : elle laisse derrière elle un parti affaibli, à la veille d’un scrutin crucial, comme si la continuité du projet importait moins que la gestion de sa propre image.
Officiellement, la direction du parti aurait justifié son refus de réintégrer Craig Sauvé par une position de solidarité avec les victimes d’agressions sexuelles, en lien avec une ancienne allégation le visant. Pourtant, après enquête policière et médiation indépendante, aucune accusation n’a été portée et il a été formellement blanchi.
Pour ma part, je le crois fondamentalement innocent dans cette histoire, tant je sais à quel point le milieu politique peut jouer sale quand il s’agit d’écarter un concurrent. Ceux qui ont déjà côtoyé les coulisses du pouvoir montréalais savent à quel point certaines dynamiques internes peuvent devenir toxiques, où les rivalités personnelles se déguisent en vertus publiques. Avec le recul, cette affaire ressemble bien plus à un règlement de comptes feutré qu’à une question de principe, un de ces épisodes où la morale sert souvent d’arme stratégique.
Il y a d’ailleurs quelque chose d’ironique à voir aujourd’hui une partie de la mouvance néoprogressiste se rallier avec ferveur derrière la candidature de Craig Sauvé, qu’elle érige désormais en nouvelle égérie de la gauche urbaine… lui qui fut jadis mis au ban de son propre parti pour des raisons d’image morale. À l’époque, dans le sillage du mouvement MeToo, la frontière entre justice et militantisme s’était dangereusement brouillée : il suffisait souvent d’une allégation, parfois anonyme, pour qu’une personne soit socialement condamnée avant même d’avoir été entendue. C’était l’âge d’or de la « culture d’annulation », cette dérive moralisatrice qui confondait vertu publique et lynchage symbolique, érigée en réflexe pavlovien d’une gauche radicale plus prompte à exclure qu’à comprendre. La présomption d’innocence, pourtant pilier de toute société de droit, cédait alors la place à une présomption de culpabilité, dictée par la peur du blâme et l’empressement médiatique. Et c’est bien là tout le paradoxe : ceux qui, hier, appliquaient sans nuance cette morale punitive sont aujourd’hui les premiers à lui tresser des couronnes. On l’absout, on le réhabilite, parce qu’il est redevenu utile à la cause. Un candidat plus à droite n’aurait sans doute jamais bénéficié d’une telle indulgence. Deux poids, deux mesures : les tribunaux de la vertu savent décidément se montrer cléments quand l’un des leurs se retrouve au banc des accusés.
Pour revenir à l’essentiel, sur le fond, le discours de Transition Montréal mérite d’être entendu. Il défend une vision sociale plus tranchée, plus revendicatrice, mais parallèlement aussi moins pragmatique. Le problème ici, c’est que dans le contexte actuel, ce vote de conviction risque de devenir un vote de conséquence, celui qui, par ricochet, ouvrirait la voie au retour des réseaux libéraux à la mairie de Montréal.
Sur Gilbert Thibodeau

Et puis, il y a l’outsider Gilbert Thibodeau, celui qui se rêve en joker de cette élection, mais que je considère, comme la plupart des observateurs médiatico-politiques, plutôt comme un deux de pique populiste.
J’ai connu le personnage lorsque je siégeais au conseil d’arrondissement du Plateau Mont-Royal. Il y venait à l’occasion, non pour dialoguer, mais pour se donner en spectacle. Son ton suffisant, sa morgue et son mépris de nos réponses traduisaient une incapacité totale à l’échange. Il ne discutait pas : il monologuait, s’écoutant parler comme un acteur persuadé d’interpréter le rôle du citoyen éclairé. Nous roulions des yeux, partagés entre lassitude et consternation, conscients d’assister moins à une participation démocratique qu’à un numéro d’autosatisfaction.
Il s’était particulièrement manifesté à l’époque où notre administration avait changé certains sens de circulation, notamment sur la rue Christophe Colomb, où il habitait. Il s’opposait alors farouchement à la fermeture du transit automobile, mesure qui, avec le recul, a pourtant largement bonifié la qualité de vie du secteur.
Je me permets aujourd’hui de lui poser la question : combien vaut, depuis nos mesures d’aménagement urbain, cette propriété désormais ? Assurément beaucoup plus qu’à l’époque où il nous accusait de nuire à son petit confort individualiste. Oserais-je dire qu’il est aujourd’hui virtuellement millionnaire grâce aux politiques mêmes qu’il dénonçait avec tant de vigueur ? L’ironie n’a pas de prix, mais elle, au moins, se chiffre très bien, surtout sur le marché immobilier montréalais.
Parlant d’enrichissement, je me souviens encore d’un collègue, lors d’un caucus, qui avait résumé le personnage d’une formule qui m’est restée : « Si tu achètes Thibodeau au prix qu’il vaut réellement et que tu le vends au prix qu’il pense valoir, tu deviens assurément millionnaire. La phrase, cruelle mais lucide, disait tout : le rapport de Thibodeau au monde est celui d’un homme persuadé de toujours valoir plus que ce qu’il apporte réellement.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, Thibodeau est devenu une figure familière de l’alt-right conspi québécoise. On le retrouve régulièrement invité dans les capsules web de Lux Média, cette plateforme alternative animée par l’agitateur André Pitre, véritable gourou médiatique de ce microcosme. Là, Thibodeau se prête au jeu des conversations circulaires, entre diatribes contre « les élites » et pseudo-révélations sur le « système ». Il s’y abandonne à des monologues décousus, truffés d’insinuations complotistes et de tirades revanchardes. Ces apparitions répétées, tout comme le ton pseudo-messianique qu’il y adopte, expliquent en bonne partie pourquoi il souffre aujourd’hui d’un sérieux déficit de crédibilité.
De plus, ses communiqués, manifestement rédigés par lui-même à la troisième personne, comme si un biographe imaginaire relatait les hauts faits de Monsieur Thibodeau, ajoutent au malaise. Ce ton grandiloquent, parfois presque mythomane, frôle la caricature. On y devine moins un acteur politique crédible qu’un ego en quête de reconnaissance.
Ainsi, Thibodeau joue sur un sentiment de ras le bol généralisé, surfant sur la fatigue citoyenne envers la bureaucratie municipale et les idées de gauche qu’il juge déconnectées du quotidien. Mais au delà des formules chocs et de ses vidéos Facebook aux accents de taverne politique, il n’y a pas grand chose de consistant. Son discours s’alimente du mécontentement ambiant sans jamais proposer de vision. Il prétend incarner la voix du peuple, mais ne parle que d’un vague bon sens administratif qui, dans les faits, ne veut rien dire. C’est du populisme de surface, un miroir aux frustrations.

Un message pour le moins ciblé
Thibodeau se pose en alternative à tout et à tous, mais sa posture est celle d’un homme sans cap, sans projet et, surtout, sans véritable équipe. Ce n’est pas un parti qu’il dirige, mais une troupe de figurants : des quidams manifestement ravis de voir leur visage sur un poteau, sans autre cohérence politique que l’opportunité d’exister l’espace d’une campagne.
En vérité, Thibodeau ne mène pas une croisade politique, il orchestre un numéro de visibilité. Il occupe le vide médiatique par la provocation, espérant exister le temps d’un cycle de nouvelles. Et s’il récolte quelques votes de colère, ce sera toujours au détriment de la cohérence politique, celle qu’exige nécessairement une métropole comme Montréal.
Cela dit, après son maigre 1 % récolté à la dernière campagne, il faut reconnaître que sa ténacité finit par payer. À 8 % dans le plus récent sondage, Thibodeau réussit l’exploit de dépasser Transition Montréal, et ce malgré le snobisme persistant de la classe médiatique à son égard. Il mène une campagne presque exclusivement sur les réseaux sociaux francophones, avec des moyens limités, mais un ton qui trouve écho auprès d’un électorat que les autres partis, plus à gauche, ont totalement négligé.
Comme quoi, qu’on le veuille ou non, il existe bel et bien un espace politique à droite de Soraya Martinez Ferrada à Montréal. Et Thibodeau, avec son discours de ras-le-bol et sa rhétorique de bon sens, s’y est engouffré.
À défaut d’un programme, il incarne désormais une posture populiste : celle du mécontentement organisé. Et visiblement, dans cette campagne beige où tout le monde semble craindre de déplaire, ça suffit pour faire parler de lui.
En bref, Thibodeau a parfaitement le droit d’exister politiquement. Mon problème avec lui n’est pas tant sa présence, aussi cringe soit elle, que le fait qu’un certain nombre de nationalistes désespérés voient en lui une réelle option électorale. Alors, un message à vous tous qui, comme moi, êtes souverainistes : croyez-moi, vous avez infiniment plus intérêt à voter pour Luc Rabouin que pour ce bouffon fédéraliste en manque d’attention.
Un message à mes lecteurs indépendantistes
À mes lecteurs indépendantistes habitant à Montréal, je me permets d’insister sur un point, le vote de conviction ne doit pas se confondre avec le vote de protestation. Je comprends la tentation de chercher une alternative, mais il faut regarder les choses en face, Gilbert Thibodeau, ancien candidat libéral, tente surtout de se faufiler dans les interstices laissés par les autres partis. Son positionnement opportuniste ne s’appuie ni sur une vision urbaine solide, ni sur une cohérence nationale.

Un récent sondage rappelait qu’à peine 43 % des Montréalais parlent principalement français à la maison, alors que les candidats à la mairie en évaluaient la proportion à 60 % ou plus. Cette surestimation en dit long sur la déconnexion du milieu politique avec la réalité linguistique de la métropole. Et je n’ai encore rien entendu qui laisse croire qu’ils cherchent à renverser la tendance.
Puis, il y a un autre risque, plus subtil, celui de la division du vote progressiste. Aussi sympathiques que puissent paraître certaines propositions de Transition Montréal, il faut admettre qu’un vote pour ce parti, dans le contexte actuel, équivaut objectivement à un vote pour Ensemble Montréal. En fragmentant l’électorat de gauche, on affaiblit la seule formation capable de tenir tête à la machine libérale et fédéraliste. C’est une équation simple que plusieurs préfèrent ignorer, plus Transition Montréal gagne, plus Soraya Martinez s’approche du pouvoir.
Dans un contexte où un référendum sur l’indépendance pourrait être organisé dès le prochain mandat d’un gouvernement péquiste, il faut se demander : qui voudrions-nous voir à la tête de Montréal pour dialoguer avec Québec ? Entre une mairesse fédéraliste bien enracinée dans les réseaux libéraux et un maire dont la sensibilité nationale, bien que nécessairement discrète dans le contexte montréalais, s’accorde davantage avec l’affirmation du Québec, le choix devrait être clair pour quiconque croit en l’autonomie du peuple québécois.
Soyons lucides : l’opposition nous offre trois mauvaises options. D’un côté, Thibodeau et son cri de frustration sans lendemain ; de l’autre, Transition Montréal, qui fragmente inutilement le vote progressiste ; et enfin Ensemble Montréal, le recyclage d’une vieille garde libérale qui confond encore gestion municipale et clientélisme économique.
Trois options, trois impasses : la protestation vide, la division de la gauche et le retour des gestionnaires libéraux d’une certaine époque pas si lointaine.
Face à cela, la seule voie cohérente reste celle de la continuité, celle d’un Projet Montréal qui, malgré ses imperfections, demeure le seul à porter une vision d’avenir fondée sur la cohérence, la participation et la durabilité. Montréal mérite un mandat clair, pas un geste symbolique.
Conclusion
Montréal n’a pas besoin d’un retour en arrière. Elle a besoin d’un second souffle. D’un parti qui continue à apprendre, à se corriger, à dialoguer.
En 2025, je voterai donc pour Projet Montréal, non pas parce qu’ils ont tout fait juste, mais parce qu’ils continuent d’essayer là où les autres ont renoncé. Et si je crois en Luc Rabouin, c’est parce qu’il incarne ce que la politique municipale devrait être, un exercice de patience, d’écoute et de cohérence.

Message à l’équipe de campagne de Luc Rabouin
À quelques jours du scrutin, il est impératif de s’activer. Si la tendance actuelle se maintient, Soraya Martinez Ferrada risque fort de devenir la prochaine mairesse de Montréal. Le temps n’est plus à la gestion prudente, il faut provoquer un virage stratégique clair et courageux.
Le geste le plus fort, et le plus payant politiquement, serait de négocier le retrait de Craig Sauvé de la course à la mairie en échange d’une place au comité exécutif d’un éventuel futur conseil dirigé par Luc Rabouin. Ce type d’entente, à la fois symbolique et pragmatique, unifierait les forces progressistes dispersées et transformerait le rapport de force dès le dernier droit de la campagne. Ce serait un signal fort, celui d’un leadership capable de rassembler au lieu de diviser.
En parallèle, Luc Rabouin gagnerait à organiser une conférence de presse thématique sur la démocratie participative, l’un de ses champs d’expertise historique. En s’engageant à instaurer des budgets participatifs décentralisés dans tous les arrondissements, il ramènerait au centre du discours l’ADN fondateur de Projet Montréal tout en coupant l’herbe sous le pied à Transition Montréal, qui prétend aujourd’hui occuper ce terrain.
Enfin, il pourrait tendre la main à certains adversaires en affirmant sa volonté d’un comité exécutif ouvert, incluant des élus d’Ensemble Montréal, à commencer par Soraya Martinez. Un tel geste l’imposerait comme un démocrate transpartisan, capable de gouverner au-delà des appartenances partisanes. Dans l’esprit des électeurs, c’est l’attitude d’un vrai maire, pas d’un simple chef de parti.
Et pour finir, une suggestion plus tactique : il serait avisé de s’adresser subtilement aux électeurs souverainistes, sans pour autant heurter le vote majoritairement fédéraliste de Montréal. Un engagement symbolique pour la défense du français à Montréal, ou un simple rappel que Gilbert Thibodeau fut jadis candidat libéral, pourrait suffire à tracer la ligne idéologique. Et pourquoi ne pas confier ce clin d’œil à François Limoges, l’actuel maire de Rosemont ? Après tout, un petit retour à ses racines souverainistes aurait le mérite de rallier sans diviser. Et, disons-le franchement, cela ferait sourire ceux qui se souviennent de ses jeunes années militantes dans les cercles du Parti québécois à l’UQAM. Avoue, François… tu t’en souviens aussi 😏
Bref, il reste peu de jours, mais encore du souffle. Pour Luc Rabouin, la clé est simple : transformer la division en coalition, la prudence en audace, et la continuité en véritable projet collectif.
Comme le rappelait souvent Jean Doré, maire de Montréal de 1986 à 1994, la Ville devait « ouvrir ses portes aux citoyens » et faire de la participation publique un levier central de la gouvernance municipale. Sous son administration, cette vision s’est traduite par la création d’instances consultatives et par une culture politique plus transparente, ancrée dans le dialogue civique plutôt que dans le contrôle partisan.
– Source : Archives de Montréal – Jean Doré (1944-2015), maire de Montréal de 1986 à 1994