Recentrer le débat : ma gauche n’est plus la leur

Mon coming out au centre, ou comment rester fidèle à ses idéaux quand la gauche abandonne le champ de bataille.
Ce texte n’est pas un manifeste : c’est un récit. Celui d’un ancien élu de gauche, qui raconte son cheminement politique à travers la Boussole électorale et les dérives idéologiques des dernières années.
À la veille d’un scrutin fédéral, j’y expose (probablement pour la dernière fois) mon parcours d’ancien politicien — pour expliquer pourquoi, sans renier mes idéaux, je me situe aujourd’hui au centre.
Et parce qu’on ne choisit pas un cap sans prendre acte des vents contraires, j’en profite aussi, en conclusion, pour nommer clairement ce qui alimente depuis des années mon aversion pour le wokisme.
Je vais être franc : je n’ai jamais cessé de croire aux principes fondamentaux qui m’ont guidé depuis mes premiers engagements.
Oui, j’ai évolué. Comme tout le monde. Mais ce que je constate aujourd’hui, c’est que les repères eux-mêmes ont été déplacés. Les mots ont changé de sens. Les étiquettes se sont renversées. Ce que l’on appelait jadis « gauche » au Québec ne recouvre plus les mêmes réalités. Et à la veille d’une autre élection fédérale, j’assume ce constat : Je fais mon coming out au centre. Pas parce que j’ai trahi mes convictions. Mais parce que je refuse de continuer à m’identifier à une “gauche” qui n’est plus la mienne.
Certains diront que je me suis recentré. Que j’ai dévié du chemin initial. Mais cette lecture suppose que la ligne de départ est restée stable. Or, ce n’est pas moi qui ai changé de cap — c’est le paysage politique qui s’est déplacé sous nos pieds. Pour illustrer ce déplacement, je m’appuie sur un outil bien connu des électeurs québécois : la Boussole électorale.
Proposée par Radio-Canada à chaque scrutin provincial ou fédéral, cette Boussole permet à chaque citoyen de situer son positionnement idéologique à partir des programmes des partis politiques. Il s’agit d’un questionnaire relativement bien conçu, élaboré par des politologues, qui débouche sur un graphique bidimensionnel — bien que la nature exacte des axes puisse varier d’une édition à l’autre, selon les priorités du moment… ou celles, plus implicites, de la société d’État qui l’héberge. Par exemple :
- un axe économique, de la gauche à la droite
- un axe social, du progressisme au conservatisme
- un axe identitaire, du Québec au Canada
C’est un outil imparfait, bien sûr. Et oui, je suis conscient qu’en y répondant, j’alimente une base de données sociologique gérée par une société d’État… au service du régime fédéral. On me le rappelle souvent. Mais peu importe. Car ce que ces diagnostics révèlent, au fil des années, c’est moins un changement personnel qu’un glissement collectif. Une dérive des repères. Une mutation des étiquettes.
Je fais la Boussole à chaque élection, ne serait-ce que pour prendre une photo idéologique de moi-même dans le temps. Malheureusement, je n’ai pu retrouver que mes résultats visuels de 2012 et 2014 — mais leur seule comparaison suffit à illustrer une bascule profonde du référentiel politique québécois. Et comme je n’ai jamais eu peur de me révéler, voici mes instantanés politiques.
🧭 Trois instantanés politiques – ma position selon la Boussole électorale
1er août 2012 – Gauche indépendantiste assumée
À l’été 2012, je suis encore conseiller municipal à Montréal, élu sous la bannière de Projet Montréal. Mon action s’enracine dans la démocratie participative, le verdissement des quartiers, la défense du bien commun, et la promotion active des transports actifs. Je crois profondément qu’une ville plus verte, plus équitable, plus humaine est un levier fondamental d’émancipation citoyenne.
Mais, déjà, je suis en rupture silencieuse avec la ligne de mon parti. Je sais intérieurement que je vais bientôt devoir quitter Projet Montréal pour poursuivre mon engagement en toute indépendance. Cette rupture ne date pas d’hier : elle remonte à un épisode déterminant qui s’est joué l’année précédente, en plein cœur du Plateau, dans le salon d’Amir Khadir, alors député de Mercier.
À cette époque, la direction de Projet Montréal, avec l’aval explicite de mon chef Richard Bergeron, tentait d’imposer comme candidat vedette dans une élection partielle un certain Martin Dumont, ancien bras droit de Gérald Tremblay à Union Montréal. Figure emblématique du vieux système, Dumont incarnait tout ce que nous prétendions vouloir dépasser. Ce parachutage, cette opération de « recentrement » brutale et absurde, contredisait frontalement nos valeurs fondamentales. Alors j’ai organisé une fronde. C’est chez Amir Khadir – qui nous avait accueillis avec une prudente réserve – que j’ai convoqué militants, collègues et élus pour dénoncer cette dérive stratégique et morale. Ce soir-là, la rupture avec Bergeron s’est cristallisée définitivement. J’ai payé cher ce geste : isolement, marginalisation, mise à l’écart. Mais je ne l’ai jamais regretté. Car je n’ai pas défendu un poste – j’ai défendu une cohérence.

Quelques mois après cette affaire, Martin Dumont allait faire la une à la Commission Charbonneau, révélant l’existence d’une double comptabilité au sein d’Union Montréal, des versements illégaux en liquide, et même des menaces de mort liées à l’octroi de contrats publics. En bloquant sa candidature imposée par Bergeron — au prix d’un bras de fer interne — j’ai peut-être évité à Projet Montréal un scandale futur. Mais dans ce milieu, défier l’autorité pour des raisons de cohérence morale vous classe vite parmi les « ingérables ».
L’ironie de l’histoire veut que plusieurs de ceux qui m’avaient appuyé dans cette fronde – des militants proches de Québec solidaire à l’intérieur de Projet Montréal – allaient, quelques mois plus tard, se transmuer en fervents partisans du NPD lors de la vague orange fédérale de mai 2011. Ce glissement vers le fédéralisme ne s’était d’ailleurs pas opéré sur la base d’un débat d’idées rigoureux ni d’un revirement idéologique assumé, mais plutôt comme un réflexe grégaire, une forme de cooptation naturelle dictée par le réseau militant. Une adhésion de banc de poisson, moins motivée par une conviction profonde que par un sentiment rassurant d’appartenance à la nouvelle « gauche gagnante ». Il fallait suivre le courant, faire corps avec le groupe. Face à ce réalignement soudain, ma fidélité au projet souverainiste, mon soutien au Bloc québécois et à Gilles Duceppe, paraissaient désormais poussiéreux, anachroniques – presque embarrassants. Cette campagne m’a définitivement antagonisé avec le réseau néo-démocrate actif au sein de Projet Montréal. Politiquement brûlé des deux côtés, rester indépendantiste dans un tel environnement devenait intenable.

Lire mon texte en rapport avec la vague orange : «En berne: La majorité parlementaire au Parti Conservateur du Canada»
Puis vint le Printemps érable en 2012. Et là, tout bascule. Je me sens profondément en résonance avec ce soulèvement étudiant. Je porte fièrement le carré rouge, y compris en conseil municipal, malgré les consignes de Projet Montréal qui nous sommaient de garder le silence. Je désobéis, calmement mais fermement. Le soir venu, je marche anonymement dans les manifestations, sans pancarte, sans micro, simplement un carré rouge cousu à mon veston, porteur d’une conviction partagée. Je suis pour la gratuité scolaire, contre la marchandisation du savoir, et profondément opposé au discours néolibéral et autoritaire du gouvernement Charest, dont je perçois clairement les racines : mépris de la jeunesse, confusion entre État et intérêts privés, répression déguisée en rationalité budgétaire.
👉 J’ai d’ailleurs consacré plusieurs textes à cette période, qu’on peut relire ici dans une section consacrée de mon blogue : Réflexions sur le Printemps érable. Avec le recul, ce mouvement aura malheureusement accouché d’une souris… mais il m’a redonné foi, un instant, en la possibilité d’un sursaut collectif.
C’est également durant cette période, en pleine effervescence sociale, que je rencontre Nic Payne, candidat d’Option nationale dans Mercier. Il fait du porte-à-porte, intrigué par mon appui affiché à Amir Khadir. La discussion est franche, intelligente. Il ne me convaincra pas – je voterai encore pour Amir –, mais il ébranle mes certitudes. Pour la première fois, le vernis de Québec solidaire comme « parti naturellement souverainiste » commence à se fissurer à mes yeux. Je reconnais chez Payne une clarté, une rigueur indépendantiste qui tranche avec le flou complaisant déjà perceptible chez QS. Mais Amir Khadir demeure, à ce moment-là, mon politicien favori. Il incarne toujours une gauche courageuse, critique du pouvoir, enracinée dans les luttes sociales. Sur le terrain municipal, il reste un allié précieux, fidèle et sincère – y compris durant ces heures où je me sentais politiquement le plus isolé.

avec Amir durant une manifestation nocturne durant le Printemps Érable
Je n’ai jamais fait de politique pour gravir des échelons. J’y suis entré avec l’espoir qu’on pouvait encore faire de la politique autrement, avec la naïveté peut-être de croire que la cohérence et la droiture pouvaient encore prévaloir. L’intégrité est restée mon principe cardinal – pour le meilleur… et parfois pour le pire. Parce que tenir une ligne, c’est aussi accepter de marcher seul quand les vents tournent. C’est déranger, y compris ses propres alliés qui se coordonnent selon des intérêts partisans. Je suis d’ailleurs probablement le seul colistier élu dans l’histoire municipale montréalaise à avoir volontairement cédé son siège à son chef, après avoir consacré bénévolement une année entière à organiser cette élection. Il y a des gens qui entrent en politique pour se bâtir une carrière… Moi, j’y suis entré pour défendre des idées, pour faire émerger des voix qu’on n’écoutait pas. Et pour ne jamais détourner les yeux en me regardant dans un miroir.
Ma Boussole électorale de 2012 reflète parfaitement ce positionnement idéologique :
- 86 % d’affinité avec Québec solidaire
- 85 % avec Option nationale
- 76 % avec le Parti québécois
Je suis pleinement dans l’espace indépendantiste de gauche, porté par l’écologie politique, la justice économique, la république québécoise, et une laïcité républicaine non négociable.

On remarquera l’utilisation de l’axe identitaire dans le diagramme de ma boussole électorale en 2012
5 mai 2014 – Début de la rupture
À l’automne 2012, dans la foulée du Printemps érable et au lendemain de l’élection d’un gouvernement péquiste minoritaire dirigé par Pauline Marois, je sens un souffle possible. Le mouvement souverainiste est divisé, certes, mais vivant. Je crois sincèrement que le moment est venu de sortir des querelles de clocher pour tendre des ponts.
Ma mission est claire : promouvoir la convergence indépendantiste. Tracer une ligne de ralliement entre les formations qui, malgré leurs différences, portent un rêve commun : un Québec libre, écologique, égalitaire et laïque. J’y crois. Je me sers de ma fonction élective pour trouver du temps pour militer. Et je rêve encore que la gauche puisse rassembler plutôt que diviser. C’est dans cet esprit que j’adhère pleinement à Option nationale, renouvelle ma carte de Québec solidaire, puis reprends celle du Parti québécois — celle-là même que j’avais déchirée en 2005, écoeuré par l’élection du néolibéral André Boisclair à la tête du parti. Un geste à la fois symbolique et stratégique, pour affirmer mon engagement envers une convergence souverainiste sincère et lucide.
Mais deux ans plus tard, le malaise s’installe. Militant radicalement laïc et anticlérical, je rejette catégoriquement toute réintroduction de symboles religieux dans l’espace civique. Or, Québec solidaire glisse dangereusement dans une logique intersectionnelle, où les principes universalistes sont relativisés au nom du “respect des identités culturelles”. On y brouille les repères. On y excuse le sexisme, le communautarisme religieux, la soumission des femmes, sous couvert de diversité culturelle.
Je suis stupéfait — et inquiet — de voir certains courants proches du fondamentalisme islamiste faire leur chemin dans les milieux militants. Ce n’est pas anodin : la laïcité est un principe historique de gauche, conquis de haute lutte contre les clergés. Elle s’inscrit dans une tradition universaliste et humaniste, solidaire des luttes progressistes menées à travers les époques et les continents, contre toutes les formes d’oppression dogmatique. Ce n’est ni un outil colonial, ni un privilège blanc, ni un “caprice québécois”. C’est le socle de l’émancipation. La frontière entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique doit rester nette, non seulement pour préserver la neutralité de l’État, mais pour transcender l’atavisme conservateur que représentent les religions dans les structures sociales. Car si l’humanité veut évoluer, elle devra un jour affronter lucidement ce legs archaïque et le dépasser — sans haine, mais sans compromis.
En parallèle, je porte un réel intérêt à la course à la direction d’Option nationale, dans le vide laissé par le départ de Jean-Martin Aussant. C’est dans ce contexte que mon ancien collaborateur politique, Louis-Philippe Dubois, me propose de rencontrer l’un des prétendants : Sol Zanetti. Nous nous retrouvons à trois autour d’une bière au Boudoir — ce bar du Plateau où les idéaux flottent souvent plus haut que la mousse.
Et là, le déclic se fait… à l’envers. Je le trouve moraliste, mièvre et creux. Opportuniste même. Un candidat plus préoccupé par sa carrière personnelle que par la construction d’un pays. Mon choix devient clair : je soutiens Nic Payne. Ce militant que j’avais croisé dès 2012 dans Mercier, lucide, sans langue de bois, intransigeant mais sincère. Je verse 300 $ à sa campagne, convaincu qu’il peut incarner une direction claire, sans faux-fuyants ni vernis moraliste. Mais Sol Zanetti l’emporte avec 67,4 % des voix. Et je referme doucement la parenthèse Option nationale. Encore une fois, ce n’est pas un projet d’idées qui l’emporte, mais une posture acceptable médiatiquement.
Puis, en novembre 2013, je perds mon siège de conseiller municipal. Un autre chapitre s’ouvre. Je me rapproche alors du Bloc québécois, que j’ai toujours soutenu sur le fond — même si, en tant que municipaliste, je m’étais tenu à distance. Je commence sérieusement à envisager une candidature dans Laurier–Sainte-Marie, avec en tête une nouvelle mission : venger la défaite humiliante de Gilles Duceppe face à la vague orange du NPD, et, disons-le franchement, répliquer à certains de mes anciens collègues fédéralistes de Projet Montréal, désormais inféodés au NPD.
Je veux faire campagne sur deux axes simples, mais structurants :
- refuser de prêter serment à la Reine et insuffler une logique républicaine dans le débat fédéral
- positionner le Bloc comme un pôle de convergence indépendantiste, capable de parler aux trois familles : QS, ON, PQ
Mais en juin 2014, l’élection de Mario Beaulieu à la tête du Bloc vient brutalement refroidir mes élans. Je perçois un virage sectaire, une crispation identitaire qui consacre plus d’énergie à chasser les déviants idéologiques qu’à rassembler les souverainistes de tous les horizons. Plutôt que de bâtir des ponts, on érige des murs.
Et moi, je me retrouve encore entre deux mondes : trop idéaliste pour me résigner, trop lucide pour me taire. Avec ce tournant, des fractures personnelles s’ouvrent aussi. Nic Payne, que j’avais soutenu sans réserve quelques mois plus tôt à la chefferie d’Option nationale, militait alors activement pour Beaulieu. Moi, j’étais dans l’autre camp. Celui qu’on qualifiait — non sans mépris — « d’attentistes », selon plusieurs têtes brûlées dans l’entourage militant de Beaulieu. Depuis, pour lui c’est le silence radio par rapport à moi. Indifférence totale à mes textes, aucune interaction sur ses médias sociaux. Comme si le simple fait d’avoir divergé une fois de sa ligne stratégique, plus d’une décennie plus tôt, suffisait à me rendre indigne. Mais bon… on a la qualité de ses défauts quand il est question d’intransigeance.
En 2014, malgré l’élection de Zanetti, je consomme ma rupture avec Québec solidaire et vote pour Option nationale. Un choix de clarté : pour une indépendance franche, sans compromis, sans camouflage.


Mais à ce moment, un double constat s’impose.
D’abord, je réalise que je fonctionne mal dans les formations partisanes. J’ai toujours considéré les partis comme des outils pour faire avancer des causes collectives — pas comme des regroupement sociaux où l’on cherche à se faire des amis. Ma loyauté va aux idées, pas aux réseaux. Et mon intégrité — que d’aucuns admirent à distance — devient un frein réel, parce que je m’adapte mal aux virages tactiques, surtout quand c’est ma propre formation qui dérape dans l’axe gauche-droite.
Ensuite, je prends acte de ma propre marginalité. À force de penser hors cadre, je me suis retrouvé hors-jeu. Pour le meilleur et pour le pire, je suis un électron libre — et cette liberté inquiète. Elle suscite la méfiance dans les organisations politiques, voire le mépris des esprits les plus partisans. Ma crédibilité politique frôle le zéro, malgré un sens stratégique aiguisé et une compréhension macro des enjeux. Un peu comme un cartographe qui voit les lignes bouger, mais que plus personne n’écoute.

Une excellente caricature d’Aprilus
Mars 2025 – Recentré… parce que le monde a viré
Nous sommes aujourd’hui à la veille de l’élection fédérale du 28 avril 2025, et une étrange sensation domine :
celle de devoir choisir entre une droite conservatrice sous stéroïdes, et une droite ultra-néolibérale vêtue d’un masque progressiste. Entre Pierre Poilievre et Mark Carney, le débat ne porte plus sur des visions du monde, mais sur des nuances d’allégeance au régime.

Ce texte fait suite à : Face à la vague Carney, la « gauche » québécoise choisit de se taire… ou de voter libéral] — une première charge contre le progressisme de façade.
La gauche, quant à elle, s’est effacée du cadre ou s’est fondue dans l’institution, réduite à gérer le langage plus que le réel. Dans ce contexte, plus d’une décennie après le Printemps érable, je continue — par réflexe, ou peut-être par lucidité — de répondre à la Boussole électorale. Et cette année encore, le verdict est sans appel : me voici positionné en plein centre !?! Non pas parce que j’ai changé de convictions, mais parce que le paysage a viré. Parce que le centre lui-même s’est déplacé, que les balises idéologiques ont glissé, et que ce que je portais fièrement il y a dix ans comme socle de mes valeurs de gauche — la souveraineté populaire, l’écologie radicale, la redistribution de la richesse, la laïcité, la démocratie participative — me place aujourd’hui en dehors des cadres dominants, à mi-chemin entre le silence confus de la gauche culturelle, et le vide stratégique du progressisme néolibéral.

Et en regardant autour, le constat se précise.
Gabriel Nadeau-Dubois, celui que tant voyaient comme le flambeau d’une génération, aura fini par incarner la dépolitisation tranquille du Printemps érable. Le jeune leader flamboyant est devenu politicien professionnel, promu porte-parole de Québec solidaire dans une tentative de le recentrer, de le rendre « gouvernable ». Mais à mesure que ses cheveux blanchissaient, c’est l’épuisement d’un projet qu’il portait : celui d’une gauche incapable de choisir entre le réel et la morale. Aujourd’hui, il a quitté son poste de « chef » et dit vouloir quitter la scène politique, usé prématurément, vieilli à la vitesse d’une institution, sans jamais avoir réussi à faire bouger sa base.
Quant à Sol Zanetti, qui m’avait tant déçu lors de notre première rencontre, il aura, lui, parfaitement embrassé son destin de politicien opportuniste. Après avoir sabordé Option nationale pour devenir député solidaire, il se sera recyclé avec une souplesse confondante. Tellement malléable, d’ailleurs, qu’il aura réussi un 180 degrés complet sur la question de la laïcité, allant jusqu’à devenir un adversaire zélé de la loi 21 du gouvernement caquiste. Son discours, désormais noyé dans la moraline, est devenu une sorte de catéchisme progressiste. Une figure contemporaine d’opportunisme qui s’assume — sans jamais se nommer.
Nic Payne, lui, n’aura jamais changé dans son essence. Toujours aussi franc, assumé, tranchant. Mais sa trajectoire l’aura mené vers une droite nationaliste plus affirmée. Il aura refermé sa crédibilité politique dans une posture éditoriale, en devenant chroniqueur pour Quebecor. Ce qui, en soi, lui va bien : il est là où il peut parler sans se faire censurer, dans un cadre idéologique qui ne s’excuse pas d’exister.
Et Amir Khadir, que j’ai longtemps tenu en haute estime, aura quant à lui achevé son virage qui semble le conduire au fédéralisme — un virage discret, mais désormais assumé dans les faits. Entouré des milieux militants du NPD, il aura vu sa conjointe, Nima Machouf, se présenter pour la troisième fois dans Laurier–Sainte-Marie, sous la bannière néo-démocrate. À cet effet, elle tentera encore d’y déloger le ministre libéral du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault — ancien militant de Greenpeace devenu gestionnaire docile du régime fédéraliste, et autre exemple frappant du glissement progressiste vers le centre-libéral.

Je suis bien heureux de ne pas avoir à voter dans la circonscription de Laurier Ste-Marie… et d’avoir à décider entre voter pour le Bloc ou Nima
Et que dire de Richard Bergeron ? Fondateur de Projet Montréal, il fut l’architecte du premier parti réellement progressiste à avoir conquis le pouvoir municipal à Montréal. Mais avant de devenir cette figure connue, il me doit, en partie, son entrée initiale au conseil de ville : j’étais son colistier — une stratégie que je lui avais moi-même expliquée et proposée, à l’époque où nous étions encore portés par un même idéal. C’est donc avec une certaine amertume que j’ai vu cet homme, que j’avais contribué à faire élire, abandonner son propre projet en pleine ascension, comme on quitte un navire juste avant d’atteindre le port… pour aller se rallier à Denis Coderre, l’ultime avatar du vieux système municipal qu’il avait pourtant passé sa carrière à dénoncer. Un geste d’autant plus absurde que les deux seront défaits politiquement dans la même élection, précipitant leur déchéance conjointe, comme une sorte de karma politique.

Surtout, ne soyons pas cynique
Ce revirement restera comme le symbole de son aveuglement stratégique — et, disons-le franchement, de sa bien faible intégrité. Il aura quitté son bébé, son parti, son propre projet, au moment même où il aurait pu prouver que la rupture avec le statu quo n’était pas seulement souhaitable… mais possible.
Et moi, dans tout ça ?
En 2016, alors que je travaillais comme appariteur au Centre St-Pierre, quelque chose s’est cristallisé lors d’une conférence publique. Véronique Hivon, députée du Parti québécois, y tenait des propos d’ouverture qu’on n’avait pas entendus depuis longtemps au sein de ce parti : elle parlait avec sincérité de convergence souverainiste, de dialogue avec Québec solidaire, d’alliances possibles au-delà des appareils. Ce n’était pas une simple opération de communication, mais un appel vrai, lucide, posé — comme un pont tendu entre deux rives qui s’éloignaient.
Ce soir-là, j’ai renouvelé ma carte du Parti québécois. Un geste que j’avais déjà posé une première fois en 2012, à titre de convergiste, avec l’espoir, un peu candide, de rapprocher les forces indépendantistes. Mais cette fois, mon retour ne s’inscrivait plus dans une stratégie de rassemblement à tout prix, ni dans une nostalgie quelconque. Je ne portais plus trois cartes en parallèle. Je revenais pleinement au PQ, sans ambiguïté, en toute cohérence.
Un choix devenu limpide à mesure que Québec solidaire trahissait ses propres fondements : reniant la laïcité républicaine, sabotant toute possibilité de convergence par une partisanerie crasse, et se laissant contaminer par les logiques identitaires les plus sectaires. Je n’éprouve d’ailleurs aucune pitié à les voir aujourd’hui retomber dans la marginalité — envenimés par leurs guerres intestines, prisonniers de réseaux d’activistes wokes qui n’ont jamais véritablement cru au projet de société québécois. À cet effet, leur rôle semble davantage servir les intérêts du multiculturalisme canadien : fragmenter notre société de l’intérieur et stigmatiser toute affirmation collective de l’identité québécoise.
Redevenir membre du Parti québécois, cette fois-là, c’était une fidélité retrouvée à un projet d’émancipation nationale qui, malgré les reculs et les épreuves, continuait de porter du sens à mes yeux.
Cette fidélité s’est consolidée quelques années plus tard avec l’émergence d’une figure politique nouvelle : Paul St-Pierre Plamondon. Dès ses débuts au PQ, j’ai vu en lui ce que j’attendais depuis longtemps — un renouveau sincère, un coup de jeunesse salutaire pour un parti qu’on disait à l’agonie. Je fais partie des tout premiers à lui avoir consacré un article, bien avant qu’il ne devienne une figure connue du grand public. Déjà, je percevais chez lui une parole claire, une posture intègre, un leadership sans artifice. À mes yeux, il incarne le chef le plus à gauche que le PQ ait porté depuis René Lévesque. Non pas une gauche néoprogressiste ou rhétorique comme pour les libéraux, mais une gauche républicaine, sociale-démocrate, enracinée dans l’idée d’un Québec libre, équitable et rassembleur.
Et aujourd’hui, alors que le Parti québécois renaît littéralement de ses cendres — tel un phénix — et mène les sondages en 2025 sous l’impulsion de ce chef posé, cohérent et profondément intelligent, je n’ai jamais regretté ce choix. J’y suis encore. Et je m’y reconnais plus que jamais — en phase, comme jamais auparavant, avec un chef politique.
Mais c’est précisément cette crédibilité retrouvée, cette légitimité tranquille, qui rend PSPP menaçant aux yeux de ceux qui défendent l’ordre établi. Désormais, le tir de barrage s’intensifie.
Des anciennes figures d’Option nationale aujourd’hui recyclées dans les institutions culturelles fédérales — comme Kim Lizotte ou Léa Clermont-Dion, désormais bien ancrées dans l’écosystème de Radio-Canada — au nationaliste canadien Frédéric Bérard, en passant par Émilie Nicolas, chroniqueuse fédéraliste et ex-militante du Parti libéral, l’hyper-woke Alexandre Dumas, ou encore la psychiatre militante Marie-Ève Cotton, le message est limpide : coller à PSPP l’étiquette infamante d’extrême-droite, pour mieux l’exclure du champ du dicible politique. On cherche à le « trumpiser », à l’assimiler à ce qu’il n’est pas, parce que sa montée dérange l’ordre établi.

Ce montage fallacieux porte la signature d’un ancien animateur de la défunte page diffamatoire Le Revoir. Comme quoi, ‘faire de la politique autrement’, dans le Camp du Bien, n’est décidément pas un euphémisme
Il faut lui coller une odeur de soufre — non pas parce qu’il est réellement à droite, mais parce qu’il devient crédible. Et à travers lui, c’est tout un projet d’émancipation nationale qui redevient audible — donc menaçant pour le régime fédéral. Ce n’est pas la radicalité de son propos qui dérange, mais sa modération structurée, sa légitimité tranquille, son potentiel de rassemblement populaire.
Et dans un système où la gestion des perceptions vaut davantage que le débat d’idées, il devient urgent, pour les gardiens du statu quo, de le discréditer par association toxique. Tous ces gens, qui se présentent comme la « gauche morale » de 2025, prétendent lutter contre le fascisme — Donald Trump servant d’épouvantail universel à toutes leurs croisades. Mais dans les faits, ce qu’ils défendent n’a plus rien à voir avec la gauche historique. Car la gauche véritable — celle qui s’est construite autour de la lutte des classes, des droits des travailleurs, de l’universalisme républicain, de la souveraineté populaire, de la démocratie économique, et de la nationalisation des ressources naturelles pour financer des services sociaux accessibles par un État fort et redistributif — cette gauche-là, ils l’ont abandonnée.
Ce qu’ils défendent aujourd’hui, ce sont les dogmes d’une nouvelle orthodoxie idéologique : la doxa intersectionnelle, qui postule que toutes les formes d’oppression se recoupent, et qu’il faut toujours prioriser la lecture identitaire (ethnie, genre, orientation, etc.) dans l’analyse des rapports sociaux. Cette vision absolutise les identités particulières, au détriment de toute vision commune ou collective de l’émancipation. Sur le plan politique, cette doctrine se traduit par ce qu’on pourrait nommer le néoprogressisme : un progressisme de surface, plus préoccupé par la gestion des symboles que par la transformation structurelle du réel. Et dans l’espace médiatique, cette mouvance est désormais connue sous le qualificatif de « woke » — un terme d’abord né dans les milieux afro-américains pour désigner l’éveil à l’injustice sociale, mais qui en est venu à désigner aujourd’hui une posture rigide, dogmatique, souvent moralisatrice, incapable de tolérer la nuance ou la contradiction. Dans cette logique, toute pensée qui déroge à leur grille d’analyse est immédiatement disqualifiée — non pas discutée, mais étiquetée. Ce qui n’entre pas dans la case devient automatiquement de l’« extrême droite ». Bref, pour ces nouveaux gardiens de la vertu militante, toute dissidence est suspecte, et toute voix discordante doit être réduite au silence.
Ils ne sont pas véritablement démocrates. Car la démocratie suppose un débat d’idées, un pluralisme de points de vue, une confiance dans la capacité du peuple à trancher. Or, chez eux, le peuple est suspect, surtout s’il ne pense pas comme les intellectuels urbains. La majorité devient une menace. La volonté populaire, surtout quand elle s’exprime en région, est regardée comme une antichambre du fascisme. On lui préfère la défense systématique des droits individuels de minorités définies — quitte à en oublier les droits collectifs, pourtant au cœur de toute société démocratique. Sur ce point, les néoprogressistes rejoignent d’ailleurs les néolibéraux : même individualisme forcené, même méfiance à l’égard des solidarités collectives. Ils parlent d’émancipation, mais ils reconduisent en fait la logique du capitalisme culturel : fragmentation, hyperspécialisation, marchandisation des identités. La convergence entre néolibéralisme et néoprogressisme n’est pas une anomalie : c’est une stratégie.

Ainsi, ces soi-disant souverainistes woke — sincères ou non dans leur adhésion à l’indépendance du Québec — se trouvent pris dans une telle alliance objective avec les fédéralistes qu’ils ne pourront jamais véritablement soutenir un projet national rassembleur. Je suis convaincu qu’ils refuseront systématiquement de se rallier à un éventuel comité du OUI lors d’un hypothétique prochain référendum. Ils prétexteront que le projet ne sera jamais assez progressiste à leur goût, trop nationaliste, pas assez aligné sur les dogmes multiculturalistes — bref, irrémédiablement “trop à droite” selon une grille de lecture biaisée, formatée par les réflexes moralisants de l’idéologie dominante… et calibrée, bien entendu, par les médias fédéralistes.
Ils ne combattent pas le fascisme : ils le fabriquent symboliquement, pour justifier leur rôle politique, légitimer leur posture sociale, et se vendre comme remparts indispensables contre un ennemi qu’ils gonflent à dessein. Ainsi, ceux qui prétendent incarner la gauche aujourd’hui ont surtout trouvé dans cette posture une rente symbolique et un ticket d’accès aux privilèges du système. Pour les uns, c’est un fond de commerce identitaire ; pour d’autres, une niche professionnelle ; et pour les plus calculateurs, un levier cynique pour grimper dans l’arène médiatico-politique en récitant les mantras convenus du progressisme institutionnalisé. Mais soyons lucides : ils ne sont pas les révolutionnaires qu’ils prétendent être. Ils sont les gestionnaires de la morale publique, les agents de liaison culturelle du pouvoir canadien, les douaniers idéologiques du Canada post-national.
Autrement dit : la droite. Une droite qui ne dit pas son nom, qui se drape dans les atours du Bien, mais qui se bat avec les armes les plus amorales pour préserver sa place dans les institutions dominantes. Et dans ce combat, le progressisme n’est plus un projet de société : il devient un costume de vertu, un déguisement utile, porté par celles et ceux qui défendent l’ordre établi… tout en prétendant le subvertir.

Léa Stréliski prétend incarner la gauche, mais elle sert désormais de caution morale à un ex-banquier néolibéral comme Mark Carney. Quand le wokisme devient une stratégie marketing pour blanchir le régime, il ne reste plus grand-chose de la gauche.
Vers 2017, la « nouvelle gauche » néoprogressiste aura largement contribué à discréditer l’ancienne gauche sociale-démocrate, l’écartant méthodiquement afin de monopoliser la posture morale et idéologique face à la droite conservatrice. Bien appuyé par un système médiatique complaisant, ce mouvement « woke » aura tout fait pour nous effacer des écrans radar et nous rendre politiquement inaudibles. Mais voilà : la politique agit toujours comme un balancier. Aujourd’hui, les néoprogressistes se retrouvent sur la défensive, confrontés à une droite réactionnaire galvanisée par leur propre intransigeance. Cette dynamique polarisante ouvre une brèche pour un retour du centre-gauche humaniste, antiraciste et universaliste, capable de parler sans complexes au peuple, sans tomber dans le piège tendu par les extrêmes. À mes yeux, il est évident qu’il n’y a ni compromis ni alliance à envisager, ni avec cette droite réactionnaire ni avec cette gauche dogmatique. Toutefois, dans un climat politique où ces deux pôles antagonistes s’accusent mutuellement d’extrémisme, il peut être stratégique, voire salutaire, de se revendiquer au centre : un juste milieu équilibré et rationnel qui ne cherche pas à imposer la morale, mais à retrouver le réel et le bien commun.
Alors oui, j’assume aujourd’hui de me positionner officiellement au centre. Pas par renoncement, mais parce qu’à force de glissements sémantiques et de renversements symboliques, il est devenu nécessaire de changer de case pour rester fidèle à soi-même.

Un petit dessin pour rappeler que ce n’est peut-être pas moi qui ai viré à droite… mais bien la fenêtre d’Overton qui a glissé, poussée par la dérive woke.
Dans le grand théâtre idéologique de 2025, ce que j’appelais jadis “la gauche” ne me reconnaît plus — et je ne m’y reconnais plus. Je demeure pourtant, en conscience, profondément de gauche. Pas dans le sens partisan du terme. Mais dans l’héritage politique de ceux qui ont lutté, et parfois tout risqué, pour faire progresser l’humanité.
Je crois encore, avec la même intensité qu’en 2012, à une série de principes fondateurs, profondément ancrés dans la tradition progressiste, syndicaliste et républicaine :
- la redistribution de la richesse, comme fondement d’une société plus juste ;
- le rôle social de l’État comme levier d’émancipation collective ;
- le droit des travailleurs, la dignité du travail, et la reconnaissance du rôle structurant du mouvement syndical ;
- la justice sociale et l’égalité réelle des chances — sans aucune forme de discrimination, qu’elle soit dite positive ou négative ;
- la laïcité républicaine, comme rempart contre tous les cléricalismes, quels qu’ils soient ;
- l’universalisme, qui refuse l’assignation identitaire et reconnaît chaque citoyen comme égal en droits et en devoirs ;
- l’antiracisme réel, hérité de Martin Luther King, qui rêve d’un monde où l’on juge les individus selon leur caractère et non la couleur de leur peau ;
- la primauté de la raison et de la science, face à l’obscurantisme religieux, mais aussi aux dogmes idéologiques qui prétendent aujourd’hui parler « au nom du bien » ;
- une écologie radicale, structurante, déconnectée des logiques marchandes, face au capitalisme vert et à la croissance infinie ;
- une réforme en profondeur du mode de scrutin, indispensable à toute démocratie pluraliste digne de ce nom ;
- et bien sûr, l’indépendance nationale, non comme repli identitaire, mais comme projet de souveraineté populaire et de démocratie intégrale.
Ces principes, qui faisaient de moi un homme de gauche en 2012, me situent aujourd’hui hors cadre. Non parce qu’ils ont changé. Mais parce que le monde autour d’eux a dérivé. Parce que ce qu’on appelle encore “gauche” s’est transformé en bras culturel du régime économique dominant, et que défendre l’égalité devant la loi, la laïcité, ou l’universalisme, expose désormais à se faire traiter de réactionnaire par ceux qui se disent progressistes.
Même des outils comme la Boussole électorale témoignent de ce glissement idéologique. Alors qu’on y trouvait autrefois des questions ancrées dans les grands combats de la gauche historique — droit à l’avortement, reconnaissance des droits des personnes homosexuelles, contrôle des armes à feu, opposition à la peine de mort —, on y mesure aujourd’hui le positionnement politique à partir d’enjeux identitaires propres au néoprogressisme. Ainsi, affirmer qu’il n’existe que deux sexes biologiques, questionner la médicalisation précoce des mineurs en transition, ou critiquer les politiques de discrimination positive fondées sur la religion ou des catégories raciales que la science a pourtant invalidées depuis longtemps, suffit désormais à vous faire glisser du côté droit du spectre. Pourtant, ces positions ne relèvent ni du conservatisme, ni de l’exclusion : elles s’inscrivent dans une fidélité à l’universalisme républicain, à la rigueur scientifique et à l’idéal d’égalité citoyenne devant la loi. Ironiquement, ce sont aujourd’hui les courants néoprogressistes qui ravivent la croyance dans l’existence de races humaines — une idée que la pensée progressiste du XXe siècle avait justement contribué à déconstruire.
Alors je fais mon coming out au centre. Par souci de clarté. Parce que je refuse de me définir par une étiquette qui a trahi ses propres fondements. Et parce qu’il est temps de recentrer le débat — pas pour le ramener au statu quo, mais pour le reconnecter avec le réel, le peuple, et l’idéal d’émancipation collective qui devrait en être la boussole.
Ce n’est pas moi qui ai tant changé; C’est le paysage politique qui s’est retourné. Et dans cette époque brouillée, se dire centriste peut paradoxalement devenir le dernier geste de fidélité à une gauche cohérente, populaire, et éclairée.
Alors je me positionne maintenant en plein centre de la scène politique. Non pas parce que j’ai fléchi… Mais parce qu’au cœur du courant, c’est peut-être là qu’on résiste le mieux sans dériver.
Il ne s’agit pas de changer d’idées, mais de rester fidèle à celles que les autres ont trahies
— Albert Camus
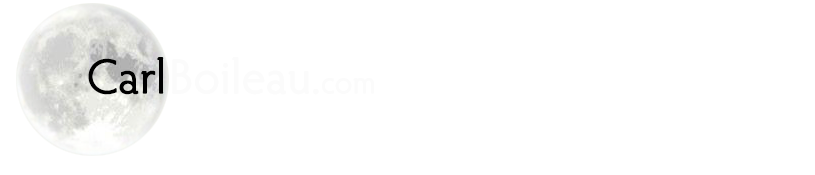




























tellement bon
Bruno, Dakar
Je trouve ce texte très enrichissant. Cela me ressemble,