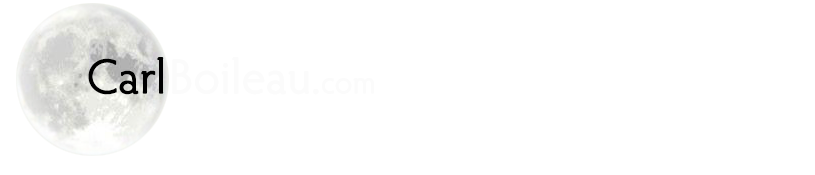La victoire éclatante du PQ dans Arthabaska sonne la fin de la récréation

Photographie tirée du groupe Facebook de mobilisation “Troisième référendum sur la souveraineté du Québec “
Depuis la défaite du OUI le 30 octobre 1995, qui m’a laissé un traumatisme durable, je n’avais jamais retrouvé de véritable espoir quant à l’indépendance du Québec. Pendant près de trente ans, malgré quelques sursauts épisodiques, je demeurais profondément pessimiste, convaincu que le rapport de force restait figé et que l’élan souverainiste appartenait désormais au passé. Tout au plus avons-nous connu quelques étincelles sans lendemain, jamais une véritable reprise du mouvement national.
Or, la dernière élection partielle dans Arthabaska change radicalement la donne. Ce qui vient de s’y produire dépasse de loin la portée d’un simple succès électoral : c’est un véritable déplacement dans la tectonique politique du Québec. Les plaques bougent enfin, et l’équilibre figé depuis 1995 commence à se fissurer. Pour la première fois en trois décennies, j’entrevois une possibilité réelle : non seulement celle de voir le Parti Québécois reprendre le pouvoir dès la prochaine élection, mais aussi, dans ce même élan, de voir s’ouvrir la fenêtre tant attendue d’une consultation populaire concrète sur notre avenir national. Et pour bien saisir la profondeur de mon optimisme, il faut regarder la trame de fond qui s’est dessinée en filigrane de cette élection partielle.

La victoire dans Arthabaska profite pleinement au PQ. Le parti souverainiste gonfle ses appuis, tandis que Paul St-Pierre Plamondon incarne plus que jamais le changement réclamé par une majorité d’électeurs, révèle un nouveau sondage Léger.
Arthabaska : plus qu’une victoire locale, un signal national
Arthabaska n’est pas une circonscription comme les autres. Ce territoire rural et francophone, au carrefour du Centre-du-Québec et des Appalaches, incarne la sociologie de base de la CAQ, cet électorat qui lui avait offert ses plus solides appuis depuis 2018. Or, c’est précisément là que son château fort vient de s’effondrer.

46,37 %, c’est la part des votes obtenus par Alex Boissonneault lors de l’élection partielle dans Arthabaska. Le candidat du Parti québécois (PQ) arrive en première position avec une avance de plus de 10 points de pourcentage sur son adversaire conservateur Éric Duhaime, qui recueille 35,01 % des voix.
Historiquement, ce n’était pas un terrain favorable au Parti Québécois. Pourtant, cette fois, le PQ a gagné en assumant pleinement son option nationale. Et c’est là toute la portée de cette victoire : si la CAQ perd son électorat naturel, et si l’indépendance parvient à séduire là où on la croyait hors-jeu, alors la dynamique politique du Québec est en train de basculer.
Des commentateurs fédéralistes peuvent bien chercher à minimiser une élection partielle, mais la réalité est brutale : la CAQ est virtuellement balayée de la carte. Non seulement elle arrive en fin de régime, mais tout indique qu’elle est en voie de disparition pure et simple, incapable de reconstruire un socle électoral stable. Contrairement au PLQ, qui survit grâce à l’appui durable de la sociologie anglophone et issue de l’immigration, la CAQ n’a plus aucun ancrage réel. Son effondrement paraît irréversible.

Mais le plus important, c’est le signal envoyé à l’ensemble du Québec : l’indépendance n’est plus un souvenir ni un slogan nostalgique. Elle redevient une option politique concrète, capable de convaincre, de mobiliser et… de gagner. Si le Parti Québécois maintient cette trajectoire, la prochaine élection générale pourrait bien marquer le début d’un véritable basculement historique.
Une fenêtre historique, mais éphémère
L’option qu’incarnait la CAQ, celle d’une autonomie provinciale supposément affranchie du carcan fédéral, s’est révélée être une utopie. En pratique, elle n’aura servi qu’à prolonger le statu quo fédéraliste au profit d’une nouvelle classe d’affairistes francophones, qui a trouvé dans un nationalisme de façade un instrument commode pour se hisser au sommet, tout en détournant l’élan collectif des Québécois vers une impasse politique.
La conséquence est claire : la CAQ a cessé d’exister comme véritable alternative aux deux options nationales antagonistes et ne représente plus une force politique crédible. Son temps est révolu. Le rôle du PQ, désormais, n’est pas de gaspiller son énergie contre un adversaire déjà condamné, mais d’adopter l’attitude de la voiture en pole position : celle qui démarre en tête, garde le cap droit vers la ligne d’arrivée et refuse de se laisser distraire par les bousculades qui agitent le peloton derrière elle.
D’autre part, la victoire d’Arthabaska survient à un moment opportun : elle donne au PQ un levier stratégique en démontrant sa capacité à convaincre même dans des terres réputées réfractaires à son discours. À un an de la prochaine élection générale, ce succès insuffle une dynamique nouvelle, attire déjà des candidats de qualité et consolide l’idée qu’un changement profond n’est plus seulement envisageable, mais bel et bien amorcé.
Québec solidaire, miné par ses divisions internes et son incapacité chronique à rejoindre les citoyens en région, n’est plus seulement essoufflé : il est désormais en décroissance. La démission de Gabriel Nadeau-Dubois illustre avec éclat l’échec du parti à passer le test de crédibilité qui aurait pu en faire une véritable alternative professionnelle et pragmatique. Le Parti conservateur du Québec, pour sa part, semble avoir atteint son plafond, cantonné à une base d’hommes de droite en colère issus de certaines régions, sans réelle capacité d’élargir son électorat. Pire encore pour lui, il agit désormais comme un repoussoir, poussant même une partie de l’électorat modéré, voire fédéraliste, à se rallier au Parti québécois en quête de stabilité et de sérieux gouvernemental. Le paysage s’oriente donc vers une opposition plus claire : un PQ nationaliste face à un PLQ replié sur sa base anglophone et allophone. Fini les mirages de la « troisième voie » incarnée par François Legault. Son pari de gouverner en escamotant la question nationale se solde par un échec : les libéraux reprennent leurs électeurs fédéralistes, tandis que les bleus reviennent en masse au Parti québécois.

Le coup de force de Paul St-Pierre Plamondon, c’est de rappeler que la question nationale n’est pas réglée et que, si nous voulons conserver la capacité de décider de notre destin collectif, il faut l’affronter dès maintenant. Et cette tendance ne se limite pas à une impression ou à une victoire ponctuelle. Les chiffres du dernier sondage Léger sont parlants : 61 % des électeurs appuient des partis nationalistes ou indépendantistes, contre un maigre 26 % pour le parti d’intérêts du Canada anglais. Plus encore, 71 % des intentions de vote vont à des formations dirigées par des chefs issus de la famille souverainiste. Cela confirme que le rapport de force est en train de basculer en profondeur. À cette reconfiguration s’ajoute un facteur déterminant : l’appui massif des jeunes. Selon la firme de sondage CROP, 44 % des Québécois appuient le OUI, et 56 % chez les 18-34 ans.
Mais cet élan n’est pas éternel. Chaque année, des milliers de nouveaux électeurs, souvent issus d’un parcours d’anglicisation, se rangent dans le camp du NON. Ottawa l’a bien compris et instrumentalise l’immigration comme un levier politique : non seulement pour accroître artificiellement l’assise démocratique du Canada au Québec, mais aussi pour accélérer notre assimilation. Depuis le début de la Confédération, l’immigration est utilisée comme un axe de colonisation par le Canada anglais, une stratégie constante visant à réduire le poids démographique des Québécois francophones et, ultimement, à effacer notre existence nationale.
D’ailleurs, une certaine gauche cryptofédéraliste, imprégnée de wokisme et arrimée au NPD, persiste à nier cette réalité coloniale. En refusant de voir l’évidence, elle devient complice de notre assimilation. Il faut le dire clairement : le NPD agit déjà comme un acteur du camp du NON, en travaillant à délégitimer l’existence nationale des Québécois. Sa stratégie repose sur la stigmatisation morale, en accusant de racisme toute affirmation identitaire hors du cadre canadien, alors que le véritable État colonial demeure le Canada lui-même, qui orchestre méthodiquement notre marginalisation démographique et culturelle.

Le NPD n’est pas une réelle alternative progressiste pour le Québec, mais l’aile morale du colonialisme canadien.
Comme le rappelle Joseph Facal, la fenêtre de tir est courte : cinq ans tout au plus. Et il faut le dire sans détour : refuser de saisir cette fenêtre, c’est accepter qu’à terme, le peuple québécois soit absorbé par le cadre canadien et, avec lui, par l’ensemble anglo-saxon. C’est s’engager sur une pente irréversible où chaque recul démographique accélère la disparition de notre identité.
C’est pourquoi il faut se préparer dès maintenant. L’organisation doit recenser les forces du OUI, cibler les indécis, neutraliser les relais fédéralistes et bâtir une campagne prête à affronter l’appareil fédéral. Car au bout du compte, le choix est simple : devenir un pays… ou disparaître lentement, mais sûrement, dans le Canada.
L’appel du pays
À la lumière de tout ce qui précède, j’ai pris une décision : mon blogue entre dès aujourd’hui en mode pré-référendaire pour le OUI. Mes prochains textes auront essentiellement pour fil conducteur un objectif principal : préparer le terrain du prochain référendum et contribuer, à ma mesure, à la victoire de l’indépendance.
Dans la perspective probable d’un retour du Parti Québécois au pouvoir majoritaire, il faut bien comprendre que nous faisons face à une occasion historique… peut-être la dernière. C’est pour cette raison que je me sens interpellé au plus profond de moi-même. Non seulement je veux m’investir localement dans mon quartier Rosemont, cette circonscription clé au cœur du Montréal francophone, mais je suis prêt à aller plus loin : prendre un congé sabbatique pour me consacrer entièrement à cette élection. Parce que si nous voulons un Québec libre, il ne suffit plus d’y croire, il faut agir, dès maintenant, sur le terrain.
La victoire d’Arthabaska bouleverse même ma stabilité professionnelle. Le champ des possibles qui s’ouvre politiquement me rappelle l’appel de l’implication et la responsabilité de ne pas demeurer spectateur. Je veux faire partie de ceux qui vont faire la différence, et cela commence maintenant. Moi qui croyais en avoir fini avec la politique active, je me surprends à envisager de mettre en pause mes activités en horticulture et en enseignement pour me consacrer entièrement à ce combat : gagner notre pays.
Je n’ose même pas imaginer la libération et le sentiment d’accomplissement qui m’habiteront si nous remportons notre indépendance. Je pourrai alors ressentir le devoir accompli, me consacrer au reste de ma vie à des projets personnels… et mourir en paix.

En plus, je suis totalement en phase avec notre chef, Paul St-Pierre Plamondon. J’éprouve même une certaine fierté d’avoir appuyé ses idées et son intégrité dès ses tout débuts au PQ, alors qu’il était encore considéré comme un outsider au sein du Parti. Aujourd’hui, il incarne ce renouveau sobre, déterminé et rassembleur dont notre mouvement avait cruellement besoin.
Cette victoire d’Arthabaska est bien plus qu’un résultat électoral. C’est un signal envoyé à tous les souverainistes, anciens militants comme nouveaux convaincus : la récréation est terminée. C’est le moment de nous relever, d’unir nos forces et de préparer minutieusement le chemin vers notre indépendance.
Si nous réussissons, nous pourrons enfin offrir à nos enfants un Québec maître de ses choix, fier de sa langue et pleinement reconnu parmi les nations, affirmant sa présence au monde aux côtés des autres pays indépendants à l’ONU. Mais si nous échouons cette fois, il n’y aura sans doute pas de seconde chance : le rouleau compresseur démographique et politique du Canada aura fait son œuvre, et l’indépendance pourrait s’éloigner pour une génération… voire disparaître à jamais.
Alors, pour moi comme pour vous, il n’y a plus de place à l’hésitation. Mon blogue, comme mon engagement personnel, s’aligne sur cette urgence. C’est maintenant… ou jamais.
Il est un temps où le courage et l’audace tranquilles deviennent pour un peuple, aux moments clés de son existence, la seule forme de prudence convenable
– René Lévesque