Montréal, ville piège ? Quand un virage à gauche devient un traquenard

Il y a quelques jours, j’ai reçu une contravention pour avoir effectué un virage à gauche à l’intersection des rues Molson et du boulevard Saint-Joseph, dans Rosemont. Un secteur que je fréquente presque quotidiennement depuis cinq ans. Ce coin fait partie de mon itinéraire régulier, chaque soir vers 17h30, pour retourner chez moi après le travail.
Mais cette fois, sans le savoir, j’ai été pris dans un piège.
La faute ? Une pancarte temporaire interdisant le virage à gauche, récemment installée, peu visible… et surtout absente des données de Google Android Auto, qui continue d’indiquer que le virage est autorisé. Comme des milliers d’automobilistes, je fais confiance à mon GPS, surtout lorsqu’aucune signalisation claire ne contredit ses indications.

Nos GPS indiquent que le tournant à gauche est toujours l’itinéraire à suivre à travers l’intersection en question
Une signalisation douteuse… et un chantier fantôme
Je dois avouer que je n’avais probablement pas remarqué cette petite pancarte amovible lors de mes premiers passages, quand ce nouvel et énième chantier a surgi sur mon itinéraire il y a quelques semaines. Elle est si discrète qu’elle se fond dans un décor déjà saturé de cônes, d’éléments liés au chantier, de panneaux temporaires et d’informations chaotiques.
Puis un jour, je l’ai finalement aperçu. Le panneau portatif était bancal, légèrement incliné, comme s’il avait été bousculé ou déplacé. Placé sans rigueur ni alignement clair, il donnait presque l’impression d’avoir été oublié là par les ouvriers, comme un vestige d’un chantier terminé ou suspendu. Et son message restait ambigu : visait-il ma voie ou celle en sens inverse ? Rien n’était vraiment clair.
Dans le doute, j’ai alors évité de tourner à gauche à l’intersection concernée. Mais au fil de mes différents passages, j’ai constaté que la majorité des voitures dans ma voie continuaient de tourner sans problème. Aucune contrainte physique. Aucun agent. Et surtout, aucun signe d’un chantier actif ou d’un quelconque danger.
J’en suis donc venu, comme tant d’autres, à reprendre mon habitude et à tourner à gauche à cet endroit à plusieurs reprises… jusqu’à la semaine dernière, où j’ai été intercepté.
La mécanique bien huilée d’un piège réglementaire
La constable M. Lemay (matricule 4134, de l’unité 144) m’a donc intercepté ce jour-là à 17 h 30, le 5 juillet 2025, pour m’émettre une contravention de 186 $. Motif : ne pas m’être conformé à la signalisation de virage à gauche interdit. Une infraction inscrite au Code de la sécurité routière, article 310, codification P278.
Lorsque je lui ai montré que mon GPS indiquait toujours que le virage était autorisé, la constable a simplement haussé les épaules. Un petit geste banal… mais révélateur. Elle savait pertinemment que nos GPS continuent de nous diriger vers ce virage, comme ils l’ont toujours fait. Elle savait que les automobilistes ne peuvent pas raisonnablement deviner que le virage est désormais interdit. Et que des dizaines de conducteurs se font piéger chaque jour.
Pendant qu’elle validait mon permis de conduire, deux autres voitures effectuaient exactement le même virage fautif, juste à côté de nous, sans provoquer la moindre réaction des deux jeunes policières. Comme si un seul « client » à la fois suffisait.
C’est à ce moment-là, au moment où elle m’a tendu la contravention, que je lui ai posé la question : pourquoi ce virage est-il désormais interdit ? Elle m’a répondu, d’un ton automatique, que la mesure avait été mise en place pour protéger les ouvriers travaillant sur le chantier de construction. Une réponse convenue, récitée sans détour. Un argument qui peut sembler valable… en théorie.
Mais en trois mois, je n’ai jamais vu un seul ouvrier sur place. Aucun chantier actif. Aucun véhicule de construction. Rien, sinon quelques cônes et cette petite pancarte vissée discrètement sur un poteau portatif, dans un décor déjà saturé. On est donc en droit de se demander : protéger qui, au juste ?
Une routine bien documentée
Depuis cette contravention, j’ai continué à emprunter mon itinéraire habituel jusqu’à cette intersection, mais avec un nouvel objectif : documenter la situation à l’aide de ma dashcam. Et à chacun de mes passages, je vois habituellement des véhicules tourner à gauche, comme si de rien n’était. Ce comportement est constant, répété, presque banal.
Et ce n’est pas de la rébellion : c’est simplement que personne ne comprend vraiment que ce virage est interdit. La signalisation est trop discrète, mal positionnée, et confuse. Dans un tel flou, les conducteurs ne désobéissent pas : ils suivent ce qu’ils croient être la règle. Le problème ne vient pas d’eux, mais du message qu’on leur envoie… ou plutôt, qu’on ne leur envoie pas.
Cela prouve une chose : l’interdiction n’est pas comprise. Et pourtant, une escouade du poste de quartier 44 s’installe régulièrement à proximité, en embuscade, prête à intercepter.
Tout cela ressemble moins à une mesure de sécurité publique qu’à un piège parfaitement rodé.
Une mise en scène répétée… filmée en plein jour
Aujourd’hui même, j’y suis retourné à pied pour filmer une séquence complète. Ce que la vidéo révèle est sans équivoque : pendant qu’un automobiliste se fait intercepter, plusieurs autres véhicules fautifs tournent à gauche juste devant les policiers… sans provoquer la moindre réaction.
Et une fois le constat remis, la voiture de patrouille rebrousse chemin à contresens, croise deux autres véhicules fautifs, toujours sans intervenir. Comme si un quota venait d’être atteint. Ou comme si le reste n’avait plus d’importance avant l’heure du dîner (il était alors midi tapant).
Un chantier abstrait, figé dans le temps
Soyons justes : le chantier est visible en surface, par la présence de quelques cônes et panneaux. Mais il est totalement inerte. Il n’y a ni ouvrier, ni machinerie. On dirait un décor de théâtre, mis en place pour cocher une case administrative. Il semble conçu pour s’étirer dans le temps, lentement, sans véritable urgence, sans coordination visible.
C’est un autre sujet, j’en conviens, mais qui reste profondément symptomatique des problèmes structurels de notre société publique : lenteur, désorganisation, absence de résultats concrets… et pourtant, des règles strictes imposées aux citoyens.
Et si vraiment le but était de protéger des travailleurs, pourquoi ne pas affecter un agent de circulation ou un cadet ? Pourquoi ne pas mettre à jour les données GPS, comme le ferait n’importe quelle administration responsable ?
La réponse semble évidente : ce flou est entretenu volontairement. Ce n’est pas une mesure de sécurité. C’est une opération de prélèvement silencieux dans les poches des citoyens.
Montréal, ville intelligente… vraiment ?
Quand la Ville installe un panneau portatif bancal, ne synchronise pas ses données avec les GPS, n’informe pas les automobilistes, ne déploie aucun encadrement humain, mais maintient une patrouille d’interception discrète, ce n’est plus de la sécurité publique.
C’est du guet-apens organisé. Et ça mine la confiance. Profondément.
Ce que je demande
Je ne cherche pas simplement à contester mon constat. Je veux que cette logique soit exposée et corrigée.
Voici ce que je réclame :
- Que la Ville justifie publiquement cette interdiction, en l’absence de tout chantier actif sur le terrain.
- Que le SPVM rende publiques les données sur le nombre de contraventions émises à cette intersection depuis l’apparition du panneau.
- Que la signalisation temporaire soit synchronisée avec les GPS les plus utilisés, afin d’éviter d’induire les conducteurs en erreur.
- Et que ma contravention soit annulée, puisqu’elle repose sur une signalisation ambigüe, non communiquée, et appliquée de manière arbitraire.
Un appel aux journalistes… et au commandant du poste 44
J’invite expressément les journalistes à se pencher sur cette situation.
Je suis prêt à partager mes vidéos, mes photos et mes observations. Je les invite même à venir filmer eux-mêmes sur place. Ce qu’ils verront, c’est une opération policière qui ne protège rien, ne prévient rien, et qui intercepte arbitrairement certains conducteurs… sans logique apparente.
Mais surtout, je les invite à poser une question simple au commandant François Labrecque, responsable du poste 44 :
Pourquoi maintenir une interdiction temporaire mal visible, non communiquée aux systèmes de navigation, dans un secteur sans chantier actif, tout en installant une patrouille d’interception pour distribuer un seul ticket à la fois ?
Cette opération est irresponsable. Elle alimente le cynisme envers les forces policières, et affaiblit la légitimité de leur rôle pourtant essentiel dans notre société. Car la sécurité publique repose sur la confiance, pas sur la confusion organisée. Puis quand l’État crée volontairement les conditions d’une infraction pour ensuite punir ceux qui tombent dans le piège, il ne protège plus : il prélève.
📍 À lire aussi — Quand la signalisation devient un piège silencieux
Et ce que je vis à Montréal n’est pas un cas isolé.
À Trois-Rivières, plusieurs automobilistes ont récemment eu la mauvaise surprise de recevoir des contraventions de 346 $, 520 $, voire jusqu’à 806 $ après avoir roulé sur le pont Laviolette, où un radar photo mobile a été installé sans grande publicité. Officiellement, la vitesse est abaissée à 70 km/h en raison de travaux. Mais ces travaux sont invisibles de jour, sans présence de travailleurs, ni machinerie en activité.
Même constat : un décor figé, un prétexte administratif, et des amendes bien réelles. Ce sont les mêmes symptômes : signalisation floue, application aveugle, absence de communication… et une logique punitive sous couvert de sécurité publique. On transforme des zones transitoires en véritables trappes à contraventions.
En conclusion : à qui profite vraiment le système ?
On aime nous rappeler que la devise des corps policiers est noble : « Protéger et servir ». Mais lorsqu’on observe la réalité sur le terrain, la question devient inévitable : protéger qui, et servir quoi ?
Dans ce cas-ci, j’ai littéralement eu l’impression de m’être fait extorqué une journée de salaire. Ni pour protéger des ouvriers, ni pour assurer la sécurité publique. Mais pour alimenter un système qui fonctionne comme une machine bien huilée : en exploitant une faille qu’on refuse sciemment de corriger.
Et ça mérite d’être dénoncé.
D’autant plus que ce même système s’enrobe de valeurs exemplaires, qu’il affiche fièrement sur son site officiel : Respect. Intégrité. Engagement. Des mots qui, selon le site du SPVM, devraient guider le comportement de chaque agent :
- Le respect : agir avec considération et dignité envers les autres.
- L’intégrité : exercer sa profession avec honnêteté et équité.
- L’engagement : se sentir concerné par les problématiques du terrain et contribuer à leur résolution.
Des principes magnifiques… en théorie. Mais sur le terrain, rue Molson, rien de tout cela ne semble avoir été appliqué :
– aucun souci de clarté dans la signalisation ;
– aucune équité dans l’application de la règle ;
– aucun effort pour corriger une confusion que même les GPS entretiennent.
Agir avec intégrité, ce serait refuser de tirer profit d’une incohérence.
Agir avec respect, ce serait ne pas piéger les citoyens.
Agir avec engagement, ce serait écouter, adapter, corriger.
Alors oui, je contesterai individuellement cette contravention.
Mais collectivement, je dénonce une dérive plus vaste : celle d’un système qui parle de sécurité tout en s’appuyant sur la confusion. D’un appareil qui confond ordre public et stratégie de perception. Et qui, parfois, derrière ses uniformes et ses sourires polis, semble avoir perdu de vue la signification même des principes qu’il prétend incarner.
Une dérive symptomatique d’un glissement social
Ce n’est pas qu’une simple histoire de contravention ou de panneau mal placé. C’est le révélateur d’un glissement plus profond : une société où la forme l’emporte sur le fond, où l’obéissance à la règle vaut davantage que la raison de cette règle. Lorsqu’un pouvoir entretient sciemment des zones d’ambiguïté pour mieux sanctionner, il ne gouverne plus ; il dresse des pièges.
Si cette logique se généralise, la confiance cède la place à la méfiance. On ne cherche plus à prévenir, mais à prendre en faute ; la pédagogie s’efface derrière la punition ; la « sécurité publique » devient prétexte à un prélèvement automatisé. L’administration n’éduque plus, elle guette. Elle n’encadre plus, elle surprend.
Au bout du compte, ce n’est pas seulement un carrefour qui se transforme en traquenard ; c’est toute la relation entre l’État et les citoyens qui se fissure. Car comment exiger le respect des règles lorsque ceux qui les appliquent les instrumentalisent ? Cette dérive, discrète mais corrosive, ronge la démocratie, délite le lien social et banalise un cynisme où l’on se méfie des intentions pour ne voir que les procédés.
Il reste encore du temps pour agir. Mais cela exige un sursaut collectif : regarder ces micro-injustices pour ce qu’elles sont vraiment — les symptômes d’un malaise plus vaste qu’il faut avoir le courage de nommer, puis de corriger.
En des temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire
– George Orwell
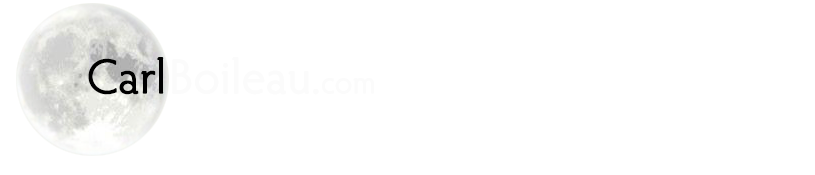


























Bonjour Juan,
J’attends toujours ma convocation…
Merci pour l’intérêt
Bonjour M. Boileau, est ce que vous avez eu finalement était acquitté de cette injuste amende?