L’écho du Mile End, 38 ans plus tard

Devant l’école Saint-Enfant-Jésus, 38 ans plus tard. Assis sur le nom de notre école comme jadis sur les bancs de la cour, deux amis d’enfance se retrouvent là où tout avait commencé.
Il y a quelques jours, j’ai revu Jorge Simões, mon premier meilleur ami d’enfance. Dire que ce moment relevait du miracle n’est pas exagéré. Bien que nous nous soyons retrouvés virtuellement via Facebook il y a une quinzaine d’années, nos échanges étaient restés sporadiques, et rien ne laissait présager que nous allions un jour nous revoir en chair et en os. D’autant plus que, depuis son départ vers le Portugal en 1987, Jorge n’avait jamais remis les pieds au Québec.
Le Mile End des années 80 n’avait rien du quartier branché d’aujourd’hui. C’était un secteur modeste, largement ouvrier, habité majoritairement par des familles venues d’ailleurs, mais aussi par des Québécois de souche issus de la même condition. Le quartier vibrait au rythme des langues et des cultures qui s’y entrecroisaient. La communauté portugaise y tenait une place de choix: cafés, boucheries, clubs sociaux et restaurants jalonnaient les artères, donnant au quotidien ses parfums et ses sonorités familières. Les fins de semaine, les fêtes de quartier faisaient vibrer la musique, pendant que l’odeur du poulet grillé ou du chouriço s’échappait des petits restaurants familiaux.
À l’école élémentaire Saint-Enfant-Jésus, où Jorge et moi avons grandi côte à côte, la cour rassemblait une véritable mosaïque sociale et culturelle: enfants portugais, grecs, italiens, juifs et québécois francophones partageaient la même simplicité de vie, et souvent la même précarité, que leurs parents travailleurs.

Dans la cour d’école de St-Enfant-Jésus durant l’Halloween 1986. De gauche à droite en haut : Donald, Daniel, Tony, Christian,. Puis en bas : moi tenant ma soeur, Stéphanos puis finalement Jorge
Dans la cour, nous étions inséparables. Jorge, né à Montréal de parents portugais, était mon frère de jeu, mon complice de chaque jour. Entre la première et la sixième année, nous figurions toujours parmi les plus petits de nos classes respectives. Cette condition nous plaçait presque automatiquement côte à côte, au premier rang lorsque venait le moment d’entrer en file, comme deux frères miniatures affrontant le monde à la même hauteur. Mais c’est surtout sur le terrain de soccer que se jouait notre complicité. Le ballon roulait sans relâche sur l’asphalte, aimantant tous les garçons de l’école, et chaque récréation devenait un match improvisé où l’intensité n’avait rien à envier aux plus grands stades. Le soccer était notre langage commun, la scène où s’exprimaient nos rêves d’enfants.

Dans la cour de l’école Saint-Enfant-Jésus, le soccer était bien plus qu’un jeu: il était notre langue commune, entre cris d’enfants et rêves éveillés. C’est de là qu’est né mon texte La Coupe du monde et moi, où je retrace ce premier contact avec la ferveur du ballon rond.
Puis, à la fin de ma sixième année, à l’été 1987, sa famille est repartie vivre au Portugal. L’amitié s’est brisée net, emportée par l’océan. Mais ce départ n’a pas seulement marqué la fin d’une complicité: il a scellé pour moi la perte forcée de mon enfance. Cet âge d’or, lumineux et insouciant, s’est refermé brutalement, me projetant vers l’adolescence, une période plus trouble, marquée par les tiraillements et les malaises, que je garde encore comme la plus difficile de ma vie. À la même époque, mes études secondaires m’orientaient vers PGL, dans la ville alors indépendante d’Outremont. C’est là que je pris conscience, presque malgré moi, de l’existence des classes sociales, tant le contraste entre ce milieu aisé et mon Plateau d’origine était frappant. Ce fut un apprentissage douloureux, une autre manière de mesurer la distance qui s’était installée entre ce que j’avais été et ce que je devenais.
Avec le recul, je me demande aussi si ce deuil d’amitié avec Jorge n’a pas laissé en moi une cicatrice plus profonde que je ne l’avais cru. Peut-être explique-t-il pourquoi, par la suite, j’ai souvent été si mauvais pour entretenir des amitiés profondes. Comme si, après ce premier arrachement, une part de moi s’était résignée à l’idée que tout lien, tôt ou tard, finit par se briser.

Jorge et moi et 2e année, durant le fête de l’amitié
Et c’est sans doute pour cette raison que les retrouvailles inespérées avec Jorge ont eu une telle intensité. Contre toute attente, nos chemins se sont recroisés récemment dans le Mile End, au parc Lahaie, juste en face de l’église Saint-Enfant-Jésus, cette paroisse qui avait vu naître notre complicité. Cette fois, Jorge n’était pas seul: il était accompagné de sa femme et de sa fille de dix-sept ans, comme pour ancrer nos retrouvailles dans le présent autant que dans le passé. La reconnaissance a été immédiate: deux jeunes cinquanténaires se souriant sans hésiter, retrouvant la même étincelle au fond des yeux. J’ai été ému de l’entendre parler un français encore limpide, comme si cette langue partagée de notre enfance n’avait jamais cessé de vivre en lui. En l’accueillant là, je lui ai montré la nouvelle fontaine qui met désormais en valeur la façade de l’église. Une certaine fierté m’a traversé l’esprit: j’avais fait partie de l’équipe municipale qui avait orchestré ce réaménagement, à commencer par la fermeture de la rue Saint-Dominique aux voitures pour redonner aux passants et aux fidèles un parvis digne de ce nom.

Pour Jorge, ce lieu résonnait d’une intimité profonde: il y avait fait sa première communion, comme tant d’enfants d’origine portugaise de notre école, et les cloches de Saint-Enfant-Jésus semblaient encore lui murmurer l’écho de son enfance spirituelle. Pour moi, qui n’ai jamais été baptisé, ces pierres portaient une autre charge: non pas celle de la foi, mais celle de la mémoire. Elles m’ancrent dans le quartier, dans son histoire, et surtout dans cette amitié originale qui continue de me relier, presque spirituellement, à Jorge.
Après ces premiers instants au parc, nous avons marché jusqu’à la cour de l’école Saint-Enfant-Jésus, le lieu fondateur de notre amitié. Ni lui ni moi n’y avions remis les pieds depuis la fin du primaire, et franchir à nouveau ce seuil ensemble avait quelque chose de vertigineux. Je me suis alors demandé combien de fois, enfants, nous avions traversé cette porte côte à côte, celle de la cour arrière, tout près du mur où nous jouions à la balle ensemble. L’espace, que nous croyions immense, semblait rétréci, mais nos souvenirs l’élargissaient aussitôt: le bruit des cloches, les cris des récréations, la poussière soulevée par nos souliers.

De retour au même endroit 40 ans plus tard : Une photo du passé… Un regard vers le futur
Nous avons pris le temps de parcourir la cour, lentement, presque religieusement, comme si chaque recoin avait conservé une trace de nous-mêmes. À mesure que nos pas nous guidaient, les lieux semblaient nous restituer ce que le temps avait voulu effacer: ici le terrain vibrait encore du souvenir de nos interminables parties de soccer, ce jeu roi qui, pour les garçons, dominait tout et rythmait chaque récréation comme une coupe du monde miniature; là résonnaient encore les échos du ballon chasseur et du quatre coins. Et, contre ce mur, la chance, ce jeu de balle qui n’appartenait qu’à nous, retrouvait toute sa charge de complicité et de défi. C’était comme si les souvenirs, accrochés à l’espace, se rallumaient d’eux-mêmes dès que nous les effleurions du regard.

Devant le mur de notre vieille école, Jorge arbore son nouveau maillot rouge, cadeau de ses 50 ans. Lui qui, jadis, partageait avec moi la rivalité Nordiques-Canadiens, a depuis tourné la page du hockey pour porter désormais les couleurs du Benfica de Lisbonne. Le deuil du Canadien consommé, sa ferveur sportive s’est déplacée vers le soccer — rouge sur rouge, comme un fil reliant Montréal à Lisbonne, l’enfance à l’âge adulte.
Très vite, une autre mémoire s’est invitée: celle des conversations d’enfants. Avec Fred Poulin, arrivé de Québec en quatrième année et qui m’est depuis resté un ami précieux, nous parlions sans fin des filles de l’école, mi-fanfarons, mi-intimidés, cherchant à nous donner du courage dans nos bravades pour attirer leur attention. Fred formait avec Jorge et moi une complicité à trois, où chacun tenait une place singulière.
Puis les noms ont recommencé à défiler, comme si les murs eux-mêmes les murmuraient : George Rodriguez, que nous appelions « grand George » pour le distinguer de « petit Jorge »; Susana Antunes, la plus mature d’entre nous, que j’avais même tenté, avec sa mère, de faire intégrer à notre coopérative Laloge; la ravissante Diana Ribeiro; Tony Almeida; Nancy De Melo; Dalia De Sa, que je recroiserais bien plus tard dans l’administration municipale de l’arrondissement; la grande Zaroula Kostopoulos; mon premier rival « politique » Stephanos Svourenos; et enfin, ma première blonde à vie, Jennifer Muto.

Je revoyais aussi Veh Ming, ce complice avec qui je formais, aux côtés de Jorge, un improbable trio de petits nerds. Ensemble, nous avions représenté fièrement l’école au fameux Mathémathlon en 6e année, gonflés d’un sérieux qui contrastait avec nos gabarits minuscules.
Et en arrière-plan, d’autres visages surgissaient : Chantale Laroche, Karine Samuel et Annick Noël, dont les sourires accompagnaient les récréations; Margarida, la responsable du service de garde, investie au point de garder contact avec plusieurs anciens élèves via Facebook, comme si elle refusait de cesser de nous voir évoluer; et Maria, l’enseignante de portugais en heure parascolaire, qui transmettait avec ferveur la langue et la culture de sa communauté.

Mon dernier instant avec Jorge avant son départ, ici aux côtés de Susana, lors de la soirée de notre bal des finissants
En évoquant ces souvenirs, nous avons ri de bon cœur quand je me suis mis à imiter Pierre Bibeau, notre énervant professeur de quatrième année, agitant sa maudite petite cloche pour imposer le silence à une classe dissipée. Jorge éclata de rire aussitôt, comme si nous étions encore là. L’émotion fut tout autre lorsque je lui annonçai le décès de Claudette Gingras, notre enseignante passionnée de sixième année, dont la compétence avait marqué la fin de notre parcours primaire.

Notre photo de classe en 6e année
Et puis, du coin de l’œil, une larme discrète vint troubler ma vision lorsque j’aperçus le muret de béton sur lequel je m’amusais à marcher en équilibre aux côtés de Pascale Perreault, mon premier amourette. C’était notre rituel en repartant ensemble après l’école, comme si prolonger la journée de quelques pas avait le pouvoir de retenir le temps. La cour prenait alors des allures de théâtre de mémoire, où chaque pierre, chaque recoin semblait vouloir nous restituer une parcelle de notre enfance.

Deux ans avant le départ de Jorge, j’avais déjà vécu un autre arrachement : le départ soudain de Pascale Perreault, mon premier amour. Ces deux adieux précoces – celui d’un amour naissant et celui d’un premier meilleur ami – m’ont initié à la fragilité des relations humaines et aux séparations inévitables qui jalonnent l’existence. J’ai raconté plus en détail cette blessure fondatrice dans un texte intitulé Fragments d’un premier amour, où je reviens sur ce moment qui a marqué durablement ma manière d’aimer et de perdre.
C’est à ce moment que Jorge m’a confié qu’il voulait absolument me revoir dans ce voyage où il revisitait son quartier d’origine, parce que j’étais, pour lui, indissociable de son cœur d’enfant et de cette cour où tout avait commencé. Selon ses propres mots, « On n’oublie jamais son meilleur ami. » Cette phrase m’a profondément touché, comme une reconnaissance à la fois simple et immense. En l’entendant, je me suis rappelé qu’une partie de moi, à l’époque, avait été révoltée face au destin : la vie m’arrachait mon ami sans que je ne puisse rien y faire, comme si l’océan lui-même s’était dressé entre nous.
Au fil de nos échanges, Jorge a convoqué des détails que j’avais manifestement enfouis : mes toutes premières lettres envoyées au Portugal, les timbres du Canada que j’y avais glissés, mes anecdotes obstinées sur les Nordiques de Québec (alors qu’il restait fidèle aux Canadiens de Montréal), et même le souvenir de ma salamandre baptisée Georgie en son honneur. Autant d’images que je croyais perdues et qui demeuraient pourtant intactes dans sa mémoire. Je me suis alors demandé pourquoi notre correspondance avait fini par s’arrêter, comme si ce fil qui nous reliait s’était effiloché au fil du temps.
Cette fidélité de Jorge à nos souvenirs, que je redécouvrais à travers son regard, m’a révélé à quel point j’avais moi-même refoulé une partie de ces images, sans doute comme un mécanisme de protection face au deuil de son départ. Et voilà qu’en les entendant ressurgir de sa mémoire, elles retrouvaient soudain tout leur éclat, comme si elles n’avaient jamais cessé d’exister.
Et puis, le passé a jailli dans le présent. J’ai subitement subtilisé la balle de tennis d’un enfant et, d’un geste instinctif, je l’ai lancée contre le même mur où nous jouions à la chance quatre décennie ans plus tôt, tout en mettant Jorge au défi de l’attraper. En une seconde, le temps s’est replié: mes gestes d’écolier, ses réflexes d’autrefois, nos rires d’enfants, tout revenait. C’était comme si nous rejouions la partie interrompue en 1987, au même endroit précis. Sa fille, amusée, a filmé la scène, témoin d’un retour en enfance pur et spontané. Cet instant avait valeur de rituel, un pont temporel tendu dans l’espace, où le passé et le présent se rejoignaient pour nous offrir une parenthèse d’éternité.
Cet instant hors du temps nous laissa le cœur léger, comme si nous avions vraiment rattrapé un fragment de notre enfance envolée. Le rire encore accroché aux lèvres, nous avons quitté la cour d’école et pris symboliquement la direction du boulevard Saint-Laurent. Là, nous nous sommes laissés porter par un courant invisible, comme si le quartier lui-même nous invitait à poursuivre ce voyage en arrière, jusqu’aux racines de la communauté portugaise du Mile End.
À mesure que nous avancions, Jorge scrutait les façades avec une intensité émue, comme s’il cherchait à convoquer d’autres fantômes du passé. J’étais captivé par son regard émerveillé, qui semblait revivre chaque souvenir en traversant ces lieux familiers. Il s’arrêtait parfois, presque incrédule, comme pour vérifier que le temps n’avait pas effacé ses repères. Sa seule vraie déception fut de constater la disparition du petit dépanneur au coin de Saint-Dominique et Villeneuve: ce haut lieu de nos expéditions d’écoliers, où nous dépensions nos maigres économies en bonbons colorés, en paquets de cartes et d’autocollants de hockey, et quelquefois en petits avions de styromousse que nous allions faire voler dans la cour lors des journées de grand vent. La façade avait disparu, engloutie par le temps et les transformations. Ce vide marquait une perte concrète, comme si le quartier nous rappelait que tout ne revient pas, et que même les pierres finissent par trahir la mémoire.
Et pourtant, d’autres choses étaient revenues, mais sous des traits méconnaissables, presque travestis. Là où s’alignaient jadis les petites boucheries portugaises, les clubs sociaux enfumés et les cafés modestes aux nappes cirées, s’élèvent désormais des micro-torréfacteurs aux vitrines épurées, des boulangeries bio aux prix étourdissants, des boutiques de design et des galeries d’art qui semblent s’adresser davantage aux passants de passage qu’aux habitants enracinés. Les ruelles où résonnaient autrefois les cris stridents des enfants courant derrière un ballon sont maintenant le théâtre de scènes bien plus sombres, habitées par des itinérants intoxiqués qui errent dans l’indifférence générale. Et, plus bruyants encore que jadis nos matchs improvisés, s’imposent désormais les conversations tapageuses des hipsters, jeunes professionnels en quête d’authenticité, un portable Apple dans une main, un latté dans l’autre.

Il y a déjà quinze ans, je constatais publiquement dans La Presse que « la sociologie du Plateau changeait »
Sur la Main, ce ne sont plus les accents portugais qui composent la rumeur des terrasses, mais carrément l’anglais, devenu langue dominante du commerce et du loisir. Le Mile End ouvrier de notre enfance, façonné par les sacrifices des familles immigrantes, a cédé la place à une vitrine policée de la gentrification, un décor réinventé pour une classe moyenne supérieure avide de charme urbain.
Le quartier a changé de visage, mais surtout, à nos yeux, il a laissé filer une part de son âme. Entre ces deux époques, un gouffre s’est creusé, et c’est dans cet écart que s’enracine notre nostalgie: la mémoire des lieux ne survit plus qu’en nous. Nos souvenirs d’enfants demeurent les seuls témoins d’un monde disparu, comme si le Mile End d’hier ne persistait désormais que dans nos pas, nos évocations… et ces réminiscences de cinquanténaires qui, un instant, nous rendent à nouveau enfants.
C’est dans ce contraste, entre l’absence et le renouveau, que nous avons poursuivi notre marche jusqu’à atteindre une contre-terrasse, juste en face du Parc du Portugal, à l’angle de Rachel et du boulevard Saint-Laurent. Ce petit parc, inauguré en 1975, avait été offert en hommage à la communauté portugaise qui s’était enracinée dans le Mile End et dont les générations successives avaient façonné l’âme du quartier.
La contre-terrasse où nous nous sommes assis ce jour-là incarnait, à sa manière, le basculement d’une époque à une autre. Ni tout à fait sur le trottoir, ni tout à fait dans la rue, elle grignotait sur l’espace autrefois réservé aux voitures pour l’offrir aux passants, aux familles, aux amis qui s’y arrêtaient. J’avais eu, à l’époque de mon mandat municipal, la chance de contribuer à cette innovation urbaine. Pourtant, en m’y installant avec Jorge, je ne ressentais aucune fierté personnelle, mais plutôt une satisfaction discrète : voir l’espace se rendre enfin à ce pour quoi il devrait toujours servir, la vie de quartier.
Et, en ce lieu précis, la symbolique devenait plus forte encore. Le Parc du Portugal s’imposait comme un seuil : d’un côté, l’ancien Mile End, façonné par les sacrifices des familles immigrantes; de l’autre, le Mile End gentrifié, vitrine de cafés branchés et de galeries d’art. Entre ces deux mondes, nous étions là, deux amis d’enfance retrouvés, déposant notre conversation comme on dépose une offrande à la mémoire. C’était comme si, assis sur cette contre-terrasse, nous reprenions symboliquement possession de notre passé en même temps que de ce bout de rue, transformé d’aire de stationnement en lieu de mémoire et de convivialité.
Au moment de commander, j’ai tenu à faire découvrir à Jorge une NEIPA, ce style de bière que j’ai adopté depuis une escapade dans le Maine, il y a quasiment dix ans. La seule disponible ce jour-là était la Tropiques-sur-le-Lac d’Unibroue, ornée d’un papillon monarque. En levant nos verres, je n’ai pu m’empêcher d’y voir un signe : ce grand voyageur des Amériques nous renvoyait l’image de Jorge, revenu après trente-huit ans vers son quartier d’origine, comme poussé par le même instinct de retour.
La conversation avait sa propre musique. Jorge alternait entre portugais et français; sa femme ne parlait que portugais; sa fille passait sans effort du portugais à l’anglais. Pour ma part, n’ayant aucune maîtrise du portugais, c’est en anglais que je me suis tourné vers elle, heureux de voir que, malgré la multiplicité des langues, le fil de la communication demeurait possible. Ce ballet polyglotte, où chacun trouvait naturellement sa place, prolongeait encore ce courant invisible qui nous reliait tous ensemble, comme si la diversité linguistique du Mile End se condensait à notre table.

Sur une contre-terrasse du Mile End, Jorge, sa famille et moi célébrons nos retrouvailles, entre mémoire, partage et présent retrouvé.
Puis, au milieu de cette mosaïque de langues, nous avons sorti nos téléphones. Les photos se sont mises à circuler comme autrefois les cartes de hockey : Jorge me montra sa maison de Lisbonne, l’endroit où il avait bâti sa vie, et m’expliqua qu’il était devenu architecte pour IBM. De mon côté, je lui parlai de mon parcours, de mes années de politique active qui avaient finalement cédé la place à mon métier de jardinier. Il n’en fut pas surpris : il y vit une suite logique, comme si ce retour à la nature prolongeait déjà l’enfant qui à l’époque courait toujours après les insectes.
C’est alors que je racontai à Jorge qu’un autre illustre Montréalais, Leonard Cohen, avait souvent été aperçu dans ce même parc du Portugal. L’évocation fit naître un sourire reconnaissant sur son visage: soudain, notre présence prenait un autre relief. Ce lieu n’était pas seulement le décor de nos souvenirs d’enfants, mais aussi un espace traversé par des figures universelles. Le Mile End apparaissait alors pour ce qu’il est vraiment: une terre de passage, où les destins les plus humbles comme les plus illustres se croisent et laissent derrière eux une empreinte invisible.
En ce jour d’août, Jorge et moi avions l’impression de nous inscrire à notre tour dans cette trame continue : notre amitié retrouvée devenait un fragment supplémentaire de l’histoire collective du Mile End, un fil intime ajouté à son immense tapisserie humaine. Comme si nos pas d’enfants, nos rires d’adultes et la mémoire d’un poète s’entremêlaient désormais dans le même écho.
Lorsque nous avons quitté la terrasse, le soleil déclinait doucement, enveloppant le Parc du Portugal d’une lumière dorée. Tout semblait chargé de signes. À chaque pas, je sentais que nous n’étions pas seulement deux amis qui se retrouvaient, mais aussi les témoins d’un quartier qui, lui aussi, avait connu ses départs, ses retours, ses métamorphoses.
Nous avons poursuivi notre marche jusqu’à l’église Santa Cruz. Les clochers se découpaient dans le ciel comme des flèches dressées vers la mémoire, rappelant que ce coin de ville restait habité par les racines invisibles de ceux qui l’avaient façonné. Pour Jorge, c’était un lieu de sacrement, empreint du poids du baptême et des rites de son enfance. Pour moi, il demeurait surtout un repère familier dans la cartographie du quartier.
Sur les marches, un silence s’installa, dense et habité. Nous savions que la journée touchait à sa fin, mais il y avait là la gravité d’un rite de passage. Jorge me remercia pour la balade guidée, ajoutant qu’il espérait que nous nous reverrions un jour, cette fois à Lisbonne, si j’avais l’occasion de traverser l’océan. Sa dernière question fut simple et sincère : comment avait évolué la communauté portugaise depuis son départ ? Je dus admettre que je n’en savais pas grand-chose, puisque je n’habitais plus ce quartier depuis plusieurs années. Alors, presque en guise de confidence, je lui ai répondu que rien n’est éternel, que tout est toujours en mouvement… et que, comme n’importe quoi, nous ne sommes finalement partout que de passage.
Avant de nous séparer, Jorge me dit qu’il voulait amener sa famille au belvédère du Mont-Royal, pour leur montrer Montréal vue d’en haut. Je lui demandai s’il se souvenait encore du chemin, et il me répondit par l’affirmative, avec un sourire tranquille. Cette élévation vers le sommet prenait alors des airs de métaphore : comme si, après nos retrouvailles, Jorge devait s’élever une dernière fois au-dessus de la ville de son enfance avant de reprendre son envol vers le Portugal. Monter le Mont-Royal, c’était déjà amorcer son départ, un adieu qui prenait la forme d’une ascension.
Nous nous sommes alors serrés dans les bras. C’était peut-être un adieu, mais aussi une promesse, un passage de témoin discret qui nous réconciliait avec le temps et ses détours.
En m’éloignant, je me suis retourné une dernière fois. Sur les marches baignées par la lumière oblique de l’après-midi, Jorge et sa famille se tenaient immobiles, comme figés dans un halo. Leur présence avait quelque chose d’irréel, comme une apparition. J’avais l’impression d’avoir croisé un fantôme bienveillant de mon passé venu me revoir dans un monde parallèle.

Devant l’église Santa Cruz, Jorge et sa famille posent sur les marches d’un lieu sacré de son enfance — un dernier arrêt empreint de mémoire et de rites de passage.
Je leur ai lancé mes derniers mots en portugais : « Obrigado por tudo », avant de replonger vers ma propre réalité. L’océan qui nous avait éloignés s’était replié comme une marée, le temps d’un instant, pour ramener Jorge dans ma vie, preuve qu’un vrai ami d’enfance n’appartient jamais tout à fait au passé.
Puis j’ai repris ma route, et le Mile End contemporain s’est recomposé autour de moi. Mais quelque chose avait changé. Les rues, les façades, les arbres familiers vibraient de cette rencontre improbable, comme si eux aussi avaient participé à ce cercle refermé. Chaque pas faisait résonner l’écho de ceux que nous avions partagés quarante ans plus tôt, lorsque nous quittions l’école, cartable au dos et rires aux lèvres. Et je songeai alors que tout se transforme avec le temps : les lieux que nous avons connus, les communautés qui les habitent, mais aussi nous-mêmes, de nos corps à nos esprits. Rien n’échappe à ce mouvement, tout glisse, tout se métamorphose.
En marchant seul à nouveau, observant les passants qui croisaient ma route, une réflexion me traversa : à l’instar de la communauté portugaise qui avait marqué de son empreinte une époque avant de se disperser sous la pression du temps et de la gentrification, il se pourrait que les Québécois francophones connaissent un jour un destin semblable à Montréal. L’anglais, colonisateur et conquérant, s’impose chaque année davantage, comme une marée lente et persistante, redessinant peu à peu les contours culturels de la métropole.
Et pourtant, au milieu de ce flux qui emporte tout, un aspect avait résisté au temps : l’amitié retrouvée. Les mots de Jorge allaient désormais m’accompagner comme une prière inscrite dans mon parcours de vie : « On n’oublie jamais son meilleur ami. » Ils n’étaient plus un simple écho du passé, mais une vérité spirituelle, tendue à travers l’espace et le temps, vibrant en moi comme une présence éternelle, au cœur intime de mes origines.

adeus meu amigo
Tout s’évanouit, tout s’oublie, sauf l’âme des choses
– Fernando Pessoa (poète portugais)
O eco do Mile End, 38 anos depois
Há alguns dias, reencontrei Jorge Simões, o meu primeiro melhor amigo de infância. Dizer que foi um momento milagroso não é exagero. Embora nos tivéssemos reencontrado virtualmente no Facebook há uns quinze anos, as nossas trocas ficaram esparsas e nada deixava prever que um dia voltaríamos a ver-nos em carne e osso. Tanto mais que, desde a sua partida para Portugal em 1987, o Jorge nunca mais tinha posto os pés no Quebec.
O Mile End dos anos 80 não tinha nada do bairro na moda de hoje. Era uma zona modesta, largamente operária, habitada maioritariamente por famílias vindas de fora, mas também por quebequenses de origem com a mesma condição. O bairro vibrava ao ritmo das línguas e culturas que ali se cruzavam. A comunidade portuguesa tinha ali um lugar de destaque: cafés, talhos, clubes sociais e restaurantes marcavam as artérias, dando ao quotidiano cheiros e sonoridades familiares. Aos fins de semana, as festas de bairro faziam soar a música, enquanto o cheiro de frango assado ou de chouriço escapava dos pequenos restaurantes familiares. Na escola primária Saint-Enfant-Jésus, onde o Jorge e eu crescemos lado a lado, o recreio reunia um verdadeiro mosaico social e cultural: crianças portuguesas, gregas, italianas, judias e quebequenses francófonas partilhavam a mesma simplicidade de vida, e muitas vezes a mesma precariedade, que os seus pais trabalhadores.
No recreio, éramos inseparáveis. O Jorge, nascido em Montreal de pais portugueses, era o meu irmão de brincadeiras, o meu cúmplice de todos os dias. Da primeira à sexta classe, figurávamos sempre entre os mais pequenos das respetivas turmas. Essa condição colocava-nos quase automaticamente lado a lado, na primeira fila quando chegava a hora de entrar, como dois irmãos em miniatura a enfrentar o mundo à mesma altura. Mas era sobretudo no campo de futebol que a nossa cumplicidade se jogava. A bola rolava sem descanso no asfalto, atraindo todos os rapazes da escola, e cada recreio virava um jogo improvisado cuja intensidade nada ficava a dever aos grandes estádios. O futebol era a nossa língua comum, o palco onde se exprimiam os nossos sonhos de crianças.
Depois, no fim do meu sexto ano, no verão de 1987, a família dele voltou a viver em Portugal. A amizade quebrou-se de repente, levada pelo oceano. Mas essa partida não marcou apenas o fim de uma cumplicidade: selou em mim a perda forçada da infância. Aquele tempo dourado, luminoso e despreocupado, fechou-se bruscamente, projetando-me para a adolescência, um período mais turvo, cheio de tensões e mal-estares, que ainda guardo como o mais difícil da minha vida. Na mesma época, os estudos secundários encaminharam-me para a PGL, na então cidade independente de Outremont. Foi aí que tomei consciência, quase sem querer, da existência das classes sociais, tão flagrante era o contraste entre esse meio abastado e o meu Plateau de origem. Foi um aprendizado doloroso, outra forma de medir a distância entre o que eu tinha sido e o que me tornava.
Com o recuo do tempo, pergunto-me se o luto dessa amizade com o Jorge não deixou em mim uma cicatriz mais funda do que supunha. Talvez explique porque, depois, fui tantas vezes tão mau a alimentar amizades profundas. Como se, após aquele primeiro arrancar, uma parte de mim se tivesse resignado à ideia de que todo o laço, mais cedo ou mais tarde, acaba por se romper.
Talvez por isso o reencontro inesperado com o Jorge tenha tido tamanha intensidade. Contra todas as expectativas, os nossos caminhos cruzaram-se de novo no Mile End, no Parc Lahaie, mesmo em frente da igreja Saint-Enfant-Jésus, a paróquia onde nascera a nossa cumplicidade. Desta vez, o Jorge não vinha sozinho: estava com a esposa e a filha de dezassete anos, como que a ancorar o reencontro no presente tanto quanto no passado. O reconhecimento foi imediato: dois cinquentões jovens a sorrirem sem hesitar, reencontrando a mesma centelha no fundo dos olhos. Comoveu-me ouvi-lo falar um francês ainda límpido, como se essa língua partilhada da infância nunca tivesse deixado de viver nele. Ao recebê-lo ali, mostrei-lhe a nova fonte que valoriza agora a fachada da igreja. Senti um orgulho discreto: fizera parte da equipa municipal que concebeu esta requalificação, a começar pelo fecho da rua Saint-Dominique ao trânsito para devolver aos peões e aos fiéis um adro digno desse nome.
Para o Jorge, aquele lugar ressoava com uma intimidade profunda: ali fizera a primeira comunhão, como tantas crianças de origem portuguesa da nossa escola, e os sinos de Saint-Enfant-Jésus pareciam ainda sussurrar-lhe o eco da infância espiritual. Para mim, que nunca fui batizado, aquelas pedras tinham outra carga: não a da fé, mas a da memória. Ancoram-me no bairro, na sua história e, sobretudo, nesta amizade original que continua a ligar-me, quase espiritualmente, ao Jorge.
Depois dos primeiros instantes no parque, caminhámos até ao recreio da escola Saint-Enfant-Jésus, o lugar fundador da nossa amizade. Nem ele nem eu lá voltáramos desde o fim do primário, e atravessar de novo aquele limiar, juntos, tinha algo de vertiginoso. O espaço, que lembrávamos imenso, parecia encolhido, mas as lembranças alargavam-no de imediato: o som dos sinos, os gritos dos recreios, o pó levantado pelos nossos sapatos.
Percorremos o pátio devagar, quase religiosamente, como se cada recanto tivesse guardado um vestígio de nós. À medida que avançávamos, os lugares pareciam restituir aquilo que o tempo quisera apagar: aqui, o campo ainda vibrava com a memória das intermináveis partidas de futebol, esse jogo rei que, para os rapazes, dominava tudo e marcava cada recreio como um mundial em miniatura; ali, ecoavam o mata e o jogo dos quatro cantos. E, contra aquele muro, a “chance”, o nosso jogo da bola ao muro, recuperava toda a sua carga de cumplicidade e desafio. Era como se as lembranças, presas ao espaço, se reacendessem assim que lhes pousávamos o olhar.
Depressa irrompeu outra memória: a das conversas de miúdos. Com o Fred Poulin, chegado da cidade de Quebec no quarto ano e que desde então me ficou como amigo precioso, falávamos sem fim das raparigas da escola, meio fanfarrões, meio intimidados, a tentar arranjar coragem nas bravatas para chamar a atenção delas. O Fred, o Jorge e eu formávamos uma cumplicidade a três, onde cada um tinha o seu lugar.
E os nomes voltaram a desfilar, como chamados pelos próprios muros: George Rodriguez, a quem dizíamos “George grande” para o distinguir do “Jorge pequeno”; Suzana Antunes, a mais madura de nós, que eu tentei a todo o custo integrar — a ela e à mãe — na nossa cooperativa Laloge; a bela Diana Gomes; Tony Almeida; Nancy Demello; Daliha De Soussa; a alta Zaroulla Kostopoulos; o meu rival “político” Stephanos Svourenos; e a minha primeira namorada, Jennifer Muto.
Via também o Veh-Ming, o cúmplice com quem formei, a par do Jorge, um improvável trio de pequenos “nerds”. Juntos, representámos com orgulho a escola no famoso Mathémathlon do 6.º ano, cheios de um zelo que contrastava com os nossos tamanhos minúsculos.
E, em pano de fundo, surgiam outros rostos: Chantale Laroche e Annick Noël, cujos sorrisos acompanhavam os recreios; a Margarita, responsável pelo ATL, tão empenhada que manteve contacto com vários ex-alunos via Facebook, como se se recusasse a deixar de nos ver crescer; e a Maria, professora de português em horário extracurricular, que transmitia com fervor a língua e a cultura da sua comunidade.
Ao evocar tudo isto, rimo-nos à gargalhada quando me pus a imitar o Pierre Bibeau, o nosso enervante professor do quarto ano, a agitar a maldita campainha para impor silêncio a uma turma irrequieta. O Jorge desatou a rir como se ainda ali estivéssemos. A emoção foi outra quando lhe anunciei a morte de Claudine Gingras, a nossa apaixonada professora do sexto ano, cuja competência marcara o fim do nosso percurso primário.
E, de repente, uma lágrima discreta veio-me aos olhos quando vi o murete de betão sobre o qual eu caminhava em equilíbrio ao lado da Pascale Perreault, o meu primeiro amor. Era o nosso ritual ao partir juntos depois da escola, como se prolongar o dia por mais uns passos tivesse o poder de reter o tempo. O pátio tomava ares de teatro da memória, onde cada pedra, cada recanto parecia querer restituir-nos um pedaço da infância.
Foi então que o Jorge me confidenciou que fazia absoluta questão de me rever nesta viagem em que revisitava o seu bairro de origem, porque eu estava, para ele, indissociavelmente ligado ao seu coração de criança e àquele recreio onde tudo começara. Nas suas próprias palavras: «Nunca se esquece o melhor amigo.» A frase tocou-me profundamente, como um reconhecimento simples e imenso. Ao ouvi-la, lembrei-me de como, na altura, uma parte de mim se revoltara contra o destino: a vida arrancava-me o amigo e eu nada podia fazer, como se o próprio oceano se erguera entre nós.
Ao longo da conversa, o Jorge convocou detalhes que eu manifestamente tinha enterrado: as minhas primeiras cartas enviadas para Portugal, os selos do Canadá que eu metera lá dentro, as minhas teimosas anedotas sobre os Nordiques de Quebec (enquanto ele permanecia fiel aos Canadiens de Montreal) e até a lembrança da minha salamandra batizada Georgie em sua honra. Imagens que eu supunha perdidas e que, afinal, permaneciam intactas na memória dele. Perguntei-me então por que razão a nossa correspondência acabara por cessar, como se o fio que nos ligava se tivesse desfiado apesar de nós.
Essa fidelidade do Jorge às nossas lembranças, que eu redescobria através do seu olhar, revelou-me o quanto eu próprio tinha reprimido parte dessas imagens, talvez como mecanismo de proteção diante do luto da sua partida. E eis que, ao ouvi-las ressurgir da memória dele, recuperavam de súbito todo o seu brilho, como se nunca tivessem deixado de existir.
E então, o passado irrompeu no presente. Subtilmente, “roubei” a bola de ténis de uma criança e, num gesto instintivo, lancei-a contra o mesmo muro onde jogávamos à “chance” há quatro décadas, desafiando o Jorge a apanhá-la. Num segundo, o tempo dobrou-se: os meus gestos de aluno, os reflexos de outrora dele, as nossas gargalhadas de miúdos, tudo voltava. Era como se retomássemos a partida interrompida em 1987, no mesmo ponto exato. A filha dele, divertida, filmou a cena, testemunha de um regresso puro e espontâneo à infância. Aquele instante tinha valor de ritual, uma ponte temporal esticada no espaço, onde passado e presente se uniam para nos oferecer uma pausa de eternidade.
Com o coração leve, como se tivéssemos realmente recuperado um fragmento da infância, deixámos o pátio e tomámos simbolicamente a direção do boulevard Saint-Laurent. Deixámo-nos levar por uma corrente invisível, como se o próprio bairro nos convidasse a prosseguir esta viagem ao contrário, até às raízes da comunidade portuguesa do Mile End.
À medida que avançávamos, o Jorge examinava as fachadas com uma intensidade comovida, como se procurasse convocar outros fantasmas do passado. Eu seguia cativado pelo seu olhar maravilhado, que parecia reviver cada lembrança ao atravessar estes lugares familiares. Às vezes parava, quase incrédulo, como que a verificar se o tempo não tinha apagado os seus marcos. A sua única verdadeira desilusão foi constatar o desaparecimento do pequeno “dépanneur” na esquina da Saint-Dominique com a Villeneuve: o alto lugar das nossas expedições de alunos, onde gastávamos as magras economias em rebuçados coloridos, em pacotes de cromos e autocolantes de hóquei e, por vezes, em pequenos aviões de esferovite que íamos lançar no pátio nos dias de muito vento. A fachada desaparecera, engolida pelo tempo e pelas transformações. Esse vazio marcava uma perda concreta, como se o bairro nos lembrasse que nem tudo regressa, e que até as pedras acabam por trair a memória.
E, no entanto, outras coisas tinham regressado, mas com traços irreconhecíveis, quase mascaradas. Onde antes se alinhavam pequenos talhos portugueses, clubes sociais enfarruscados e cafés modestos de toalha plastificada, erguem-se agora microtorrefações de vitrinas depuradas, padarias biológicas de preços estonteantes, lojas de design e galerias de arte que parecem falar mais para quem passa do que para quem pertence. As vielas onde antes ecoavam os gritos agudos das crianças a correr atrás de uma bola murmuram agora conversas aveludadas de jovens profissionais em busca de “autenticidade”, um portátil numa mão, um latte na outra.
Na Main, já não são os sotaques portugueses que compõem o rumor das esplanadas, mas sim o inglês, tornado língua dominante do comércio e do lazer. O Mile End operário da nossa infância, moldado pelos sacrifícios das famílias imigrantes, cedeu lugar a uma montra polida de gentrificação, um cenário reinventado para uma classe média-alta ávida de charme urbano.
O bairro mudou de rosto, mas, sobretudo aos nossos olhos, deixou escapar parte da alma. Entre estas duas épocas abriu-se um fosso, e é nesse intervalo que ganha raízes a nossa nostalgia: a memória dos lugares sobrevive apenas em nós. As lembranças de crianças ficam como as únicas testemunhas de um mundo desaparecido, como se o Mile End de ontem persistisse apenas nos nossos passos, nas nossas evocações… e nestas reminiscências de cinquentões que, por um instante, nos devolvem à infância.
Foi nesse contraste, entre ausência e renascimento, que prosseguimos até uma contra-esplanada, mesmo em frente do Parc du Portugal, na esquina da Rachel com o boulevard Saint-Laurent. Este pequeno parque, inaugurado em 1975, foi oferecido em homenagem à comunidade portuguesa que se enraizou no Mile End e cujas gerações sucessivas moldaram a alma do bairro.
A contra-esplanada onde nos sentámos encarnava, à sua maneira, a viragem de uma época para outra. Nem totalmente no passeio, nem totalmente na rua, “roubava” um pouco do espaço antes reservado aos carros para o oferecer a transeuntes, famílias e amigos que ali se detinham. Na época do meu mandato municipal, tive a sorte de contribuir para esta inovação urbana. Contudo, ao sentar-me ali com o Jorge, não senti orgulho pessoal, mas antes uma satisfação discreta: ver o espaço finalmente entregue ao que sempre deveria servir, a vida de bairro.
E, naquele lugar preciso, a simbologia tornava-se mais forte ainda. O Parc du Portugal impunha-se como um limiar: de um lado, o antigo Mile End, talhado pelos sacrifícios das famílias imigrantes; do outro, o Mile End gentrificado, montra de cafés “trendy” e galerias de arte. Entre estes dois mundos, estávamos nós, dois amigos de infância reencontrados, a depositar a nossa conversa como se fosse uma oferenda à memória. Era como se, sentados naquela contra-esplanada, retomássemos simbolicamente posse do nosso passado ao mesmo tempo que daquele pedaço de rua, transformado de zona de estacionamento em lugar de memória e convivialidade.
Na hora de pedir, fiz questão de dar a conhecer ao Jorge uma NEIPA, o estilo de cerveja que adotei desde uma escapadela ao Maine, há quase dez anos. A única disponível era a Tropiques-sur-le-Lac, da Unibroue, com uma borboleta-monarca na lata. Ao erguermos os copos, não resisti ao sinal: esse grande viajante das Américas devolvia-nos a imagem do Jorge, regressado trinta e oito anos depois ao seu bairro de origem, como impelido pelo mesmo instinto de retorno.
A conversa tinha a sua própria música. O Jorge alternava entre português e francês; a esposa falava apenas português; a filha passava sem esforço do português ao inglês. Quanto a mim, sem domínio do português, voltei-me para ela em inglês, feliz por perceber que, apesar da multiplicidade de línguas, o fio da comunicação permanecia possível. Esse bailado poliglota, onde cada um encontrava naturalmente o seu lugar, prolongava a corrente invisível que nos ligava, como se a diversidade linguística do Mile End se condensasse à nossa mesa.
A certo ponto, os telefones vieram para cima da mesa. As fotografias começaram a circular como antigamente os cromos de hóquei: o Jorge mostrou-me a sua casa em Lisboa, o lugar onde construíra a vida, e explicou-me que se tornara arquiteto na IBM. Da minha parte, falei-lhe do meu percurso, dos anos de política ativa que acabaram por dar lugar ao meu ofício de jardineiro. Não se surpreendeu: viu nisso uma continuidade, como se esse regresso à natureza prolongasse o miúdo que, na época, andava sempre atrás dos insetos.
Contei-lhe então que outro ilustre montrealense, Leonard Cohen, fora muitas vezes avistado naquele mesmo Parc du Portugal. A evocação trouxe um sorriso reconhecido ao seu rosto: de súbito, a nossa presença ganhava outro relevo. Aquele lugar não era apenas o cenário das nossas memórias de miúdos, mas também um espaço atravessado por figuras universais. O Mile End surgia então como realmente é: terra de passagem, onde destinos humildes e ilustres se cruzam e deixam atrás de si uma marca invisível.
Nesse dia de agosto, o Jorge e eu tínhamos a impressão de nos inscrever, por nossa vez, nessa trama contínua: a amizade reencontrada tornava-se mais um fragmento da história coletiva do Mile End, um fio íntimo acrescentado à sua imensa tapeçaria humana. Como se os nossos passos de crianças, os nossos risos de adultos e a memória de um poeta se misturassem agora no mesmo eco.
Quando deixámos a esplanada, o sol declinava suavemente, envolvendo o Parc du Portugal numa luz dourada. Tudo parecia carregado de sinais. A cada passo, sentia que não éramos apenas dois amigos que se reencontravam, mas também testemunhas de um bairro que, ele próprio, conhecera partidas, regressos e metamorfoses.
Seguimos até à igreja Santa Cruz. Os campanários recortavam-se no céu como flechas apontadas à memória, lembrando que aquele canto da cidade continua habitado pelas raízes invisíveis de quem o moldou. Para o Jorge, era um lugar de sacramento, impregnado do peso do batismo e dos ritos da sua infância. Para mim, permanecia sobretudo um marco familiar na cartografia do bairro.
Nos degraus, instalou-se um silêncio denso, habitado. Sabíamos que o dia chegava ao fim, mas havia ali a gravidade de um rito de passagem. O Jorge agradeceu-me a visita guiada, acrescentando que esperava que nos voltássemos a ver um dia, desta vez em Lisboa, se eu tivesse ocasião de atravessar o oceano. A sua última pergunta foi simples e sincera: como tinha evoluído a comunidade portuguesa desde que partira? Tive de admitir que não sabia bem, porque já não vivia no bairro há vários anos. Então, quase em confidência, respondi-lhe que nada é eterno, que tudo está sempre em movimento… e que, como tudo na vida, estamos sempre de passagem.
Abraçámo-nos. Era um adeus, mas também uma promessa, uma passagem discreta de testemunho que nos reconciliava com o tempo e os seus atalhos.
Ao afastar-me, voltei-me uma última vez. Nos degraus banhados pela luz oblíqua da tarde, o Jorge e a família permaneciam imóveis, como que envoltos num halo. Havia neles algo de irreal, como uma aparição. Tive a sensação de ter cruzado um fantasma benévolo do meu passado num mundo paralelo.
Atirei-lhes as minhas últimas palavras: «Obrigado por tudo», antes de mergulhar de novo na minha própria realidade. O oceano que nos afastara recuara como uma maré, por um instante, para trazer o Jorge de volta à minha vida, prova de que um verdadeiro amigo de infância nunca pertence inteiramente ao passado.
Depois retomei o meu caminho, e o Mile End contemporâneo recompôs-se à minha volta. Mas algo tinha mudado. As ruas, as fachadas, as árvores familiares vibravam com aquele encontro improvável, como se também elas tivessem participado do círculo que se fechara. Cada passo fazia soar o eco dos que partilháramos quarenta anos antes, quando saíamos da escola, mochila às costas e risos nos lábios.
Caminhando sozinho outra vez, observando os transeuntes que cruzavam o meu percurso, atravessou-me uma reflexão: tal como a comunidade portuguesa que marcou uma época antes de se ver dispersa pela pressão do tempo e da gentrificação, talvez os quebequenses francófonos um dia conheçam destino semelhante em Montreal. O inglês, conquistador, impõe-se a cada ano um pouco mais, como uma maré lenta e persistente, redesenhando pouco a pouco os contornos culturais da metrópole.
E, no entanto, no meio desse fluxo que leva tudo, uma coisa resistiu ao tempo: a amizade reencontrada. As palavras do Jorge passaram a acompanhar-me como uma oração inscrita no meu caminho de vida: «Nunca se esquece o melhor amigo.» Deixaram de ser apenas um eco do passado para se tornarem uma verdade espiritual, estendida através do espaço e do tempo, vibrando em mim como uma presença eterna, no coração íntimo das minhas origens.
“Au revoir mon ami”.
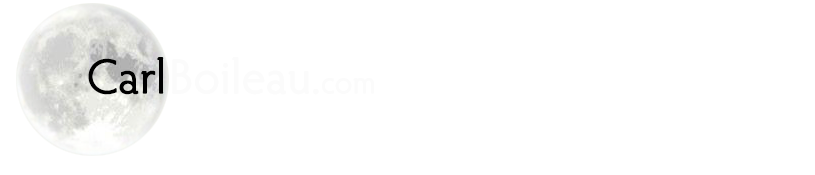


























Bonjour Carl, tu viens de me faire pleurer en lisant tes lignes. J’ai eu l’impression de revenir en arrière et de redécouvrir les beaux moments passés dans notre école primaire. Comme nous ne pouvions pas imaginer ce que l’avenir allait nous réserver. Et quoi dire de plus, nous retrouver dans une salle de conférence après votre victoire et se reconnaître au premier clin d’oeil. Nous n’oublions jamais les personnes qui ont fait partie de nos vies un jour ou l’autre. Au plaisir de se revoir.