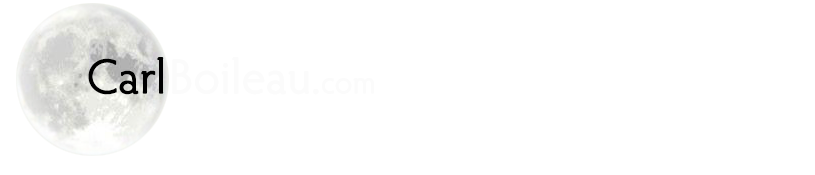Au four libéral, les brownies ne cessent jamais de cuire

Encore une fournée de brownies dans la cuisine libérale
Il y a dans la politique québécoise des odeurs que l’on reconnaît avant même d’en identifier la source, des effluves brunes qui montent comme la chaleur d’un vieux four qu’on n’a jamais vraiment éteint. La corruption libérale fait partie de ces parfums tenaces, presque familiers, tant elle revient avec la régularité d’une fournée de brownies qui sort du four sans que personne ne se souvienne avoir réglé la minuterie. On a beau savoir, à la lumière de l’histoire et de l’expérience, que cette culture d’influence et de patronage est presque intrinsèque aux partis libéraux, l’épisode se répète toujours avec la même lassitude, comme un rituel que personne n’ose interrompre.

Comme l’a justement résumé le commentateur politique Nic Payne, un parti qui a pour mission structurelle de maintenir un régime de domination empêchant son propre peuple d’accéder à son indépendance nationale porte, par essence, les germes de la corruption. Ce type de formation attire naturellement « des naïfs, des carriéristes ou des opportunistes en quête de retours d’ascenseur », créant un terreau où l’éthique devient facilement évanescente. Une observation qui, avec le recul, éclaire d’un jour cru la situation qui suit.

Avant même que l’histoire des brownies n’éclate, le four libéral chauffait déjà avec l’affaire Marwah Rizqy. La semaine dernière, celle que j’ai toujours considérée comme l’une des voix les plus intègres du PLQ a congédié sa directrice de cabinet, Geneviève Hinse, cherchant surtout à préserver sa propre réputation au moment où quelque chose semblait se tramer autour d’elle. Pablo Rodriguez l’a suspendue du caucus pour « bris de confiance », mais tout dans son attitude publique témoignait d’un souci réel de rester du côté des règles et de la transparence. En la voyant camper calmement sa position, on comprenait qu’elle refusait d’être entraînée dans une zone d’ombre qui ne lui appartenait pas. Avec le recul, cet épisode apparaît comme une première bouffée de chaleur, annonçant que la cuisine libérale brûlait déjà bien avant que ne flotte l’odeur sucrée du brownie.
Puis est venue l’affaire des textos en franglais, révélée par le Journal de Montréal. On y évoquait un « brownie », non pas un dessert, mais un billet brun glissé discrètement en échange d’un vote lors de la dernière course à la direction du PLQ. L’image était aussi grotesque que révélatrice. Et pour couronner le tout, il fallait que ces échanges soient rédigés en franglais, ajoutant une couche de symbolique colonisée quand il question de parler des « vraies affaires ». Pablo Rodriguez, fraîchement élu chef, a répondu par une enquête externe suivie de menaces de poursuites, une réaction qui rappelait la porte d’un four qu’on referme brusquement pour empêcher la fumée d’envahir la cuisine. Le Directeur général des élections, de son côté, a expliqué qu’acheter un vote dans une course à la chefferie n’était même pas illégal si on comptabilisait la dépense (!?!), ce qui en dit long sur la manière dont la recette a été écrite.


Il faut dire que l’écosystème politique n’a pas mis de temps à s’emparer de cette histoire de brownies. En quelques heures à peine, les réseaux sociaux se sont retrouvés inondés de caricatures et même de deepfakes montrant Pablo Rodriguez dans des mises en scène de plus en plus savoureuses. Que cela nous plaise ou non, cette technologie s’installe déjà dans notre imaginaire politique, exactement comme les mèmes l’ont fait avant elle, d’abord anecdotique, ensuite virale et très vite incontournable. Ce que nous voyons aujourd’hui n’est qu’un avant-goût. Il y a fort à parier que la campagne électorale de 2026 sera la première où les deepfakes seront aussi omniprésents que les lignes de parti, et peut-être même plus convaincants que les discours eux-mêmes. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, dans une époque où la post-vérité est devenue un terrain de jeu à ciel ouvert.
Dans ce décor enfumé s’est glissé Farnell Morisset, fidèle au poste, véritable maître du damage control semble t’il. Avocat de formation, actif dans le droit des affaires et créateur de contenu prolifique, il vulgarise depuis quelques années des enjeux politiques et juridiques sur les plateformes sociales avec une aisance qui lui a valu une petite réputation de fin argumentateur. Cette semaine, plusieurs se demandaient s’il allait oser produire une capsule sur la crise qui secoue le PLQ ou s’il allait subtilement contourner la question. Il a finalement relevé le défi avec brio, réussissant à insinuer le doute avec une précision presque chirurgicale. Et même si on sourit parfois devant la facture artisanale de ses capsules, il ne faut pas s’y tromper, c’est un avocat professionnel qui sait exactement comment orienter un raisonnement dans l’esprit du public.
Je le suivais depuis plus d’un an, convaincu d’assister à une initiative citoyenne sincère. Le contraste entre la simplicité technique de ses vidéos et la générosité des informations qu’il y partageait ne laissait vraiment pas croire à une production soutenue, encore moins financée, par un parti politique. Ses analyses rendaient limpides des mécaniques complexes comme le financement politique, le rôle des médias ou le fonctionnement de nos institutions. Je les trouvais rafraîchissantes et, je l’avoue, profondément honnêtes dans leur intention. C’est pourquoi j’ai été surpris, puis franchement déçu, d’apprendre qu’il était non seulement membre actif du PLQ, mais aussi donateur. Cette information a déplacé quelque chose en moi, non pas contre lui, mais dans la manière d’entendre désormais ce qu’il dit. Elle n’enlève rien à son intelligence ni à son talent rare de synthèse, mais elle impose une vigilance différente, une distance nécessaire.
Au-delà de nos partis respectifs, il demeure pour moi l’une des rares voix libérales qui semblent encore animées par un véritable esprit libre, ce qui, avouons-le, devient plutôt exceptionnel dans un parti où la loyauté professionnelle et la discipline d’appareil remplacent souvent l’engagement citoyen. Le PLQ fonctionne depuis longtemps comme une formation de gestionnaires et d’affairistes, un milieu où l’on gravit les échelons par cooptation plus que par conviction, et où le pouvoir, l’influence et l’avancement individuel tiennent lieu de boussole morale. Ma sœur, avocate et associée dans un grand cabinet montréalais, m’a déjà confié qu’un passé militant au PLQ est perçu comme une sorte de stage professionnel, un laissez-passer tacite pour gravir plus vite certains échelons.
Dans un tel écosystème, voir surgir quelqu’un comme Farnell Morisset, qui malgré son ancrage partisan semble encore penser librement en public, relève presque de l’exception. Dans cette capsule-ci, il parvient à défendre son camp avec juste assez de nuances pour entretenir la perspective d’un recul critique. Et malgré nos divergences désormais nationales, lui et Marwah Rizqy demeurent parmi les seuls libéraux que je trouve sincèrement investis dans le bien commun.
Il faudra d’ailleurs reconnaître au passage que sans Québecor, cette énième affaire de corruption libérale n’aurait probablement jamais vu le jour. Ni La Presse ni Radio-Canada n’auraient laissé filtrer un scandale qui dérange autant le régime fédéraliste. Et pendant que cette fumée montait du four libéral, on pourrait se demander ce que fait Québec solidaire dans tout ça. Certes, le parti a déjà plein les bras avec la démission de Vincent Marissal, mais il faut bien admettre qu’en matière de dénonciation des libéraux, QS ne fait guère plus aujourd’hui qu’hier. Le silence reste confortable, presque mécanique.

C’est d’ailleurs dans cette zone grise qu’a surgi cette année, presque du jour au lendemain, une nouvelle voix progressiste. Un certain Alexandre Dumas s’est imposé à une vitesse fulgurante dans l’écosystème de QS, orientant son discours interne avec une radicalité qui cible toujours les mêmes adversaires, soit le nationalisme québécois et Québecor, qu’il décrit comme une dérive quasi fasciste. Sous couvert de lutte intersectionnelle à la haine, il en vient même à souhaiter la disparition d’un pan entier de la pluralité médiatique, comme s’il fallait purifier l’espace public de tout ce qui n’épouse pas docilement le récit dominant.
Or, le paradoxe saute aux yeux. Une supposée « gauche » qui prétend combattre les dominations finit ici par relayer, presque par réflexe conditionné, le narratif du pouvoir fédéraliste en détournant au passage l’attention de ceux qui détiennent réellement les leviers. Ainsi, Québecor devient l’ennemi absolu, le PQ un parfum de trumpisme et les libéraux un sujet tabou. Et à force d’éviter tout ce qui pourrait égratigner le régime en place, on en vient presque à se demander, avec simplicité, si Dumas ne développe pas lui aussi un certain goût pour ces petites bouchées brunes qui sortent sans arrêt du four libéral. Car pendant que la fournée tourne à plein régime, c’est plutôt la « boulangerie » nationale la plus visible qu’il pourfend sans relâche, coupable à ses yeux de servir un pain un peu trop local, un peu trop populaire, un peu trop homogène… bref, beaucoup trop québécois pour satisfaire les exigences de son fin palais progressiste avide de saveurs plus exotiques.
Blague à part, c’est justement pour cela que la présence de Québecor demeure essentielle. Dans un paysage médiatique où la convergence fragilise déjà la pluralité des voix, leur rôle de contrepoids permet de révéler ce que d’autres préfèrent taire, surtout lorsque la critique vise un camp qui, à gauche, semble toujours plus bénéficier d’une étrange immunité idéologique. Fermer cette fenêtre là, sous prétexte d’antifascisme approximatif, reviendrait à étouffer les seuls courants d’air capables d’empêcher le four libéral de brûler la cuisine au complet.
On en vient presque à remercier ironiquement les « fascistes » de Québecor pour leur contribution à l’équilibre démocratique, tant ceux qui prétendent défendre l’ordre moral progressiste semblent parfois étrangement indifférents à la corruption du pouvoir libéral. Et pendant que les brownies continuent de cuire dans la chaleur feutrée du four libéral, il appartiendra aux citoyens, aux journalistes qui n’ont pas peur de se brûler, et aux partis qui ont encore une colonne vertébrale de rappeler que la cuisine du Québec ne peut pas rester éternellement enveloppée de cette vapeur brune. Car à trop s’habituer à l’odeur, on finit par croire que la brûlure fait partie de la recette.
Et c’est peut-être là, au fond, que se trouve le véritable nœud du problème. La corruption libérale n’est pas un accident, ni une suite de dérapages isolés, mais la manifestation structurelle d’un régime qui n’a jamais été pensé pour servir le Québec. Tant que nous vivrons dans un cadre politique où les leviers essentiels nous échappent, tant que notre démocratie sera enchâssée dans un système conçu pour maintenir un peuple dans la dépendance, les brownies continueront de cuire, inlassablement, et la facture sera toujours payée par les Québécois.
L’indépendance n’est pas un slogan éculé, ni un vieux rêve pour soirées commémoratives. C’est la seule manière concrète de refermer définitivement ce four-là, de sortir du cycle des scandales récurrents, et de bâtir enfin un État où la reddition de comptes n’est plus une faveur, mais un réflexe naturel. Un pays où les institutions ne protègent plus l’impunité libérale, mais l’intégrité collective.
Parce qu’un peuple qui contrôle sa cuisine choisit ses recettes, ses ingrédients et la qualité de ce qu’il sert à table. Et le Québec mérite autre chose que des brownies servis à répétition. Le Québec mérite de cuisiner pour lui-même.
Un peuple qui élit des corrompus, des renégats et des imposteurs n’est pas victime, il est complice.
George Orwell