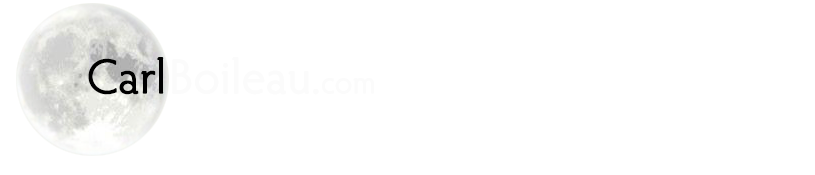Face à la vague Carney, la « gauche » québécoise choisit de se taire… ou de voter libéral

On nous parle de démocratie, mais la sortie est condamnée… car le progressisme de façade est en ruines
Alors que la prochaine élection fédérale s’annonce comme un duel entre deux formes de droite — l’une populiste, l’autre néolibérale —, une partie de la « gauche » québécoise semble prête à appuyer le Parti libéral de Mark Carney… au nom du « moindre mal ».
Mais peut-on encore parler de gauche, lorsqu’on légitime un régime qui incarne l’ordre économique et politique qu’on prétend combattre ?
Le nouveau tabou de la gauche : critiquer les Libéraux
Une étrange paralysie frappe ce qu’il reste d’une certaine gauche intellectuelle québécoise. Alors que se dessine clairement une vague libérale portée par Mark Carney, la plupart des figures critiques se taisent, ou pire : s’en accommodent.
La scène politique semble figée dans une sorte de jeu de rôles où les Conservateurs incarnent une menace absolue et les Libéraux, un moindre mal nécessaire. Ce narratif, entretenu autant par les médias dominants que par certains réseaux militants, permet de reconduire le statu quo fédéraliste et néolibéral… avec la caution morale de ceux-là mêmes qui prétendent vouloir le renverser. Et cette logique finit par produire un climat où, dans les milieux dits « progressistes », critiquer le Parti libéral n’est plus seulement mal vu — cela devient un véritable tabou.

Depuis plusieurs jours, Radio-Canada martèle un seul axe de communication : face aux menaces tarifaires de Donald Trump, Mark Carney serait l’unique rempart crédible pour protéger le Canada. Mais ce que Radio-Canada oublie de mentionner, c’est ceci : Carney leur a promis une augmentation de financement de 150 millions de dollars par année. À l’inverse, les Conservateurs proposent de couper les vivres à la société d’État. Autrement dit : le diffuseur public mène une opération de propagande active au profit du seul parti qui garantit sa survie financière. Un conflit d’intérêts criant. Et pendant ce temps, nos taxes servent à entretenir cette mise en scène — celle d’un Canada en péril qu’un banquier providentiel viendrait sauver… à condition, bien sûr, de voter du bon bord.
On peut toutefois critiquer Poilievre sans fin. On peut dénoncer le capitalisme de surveillance, la crise climatique, les inégalités croissantes. Mais dès qu’il s’agit de pointer du doigt le pouvoir libéral lui-même — son programme économique, son impérialisme identitaire, son mépris du Québec —, c’est silence radio.
Ce phénomène n’est pas anodin. Il traduit une profonde dérive idéologique : ce que certains appellent encore « la gauche » a perdu sa fonction critique, s’alignant sur l’agenda moral du régime canadien, au détriment de toute pensée politique autonome.
Or, cette gauche-là, si elle ne peut plus remettre en question le centre du pouvoir, que lui reste-t-il de « gauche » ? Des postures morales ? Des causes périphériques déconnectées de l’économie réelle ? Des indignations sélectives ? Des hashtags ?
On peut bien agiter des causes sociales. On peut bien signer des manifestes. On peut bien parler d’intersectionnalité et d’écologie intégrale. Mais si, dans les faits, on soutient un régime qui consolide les rapports de domination, qui impose une identité anglophone à tout le pays, qui nie la diversité des nations et qui enrichit toujours les mêmes… alors ce n’est plus une posture de rupture. C’est une posture d’accompagnement.
Une stratégie qui trahit ses fondements : réponse à Laure Waridel
La prise de position de Laure Waridel est représentative de cette gauche dite « engagée » qui a, consciemment ou non, abandonné la critique du régime au profit d’un discours humaniste anesthésiant.
Dans une récente chronique intitulée « Au moins 7 raisons de bloquer Poilievre », elle appelle à voter contre les Conservateurs pour « protéger le Québec contre Trump », tout en flirtant avec l’idée d’alliances stratégiques avec les Libéraux.

On commence à connaitre le refrain de cette “gauche” écologiste. À la dernière élection, Laure Waridel écrivait déjà : « Habitant une circonscription pivot en Estrie, lundi, je voterai pour les libéraux. Je le ferai d’abord pour éviter l’élection des conservateurs climatosceptiques. Mais aussi parce que j’aimerais que mon vote contribue indirectement à ta présence (Guilbeault) en position de pouvoir à Ottawa. »
Le problème n’est pas dans sa volonté de bloquer Poilievre — libre à elle de combattre les idées conservatrices. Le problème, c’est la réduction de tout enjeu politique à une opposition binaire, quasi morale, entre le « fascisme » et « le progrès ». Une opposition qui absolutise le mal, pour mieux blanchir le statu quo.
Comme l’écrit Steve E. Fortin dans sa brillante réplique : « On est ici dans la logique de la démocratie minimaliste ; ou sa réduction à l’infini du « moins pire » qui ne s’est jamais, jamais traduit par mieux. »
Fortin va droit au but : l’idée même d’un pacte électoral avec les Libéraux est une insulte à la mémoire politique du Québec.
Qui, mieux que Trudeau père et fils, a incarné la négation du projet québécois ? Qui a davantage usé du multiculturalisme pour effacer notre singularité nationale ? Qui a davantage centralisé l’État, contourné les décisions de notre Assemblée nationale, et subventionné l’anglais au Québec avec tant d’aplomb ?
Et malgré tout cela, Waridel ne souffle mot de ces enjeux fondamentaux. Elle brandit le spectre Trump pour éviter toute analyse structurelle. Elle fait l’économie d’un bilan. Elle nous parle d’humanité, mais sans géographie ni mémoire.
Le plus troublant, c’est que Laure Waridel connaît ce bilan. Elle connaît l’environnement, la gouvernance, l’érosion des compétences québécoises. Elle connaît même Steven Guilbeault personnellement, et sait très bien ce que signifie sa rétrogradation au ministère du Patrimoine canadien orchestrée par Mark Carney.

J’ai mis beaucoup d’énergie, à l’époque, à mettre en garde contre ce piège : présenter Steven Guilbeault comme un champion de la révolution verte, pour faire entrer les Libéraux dans la circonscription hautement stratégique de Laurier–Sainte-Marie. Aujourd’hui, l’histoire me donne tristement raison : celui qu’on nous vendait comme porteur d’espoir écologiste est devenu… ministre de l’Identité canadienne.
Et surtout, elle sait que l’éléphant aura accouché d’une souris : celui qu’on nous avait vendu — notamment par Waridel elle-même — comme l’incarnation tant attendue de la révolution écologique à l’intérieur du régime fédéral s’est révélé n’être qu’un vulgaire promoteur du fédéralisme canadien, non sans, au final, nous avoir fait reculer sur les enjeux écologiques durant son passage au ministère de l’Environnement.
Ce qui constitue, au fond, une double trahison pour ce carriériste notoire : d’une part, il a trahi la cause écologique en se soumettant à la logique économique des grands pollueurs ; d’autre part, il a trahi le peuple québécois en devenant l’instrument docile d’un régime fédéral qui travaille activement à notre assimilation politique et culturelle.
Et pourtant, face à cela, Waridel choisit le silence. Ou pire : l’effacement volontaire de ce qui contredit son alignement stratégique. Un silence qui n’est pas anodin. Il neutralise toute opposition réelle. Il installe une ambiance de conformité dans les milieux militants, où la critique du régime libéral devient suspecte, voire dangereuse.
Et pendant ce temps, la machine libérale avance, avec ses pipelines « verts », son Canada post-national, ses injonctions judiciaires et ses ambitions assimilatrices. Mais au nom du « moindre mal », tout cela devient acceptable. Car il suffirait d’agiter l’épouvantail de Donald Trump — même à des centaines de kilomètres — pour que toute rigueur critique s’effondre. Comme si le simple fait d’être contre Trump suffisait à laver les mains d’un régime qui, lui aussi, sabote nos institutions, appauvrit nos citoyens et efface notre nation.
Une déception notable : réponse à Jonathan Durand Folco
S’il y a une prise de position qui m’a réellement interpellé, c’est celle de Jonathan Durand Folco dans Facebook. Contrairement à Laure Waridel, que je perçois depuis un bon moment comme arrimée, consciemment ou non, à l’esthétique libérale du pouvoir, Durand Folco a longtemps incarné, pour moi, une pensée de gauche lucide, critique, enracinée.
Nous avons déjà croisé le fer dans l’espace public numérique, à travers quelques échanges sur les réseaux sociaux, mais surtout par l’un de mes textes en réponse à certaines de ses prises de position. Je pense ici à mon article Quand le wokisme pousse la fenêtre d’Overton vers la droite, où je remettais en cause son interprétation du glissement idéologique de l’opinion publique. Si nous partageons un intérêt commun pour ce concept stratégique central en sciences politiques, c’est précisément autour de cette fameuse fenêtre d’Overton que notre divergence s’est cristallisée : là où Durand Folco voit dans la montée des partis populistes une dérive néo-fasciste vers la droite, j’y vois d’abord une réaction à l’enfermement identitaire d’une gauche radicale, coupée du réel et repliée dans sa propre chambre d’écho.

Quand le wokisme fait le jeu des conservateurs : ma réflexion sur la dérive identitaire et le déplacement de la fenêtre d’Overton.
Malgré ces désaccords profonds, j’ai toujours estimé qu’un dialogue était possible. Il nous arrivait même de partager des diagnostics communs — notamment sur les crises internes à Québec solidaire ou les impasses du capitalisme néolibéral.
Non seulement il expose avec justesse le cynisme de l’offre politique canadienne — Carney qui recycle les idées de Poilievre, Poilievre qui mime Trump, les Libéraux qui intègrent subrepticement le programme des Conservateurs —, mais il admet lui-même la vacuité morale du régime. Et pourtant, il finit par légitimer un vote libéral… dans certains comtés, pour empêcher « le pire ». Il appelle ça « voter avec des gants blancs ». On se croirait dans une fable postmarxiste où le dégoût remplace la conviction, mais où l’on passe tout de même à l’acte.
Ce type de raisonnement est dangereux.
Parce qu’il émane d’un intellectuel respecté.
Parce qu’il donne à des choix de compromis l’apparence d’une stratégie éclairée.
Parce qu’il normalise le renoncement.
Et surtout : parce qu’il délivre au Parti libéral une légitimité morale dont il ne devrait plus jamais disposer.
Durand Folco connaît le système. Il connaît les institutions financières. Il sait ce que représente un personnage comme Mark Carney :
– un haut fonctionnaire de la mondialisation,
– un banquier des élites,
– un architecte du capitalisme vert,
– un champion du libre-échange et des intérêts de l’Empire canadien.
Et malgré cela, il invoque l’ombre du fascisme, l’exemple de la France et les souvenirs de 2002 pour transformer un vote libéral en acte de résistance. Or, ce n’est pas de résistance qu’il s’agit ici. C’est de résignation. Et c’est même plus que cela : c’est une forme de cooptation.
La métaphore du « second tour à la française » est d’ailleurs révélatrice : elle importe un schéma étranger à notre réalité, où l’on feint de croire que le système électoral canadien peut produire des duels aussi limpides qu’en France. C’est faux. Et surtout, cela nie l’existence même du Québec comme entité politique distincte.
Parce que c’est cela, aussi, qui m’a frappé dans son texte : le vide québécois. Aucune mention de la Loi 98. Aucune mention de la francisation. Aucune allusion à la contestation judiciaire d’Ottawa, aux transferts de compétences, au sabotage du ministère des Langues officielles, à la subvention de l’anglais dans les institutions postsecondaires québécoises.
Rien.
C’est comme si le Québec n’existait plus dans l’analyse d’une gauche qui se veut radicale. Comme si le projet québécois était devenu une variable négligeable dans un combat moral globalisé. Comme si l’on ne pouvait plus défendre notre société, sans d’abord inscrire sa pensée dans le cadre du Canada post-national.
Et cela, pour moi, c’est une ligne rouge. Parce qu’une gauche qui oublie le Québec, c’est une gauche qui perd ses repères historiques. Et une « gauche » qui vote libéral, c’est une gauche qui désarme la critique systémique.
Alors que reste-t-il ? Une rhétorique moraliste, des gants blancs, et le sentiment d’avoir « fait sa part » en avalisant le régime.
Mais moi, je n’appelle pas ça penser. Et il faudrait peut-être se demander si l’on peut encore se dire radical… quand on choisit justement de ne plus penser face au pouvoir en place. Parce que moi, j’appelle ça abandonner.
Le Parti libéral est objectivement un parti de droite
À ce stade-ci, il ne s’agit plus d’une opinion : le Parti libéral est un parti de droite. Une droite certes lisse, diplomatique, cosmopolite… mais une droite économique, institutionnelle et identitaire, au service d’un Canada post-national et colonisateur qui refuse obstinément de reconnaître le Québec comme nation fondatrice.
Mark Carney : une figure de droite mondialisée issue de la haute finance internationale
Avec l’élection de Mark Carney à la tête du Parti libéral du Canada, le parti amorce une nouvelle ère sous la direction d’un leader dont le parcours, ancré dans les plus hautes sphères de la finance mondiale, confirme et accélère son glissement vers la droite économique et centralisatrice.
Toute la carrière de cet homme de 60 ans s’est faite loin de la politique, dans les capitales financières mondiales : il a été banquier d’affaires chez Goldman Sachs, avant de diriger la Banque du Canada puis la Banque d’Angleterre. Il siège encore aujourd’hui au conseil d’administration de Brookfield Asset Management, l’un des plus puissants fonds d’investissement au monde.

Pour Pierre Poilievre, actuel chef du Parti conservateur du Canada, Mark Carney incarne parfaitement “la voix de l’élite des milliardaires mondialistes qui a appauvri la classe ouvrière à l’échelle planétaire.” Ce qui frappe, c’est que ce genre de critique venait autrefois de la gauche. Aujourd’hui, elle est reprise par celui que plusieurs médias nous présentent désormais… comme un fachiste d’extrême droite.
Ce n’est pas un élu. C’est un haut fonctionnaire de l’ordre mondial, dont la carrière a été façonnée au sein de la finance internationale. Son style est rassurant, ses mots sont choisis. Mais son programme ? Il est limpide.
Carney propose :
- des baisses de taxes, ciblées pour la « classe moyenne », en réalité pour les segments électoraux décisifs de Toronto et Vancouver ;
- un accélérateur de développement des pipelines, au nom de la « transition réaliste » ;
- un virage vers l’intelligence artificielle et le nucléaire comme leviers économiques, tout en maintenant un discours écologique aseptisé ;
- une relance du marché immobilier privé, avec soutien aux promoteurs et facilitation de l’accès à la propriété… qui accentuera la spéculation plutôt que de créer du logement abordable ;
- le tout emballé dans une vision hyper-centralisée de l’État canadien, avec des « standards nationaux » pour l’éducation, les garderies, l’assurance dentaire… tous dans des champs de compétence provinciale.
Mais c’est surtout sur le plan énergétique que les contradictions éclatent. Carney rêve d’un Canada à la fois superpuissance verte et géant pétrogazier. Il évoque un réseau électrique est-ouest construit avec les provinces et les peuples autochtones, sans démontrer sa faisabilité ni son acceptabilité. Faut-il harnacher les dernières rivières du Québec ? Multiplier les centrales nucléaires ?
Derrière les mots-clés — « souveraineté énergétique », « électricité propre et canadienne » —, c’est le vieux modèle extractiviste qui revient : pipelines, hydrocarbures à l’export, et évaluations environnementales expéditives.
Carney promet tout : le beurre (la croissance verte), l’argent du beurre (les baisses d’impôts), et — tant qu’à faire — le cul de la crémière, avec un budget militaire en hausse pour emballer le tout. Et tout cela, sans jamais remettre en question les fondements du capitalisme fossile. On appelle ça l’écocapitalisme dans sa version la plus candide… ou la plus cynique. Mais à voir l’impuissance de Steven Guilbeault à infléchir la machine, ne serait-il pas temps d’admettre que cette promesse n’était qu’une vue de l’esprit ?

📌 Ce texte est la suite de celui-ci : « Mark Carney en route vers le pouvoir : vous êtes pas écœurés de mourir, bande de caves ? »
J’y posais les bases de ma réflexion sur l’adhésion tranquille du Québec à un pouvoir qui ne lui parle plus — ni dans sa langue, ni dans son histoire.
Penser autrement… ou cesser de se dire de gauche
Il faut sortir de cette logique binaire et paresseuse qui nous enferme dans une opposition morale entre deux droites : l’une brutale et populiste, l’autre polie et néolibérale. Cette polarisation artificielle, constamment réactivée par les médias et relayée par certains milieux militants, infantilise le débat public. Elle transforme la politique en théâtre d’ombres, où l’on prétend combattre le fascisme en soutenant les institutions qui ont justement permis sa montée.
À force de désigner Pierre Poilievre comme l’ennemi ultime, on en vient à blanchir le régime libéral… et à récompenser ceux qui en sont les architectes. Mais ce chantage électoral permanent — « Votez libéral pour bloquer la droite ! » — a un prix. Et ce prix, c’est la capitulation intellectuelle. Car ce qu’on appelle ici « bloquer le pire », c’est, dans les faits, reconduire le même.
C’est oublier que :
- les inégalités sociales n’ont jamais été aussi criantes que sous Trudeau ;
- la transition écologique a été freinée par des projets d’exploitation fossile appuyés par l’État ;
- l’inflation du logement s’est accélérée à cause d’un modèle fondé sur la financiarisation du territoire ;
- la souveraineté du Québec a été bafouée à répétition par le gouvernement fédéral ;
- le français a reculé dans tous les indicateurs objectifs — et ce, sous un gouvernement prétendument progressiste.
Et pourtant, certains prétendent encore que voter libéral est un acte de résistance. Mais résister à quoi, exactement ?
Pierre Poilievre a bien des défauts. Son populisme, son style confrontant, et certaines de ses alliances idéologiques sont problématiques. Mais à tout le moins, il ne prétend pas être ce qu’il n’est pas. Et surtout, à la différence du Parti libéral, il ne fait pas de l’hyper-centralisation fédérale un dogme. Il affiche un respect — même stratégique — pour l’autonomie des provinces, ce qui ouvre des marges de manœuvre qu’un Québec lucide ne peut balayer du revers de la main.
La vraie question est ailleurs : peut-on encore se dire de gauche lorsqu’on soutient, même par défaut, un régime qui concentre le pouvoir, appauvrit les classes moyennes, favorise l’anglicisation du Québec et impose une vision unitaire du Canada contre toute reconnaissance de sa diversité nationale ?
Une gauche qui ne critique plus le capitalisme financier, la centralisation autoritaire et l’impérialisme culturel du Canada, ce n’est plus une gauche. C’est une nouvelle droite, en version « bienveillante », dont la posture morale remplace toute critique réelle du système.

Léa Stréliski prétend incarner la gauche, mais elle sert désormais de caution morale à un ex-banquier néolibéral comme Mark Carney. Quand le wokisme devient une stratégie marketing pour blanchir le régime, il ne reste plus grand-chose de la gauche.
Pour sortir du piège
Si nous voulons retrouver une pensée politique authentique, il faut recommencer à penser par nous-mêmes — ici, à partir du Québec, en dehors des matrices binaires importées des États-Unis. Il faut refuser le piège du moindre mal, non par confort idéologique, mais parce que cette stratégie produit, invariablement, le plus grand mal : l’épuisement démocratique, le cynisme politique, la perte de repères.
Il faut aussi sortir de cette pensée binaire — la peste ou le choléra — qui nous empêche de voir qu’une porte de sortie existe, ici même, au cœur de notre monde.
Cette porte, c’est l’idée d’un Québec maître chez lui. Non pas un Québec refermé sur lui-même, mais un Québec ouvert, confiant, responsable de ses choix et solidaire de ses voisins. Un Québec qui ne subit plus les décisions d’Ottawa, mais qui en propose de nouvelles. Un Québec qui ne vote pas pour le moins pire, mais qui agit pour le mieux possible.
Ce projet n’est pas un fantasme du passé. Il est une nécessité pour l’avenir. Car dans un monde où les États-nations redeviennent les principaux boucliers face aux dérives autoritaires, écocidaires ou financières, le Québec n’a pas les moyens de rester une province périphérique dans un empire centralisateur.
Il faut le dire clairement : si la fenêtre d’Overton glisse aujourd’hui vers la droite, ce n’est pas uniquement en raison de Trump ou de la montée des conservatismes populaires. C’est aussi parce qu’une partie de la gauche s’est laissée happer par le néolibéralisme mondialisé, troquant la lutte des classes pour une compétition victimaire entre identités. En exaltant les droits individuels au détriment du bien commun, le wokisme fragmente les identités nationales, atomise les sociétés de l’intérieur et réduit les citoyens à de simples unités de consommation isolées, vulnérables face au marché. Il affaiblit la force du nombre — celle de l’intérêt collectif, voire de la démocratie elle-même — et devient, consciemment ou non, une diversion politique parfaitement alignée sur les besoins de l’économie capitaliste.

Pire encore, cette même logique néolibérale finit par présenter la majorité populaire comme une menace potentielle qu’il faudrait baliser, contenir, voire discréditer — au nom de la protection des « minorités », souvent réduites à une abstraction utile. Un renversement pernicieux, où les classes dominantes s’arrogent le monopole de la vertu et en viennent à fachiser symboliquement le peuple… pour mieux préserver les privilèges du fameux 1 %.
Eh oui, notre banquier mondialiste exprime publiquement vouloir défendre le wokisme au Canada. Et dire qu’il y a encore des activistes pour dire que ce terme est une invention sans fondement de Richard Martineau et Québecor
Le wokisme, devenu une sorte de nouvelle religion sécularisée, a servi de cheval de Troie à un ordre autoritaire qui écrase l’autonomie des nations et diabolise toute volonté populaire de lui résister. En se coupant du peuple, cette gauche a abandonné le terrain, qu’occupent désormais les droites populistes.
Bref, il est temps que la gauche québécoise fasse son examen de conscience. Il est temps qu’elle reconnaisse qu’on peut encore être de gauche — sans épouser les dogmes du wokisme. Car seule une gauche enracinée, critique et populaire sera capable de penser librement et de transformer le réel.
Il y a aussi urgence à rouvrir un vrai débat sur ce qu’est la gauche au Québec. Sur ses alliances, ses limites, ses priorités. Une gauche qui se veut transformatrice ne peut plus se contenter de jouer les pompiers dans un édifice fédéral en ruines. Elle ne peut plus mépriser le projet indépendantiste comme étant ringard, trop nationaliste ou pas assez cool sur TikTok.
Elle doit reconnaître qu’en refusant de penser la souveraineté comme un outil politique, elle se condamne à l’impuissance. Et qu’à force de faire barrage à tout, elle ne construit plus rien.
Et surtout, il faut cesser de prêter le flanc à un pouvoir fédéral qui ne nous reconnaît ni comme nation, ni comme interlocuteur légitime.
Il y a des moments dans l’histoire où la fidélité à ses principes exige de ne pas céder à l’urgence fabriquée. Celui-ci en est un.
Alors, à ceux qui voudraient encore nous faire croire qu’un vote libéral serait un « vote de résistance », il faut répondre calmement, mais fermement : Non. Ce n’est pas de la résistance… C’est de l’alignement.
Et dans un régime structuré comme le nôtre, cet alignement a un nom : collaboration.
Rien n’est plus dangereux que l’abandon de la pensée critique au nom d’un prétendu progressisme
— Cornelius Castoriadis