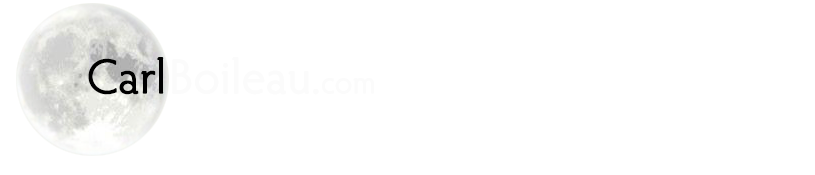Le fleurdelisé des Nordiques revient sur la glace. Sauf là où il devrait être

Mais pourquoi le Canadien de Montréal craint-il autant le retour du fleurdelisé sur la glace ?
Demain, à Denver, l’Avalanche du Colorado ramènera sur la glace l’uniforme fleurdelisé des Nordiques dans le cadre de sa série Héritage, qui revisite les trente ans de son passage de Québec au Colorado. Et ce retour prendra une résonance particulière, puisqu’il se fera contre le Canadien de Montréal. Sur une glace étrangère au Québec, ce duel réveillera inévitablement bien plus qu’une ancienne rivalité. Il ramènera à la surface la blessure encore vive laissée par le départ des Nordiques, une brèche qui a creusé un vide immense dans la culture sportive québécoise et, pour plusieurs dont moi, un sentiment durable de dépossession identitaire.
Depuis le début de la saison, l’Avalanche revendique haut et fort ses racines québécoises, une démarche qui surprend d’ailleurs bien des observateurs d’ici. En remettant en circulation ce chandail bleu constellé de fleurs de lys, elle ne ravive pas simplement un souvenir. Elle réactive un symbole national, un repère collectif que trente ans n’ont jamais réussi à effacer, et rappelle surtout qu’on ne peut raconter l’histoire de cette franchise sans passer par Québec.

Et demain, face au Canadien, ce symbole reviendra sous les projecteurs comme un message porté par un vent d’Ouest, une manière de rappeler ce que nous avons été et ce que nous refusons de cesser d’être. L’Avalanche l’assume pleinement, mais du côté montréalais, le malaise est palpable. À l’approche du deuxième affrontement prévu au Centre Bell le 29 janvier, tout laisse croire que l’organisation du Canadien cherche discrètement à empêcher le retour du fleurdelisé dans notre métropole. Ironique, tout de même, qu’il faille aller jusqu’au Colorado pour revoir un symbole que le Québec ne semble plus autorisé à accueillir chez lui.

As it celebrates 30 years of Colorado Avalanche hockey, the club announced the launch of their Quebec Nordiques specialty jerseys. As part of the Heritage Series, this jersey will pay homage to the franchise’s time in Quebec.
Sur ses plateformes, l’Avalanche détaille d’ailleurs clairement la charge identitaire de cet uniforme. Le logo en forme d’igloo évoque le paysage québécois et le climat nordique de la province, tout en reprenant la forme de la lettre « n » de Nordiques. Il rappelle à ses partisans que « Nordiques » signifie littéralement « Northerners » en anglais, c’est-à-dire les gens du Nord. Les fleurs de lys, alignées au bas du chandail et déposées sur les épaules, constituent un clin d’œil explicite au drapeau du Québec et à l’héritage canadien-français. Quant à la palette bleu, blanc et rouge, inspirée directement du drapeau français, elle affirme la profondeur des racines francophones qui ont marqué la franchise depuis sa création. Bref, un hommage authentique qui transcende le simple question du marketing cosmétique.
Au cœur de cette opération de mémoire, on retrouve le légendaire Joe Sakic. L’ancien numéro 19 des Nordiques, aujourd’hui président des opérations hockey de l’Avalanche, demeure le trait d’union vivant entre l’équipe disparue et la franchise actuelle. Dernier grand capitaine des Nordiques, premier capitaine de l’Avalanche lors de la conquête de la Coupe Stanley en 1996, il n’a jamais rompu le lien avec Québec. Ce retour du chandail porte sa marque. Tout indique qu’il s’agit moins d’un geste marketing que d’un acte de reconnaissance, posé dans le respect d’une histoire qui dépasse largement le cadre du sport.

Une vente précipitée, une histoire mal digérée On oublie parfois à quelle vitesse l’histoire a basculé. Le 25 mai 1995, les Nordiques étaient vendus à Comsat Communication pour 75 millions de dollars américains, puis déménagés aussitôt. Une concession fondée en 1972, profondément enracinée dans la capitale, qui n’aura jamais eu le temps de soulever ici la Coupe Stanley qu’elle touchait presque du bout des doigts. Pour comprendre à quel point ce départ fut le résultat d’un enchaînement de pressions politiques, d’ultimatums, de refus gouvernementaux et d’un marché essoufflé, l’article de Histoire Nordiques en offre un récit détaillé et essentiel. Un rappel brutal que cette vente n’est pas tombée du ciel, mais qu’elle fut le point final d’années de bras de fer, de promesses non tenues et d’occasions manquées
La vidéo qui a tout rouvert
(Trente ans d’histoire confisquée)
C’est dans ce contexte que la vidéo de l’Avalanche m’est apparue, par surprise, dans mon fil d’actualité en octobre dernier. Quelques images d’archives, une trame sonore sobre, et soudain ce chandail qui reprend vie. J’avais les yeux pleins d’eau, non pas simplement par nostalgie, mais par collision de symboles. Ce n’était pas une simple promotion. C’est un geste de mémoire. Et en le voyant, j’ai senti remonter une émotion que je croyais rangée depuis longtemps. Pour nous, partisans orphelins depuis trente ans, c’était comme une main tendue. Une façon de dire que notre histoire n’était pas totalement éteinte.
Mais en y regardant de près, un second choc s’est imposé. Ce retour visuel survenait exactement au moment où trois anniversaires se rejoignaient comme les pièces d’un même puzzle. Trente ans depuis l’arrivée de l’Avalanche au Colorado. Trente ans depuis le départ des Nordiques. Et trente ans depuis le référendum de 1995. Trois fils du temps qui, mis bout à bout, dessinent un glissement plus profond qu’on ne le dit. Trente ans d’un pays manqué. Et soudain, l’évidence frappe. On ne s’est pas seulement fait voler un pays. On s’est aussi fait voler une équipe qui était à un souffle de devenir championne. Quelques mois après avoir été arrachée à Québec, cette formation arrachée à notre capitale soulevait la Coupe Stanley. La nôtre, devenue celle des autres. La coupe qui aurait pu, qui aurait dû être levée ici. Le rêve déplacé, la fierté exportée, l’histoire confisquée.

Dès sa première saison au Colorado, en 1996, l’Avalanche remportait le précieux trophée, puis de nouveau en 2001 et en 2022. Trois Coupes ailleurs, aucune à Québec. Le rêve n’a pas disparu, il a simplement changé d’adresse.
Et voilà qu’en parallèle refont surface les preuves de plus en plus détaillées des manœuvres ayant saboté notre indépendance nationale. Pressions économiques, ingérences fédérales, opérations d’influence, détournements du processus démocratique. Le symbole sportif et la dépossession politique se répondent à trente ans de distance, comme deux plaies issues d’une même défaite collective que je n’ai, pour ma part, jamais été capable d’accepter.
On ne le dira jamais assez, laisser filer ce fleuron quelques mois avant le référendum de 1995 demeure l’une des grandes erreurs politiques de notre histoire récente. Difficile de demander à un peuple de croire en son indépendance quand son équipe, celle qui portait littéralement son drapeau sur la glace, file vers les États-Unis. J’ai longtemps reproché aux gens de Québec d’avoir moins voté Oui que les Montréalais francophones, mais avec le recul, le ressentiment était réel. Et dans un vote décidé à moins de 50 000 voix, il n’est pas farfelu de penser que cette blessure sportive et identitaire a pu peser plus lourd qu’on l’admet.
C’est précisément à la lumière de cette vieille fracture que l’attitude actuelle du Canadien prend une autre couleur. Car ce qui aurait pu devenir un moment de réconciliation historique entre deux mémoires rivales semble, une fois de plus, se transformer en malaise soigneusement entretenu.
Au départ, rien ne laissait croire que l’initiative de l’Avalanche allait poser le moindre problème au Canadien. On aurait pu imaginer, presque naïvement, une réconciliation symbolique. Le retour du chandail des Nordiques, un hommage partagé à une rivalité légendaire, une mémoire historique que les deux organisations auraient pu porter ensemble. Et surtout ce match du 29 janvier, présenté comme le grand rendez-vous identitaire, celui où le symbole aurait enfin retrouvé sa place sur la glace québécoise.

Le match du 29 janvier au Centre Bell entre l’Avalanche et le Canadien n’est toujours pas intégré à la série Héritage. Il faut comprendre, par déduction, ce que cela révèle.
Puis, graduellement, quelque chose a commencé à grincer. Sans communiqué. Sans explication. Juste un malaise qui s’insinue. L’Avalanche souhaitait porter à nouveau l’uniforme fleurdelysé lors de ce deuxième affrontement. Le Canadien, lui, s’est mis à temporiser. À contourner. À esquiver. Et dans ce brouillard soigneusement entretenu, une impression s’est imposée. Ce n’est pas le geste de l’Avalanche qui dérange. C’est ce qu’il réactive ici. Le retour des Nordiques trouble le Canadien bien plus qu’il ne le devrait.
Le Canadien n’a toujours pas retourné l’appel de Joe Sakic, alors que l’Avalanche veut arborer les couleurs des Nordiques lors de son passage à Montréal, le 29 janvier prochain!!!
La chronique de Martin Leclerc est disponible sur notre Youtube juste ici: https://t.co/IVCmQ9Qzvm pic.twitter.com/5CRGjw6hgC
— Martin Lemay (@MartinLemay) October 24, 2025
Ce malaise dépasse de loin la simple question de protocole. Ce qui transparaît, c’est un réflexe. Un réflexe politique. L’organisation montréalaise réagit comme si la mémoire nordique était une présence indésirable. Non pas un anachronisme, mais une menace. Une perturbation. Et cette réticence silencieuse appelle une autre lecture que celle des opérations usuelles de la LNH. Une lecture de pouvoir.
C’est alors que l’ironie devient brutale. Le geste qui fait renaître notre symbole le plus profondément québécois ne vient pas du Canadien. Il vient de l’Avalanche. Il vient d’un Canadien anglais né à Vancouver, Joe Sakic, qui ravive de l’Ouest ce que notre métropole n’ose plus assumer. Et ce symbole, une fois projeté à l’écran, ne frappe pas un mur sportif, mais un mur politique. Là où il devrait être accueilli comme un héritage commun, il se heurte à une organisation fédéraliste qui n’a aucun intérêt à voir ressurgir un pôle identitaire rival.
À partir de là, une question devient incontournable. Si ce refus n’est ni accidentel ni ponctuel, s’il traverse les communications, les décisions et les silences du Canadien, alors il faut regarder du côté des rapports de force qui gouvernent réellement le hockey professionnel au Québec. Et c’est à ce moment précis que le Canadien cesse d’être un simple club sportif. Il devient un acteur central d’un verrou politique beaucoup plus large, un verrou qui ne souhaite manifestement pas revoir un jour une franchise renaître à Québec.
Le verrou Molson, obstacle politique au retour de Québec dans la LNH
Cette résistance ne sort pas de nulle part. Le Canadien de Montréal n’a jamais été une institution neutre. Il est profondément imbriqué dans l’ordre économique et politique issu de la colonisation britannique, au cœur duquel la dynastie Molson occupe depuis deux siècles une place stratégique. L’empire Molson n’est pas qu’une brasserie ou un commanditaire. C’est un pilier historique du pouvoir anglo-canadien à Montréal, une force qui a largement modelé le hockey professionnel au pays.
Le club lui-même illustre l’une des plus grandes opérations d’appropriation culturelle faites aux Canadiens français. Le nom « Canadien », jadis le nôtre, a été récupéré par l’État fédéral. L’hymne national, né dans un congrès patriotique canadien-français, est devenu l’hymne d’un pays qui refuse toujours de reconnaître notre nation. Et sous l’ère Molson, l’équipe s’est repositionnée comme une marque pan-canadienne, bilingue en façade mais alignée sur l’imaginaire fédéral anglophone, de plus en plus détachée de sa charge identitaire québécoise et de la présence de joueurs francophones.

À mes yeux, cette scène touche à l’apothéose du colonisé, fier de chanter l’hymne de son propre colonisateur, et qui plus est dans la langue même qui a servi à l’effacer. Une vidéo récente du Centre Bell montre la foule reprendre « O Canada » pour une équipe nationale qui ne compte pas un seul Québécois. Ce contraste dit tout. Il révèle une dépossession sportive plus vaste, désormais banalisée au cœur d’un amphithéâtre contrôlé par les Molson, piliers historiques du récit fédéraliste. Le Centre Bell devient alors le théâtre d’un patriotisme canadien qui relègue le Québec au rôle de simple figurant… en attendant qu’il soit complètement dissous dans l’histoire du Canada anglais.
Dans ce contexte, ce n’est pas surprenant que le retour visuel des Nordiques au Centre Bell crée un malaise. Le fleurdelisé sur un uniforme rival vient heurter le récit d’un Québec fondu dans l’ordre canadien que le Canadien cherche à incarner. Le chandail des Nordiques rappelle qu’il existe une mémoire sportive et nationale qui ne passe pas par Montréal, une mémoire que l’organisation actuelle préfère maintenir à distance.
C’est ici que ma thèse se raffermit. Le pouvoir économique et symbolique du clan Molson n’est pas qu’un obstacle ponctuel au port du chandail des Nordiques. Il agit comme un verrou structurel contre tout retour d’une franchise à Québec. Car la présence d’un deuxième pôle hockey québécois briserait le monopole identitaire, économique et symbolique que Montréal tire de son statut de seule équipe au Québec. La rivalité redeviendrait un rapport de forces bien réel. Et ça, dans l’ordre actuel, doit être évité.

La poutine, symbole d’une appropriation culturelle contemporaine :
Née dans les cantines rurales du Québec et longtemps tournée en ridicule par le Canada anglais, la poutine est aujourd’hui recyclée comme « plat national canadien ». Au Centre Bell, elle est vendue dans une version vidée de son histoire et transformée en produit autant formaté que dispendieux. Un symbole populaire arraché à son terroir pour être exploité en marchandise. Étrangement, aucune indignation woke ici ne s’en émeut.
Ce verrou ne s’exprime jamais par une opposition frontale. Il opère par un jeu d’influences, de silences, de positionnements stratégiques, de choix économiques et de rapports de force discrets, inscrits au cœur même des structures de la LNH et du marché canadien. Rien n’est annoncé. Rien n’est officiellement bloqué. Mais tout semble savamment contenu.
Ce n’est pas la première fois que le clan Molson se trouve au centre d’un enjeu politique structurant au Québec. J’ai d’ailleurs analysé en détail cette capacité de la dynastie à orienter le récit collectif à travers un exemple révélateur. La promotion, voire l’invention, par le Canadien de Montréal du discours sur le « territoire mohawk non cédé » n’est pas un simple geste symbolique anodin, mais une construction politique qui participe à un révisionnisme historique plus large, où l’histoire coloniale britannique, la dépossession des Canadiens français et la question nationale québécoise se retrouvent soigneusement diluées au profit d’un nouveau récit compatible avec l’ordre fédéral contemporain.
Ce qui se joue ici dépasse donc largement un simple uniforme. Il s’agit d’un affrontement de récits, mais aussi d’un affrontement de structures. D’un côté, une mémoire québécoise que l’on tente de raviver par le sport, par les symboles, par l’émotion. De l’autre, une institution montréalaise lourde de pouvoirs économiques et symboliques, héritière directe d’un ordre colonial jamais complètement dissous, qui bloque systématiquement tout ce qui pourrait fissurer l’architecture idéologique et économique de l’ordre établi. Le chandail des Nordiques n’est plus seulement un objet de nostalgie. Il devient un point de tension politique majeur. Un révélateur. Un test de vérité.
Et pourtant, au-delà des structures de pouvoir, au-delà de la froide mécanique coloniale qui s’est insinuée jusque dans notre sport, il reste quelque chose de beaucoup plus intime. Quelque chose que les chiffres, les bilans financiers et les analyses politiques n’arrivent jamais à saisir complètement. Parce que cette histoire, avant d’être un affrontement de récits, a d’abord été une émotion. Une blessure. Une fidélité profonde. Et c’est là que mon histoire personnelle entre en jeu. Car pour moi, les Nordiques n’ont jamais été un simple club de hockey. Ils ont été un lieu où je déposais ma fierté, ma loyauté, mon sentiment d’appartenance. Ce que Montréal refusait, je le portais dans ma jeunesse comme un acte de résistance.
Un partisan orphelin dans un pays inachevé
Il y a pourtant, dans cette histoire, quelque chose qui dépasse les rapports de pouvoir et les manœuvres institutionnelles. Car avant d’être un enjeu politique, avant d’être un symbole disputé entre organisations, cette histoire a d’abord été une émotion. Une mémoire intime. Et c’est là que mon propre fil reprend, celui d’un jeune partisan pour qui les Nordiques n’étaient pas qu’un club, mais un lieu où se déposaient la fierté et l’appartenance.
Durant ma jeunesse donc, j’ai été un super fan de hockey. Chaque affrontement entre les Nordiques et le Canadien, je le vivais comme un épisode d’une grande saga nationale, un rituel presque initiatique. J’espérais toujours voir cette rivalité culminer un jour par une apothéose, voir Québec soulever enfin la Coupe Stanley. Ce grand moment n’est jamais venu ici. Il s’est produit ailleurs, sous d’autres couleurs, à peine un an après leur départ et quelques mois après le référendum. L’Avalanche gagnait la Coupe, mais cette victoire, bâtie sur nos joueurs, notre équipe, notre histoire, résonnait comme un chapitre arraché. Comme si, au moment même où nous étions prêts à écrire la suite, des forces politiques avaient détourné le cours du récit.

Avec ma soeur, durant un match de série des Nordiques de Québec contre les Canadiens de Montréal
À Montréal, j’étais donc un partisan des Nordiques parmi les rares. Un choix assumé, presque militant. J’y projetais mon sentiment nationaliste, mais aussi une prédisposition très nette, déjà bien installée en moi, à toujours prendre parti pour les équipes que l’on qualifie d’underdogs, peu importe l’époque, peu importe le sport. J’ai toujours eu ce réflexe instinctif d’aller du côté de ceux qu’on dit négligés et qui avancent avec moins de moyens, mais avec un feu plus vrai, plus vibrant. Dans les années 80, les Nordiques accordaient une place importante aux joueurs d’ici. Et surtout, ils portaient cette fleur de lys, symbole d’une présence francophone en Amérique qui refusait d’être reléguée aux marges de l’histoire. S’assumer Nordiques, à Montréal, c’était déjà poser un geste politique.

Comme je le racontais dans « La Coupe du monde et moi », mes premiers élans d’identité sont nés dans le sport, dans cette joie simple et collective de courir après un ballon. Plus tard, ce même instinct d’appartenance s’est cristallisé autour des Nordiques, qui ont incarné pour moi une manière d’être au monde, une fierté à défendre. Leur perte a donc résonné comme la fin d’un chapitre trop cher pour être oublié.
Puis les Nordiques ont été vendus aux États-Unis. Et avec eux, quelque chose s’est brisé en moi. J’avais le cœur déchiré. Une vraie peine. Une blessure qui, étrangement, est encore là aujourd’hui. Je n’ai plus jamais été capable de suivre le hockey comme avant. Tout au plus quelques matchs, sporadiquement, sans réel intérêt. Les séries sont devenues un bruit de fond. Dans mon cœur, pourtant, je suis demeuré loyal. Je n’ai jamais remplacé mon équipe originale. Je suis resté fidèle à ce bleu disparu, comme on reste fidèle à un absent qu’on refuse d’enterrer. Et j’attends encore, avec une patience têtue, le jour où cet héritage reviendra sur les patinoires.

Marcel Aubut restera pour beaucoup l’un des pires traîtres de notre histoire sportive et identitaire, un fédéraliste notoire qui a préféré ses ambitions personnelles à la loyauté envers son propre peuple. En bradant les Nordiques à Comsat en 1995, il a tourné le dos à une génération de partisans et à un symbole national que Québec n’a jamais pu remplacer. Et quand on le voit poser fièrement aux côtés de Vladimir Poutine, on comprend mieux à quel point son rapport au pouvoir dépasse de loin toute forme d’attachement sincère au Québec.
« Je me souviens 95 », un pèlerinage en chandail
Dans les années qui ont suivi le départ des Nordiques, alors que le deuil sportif se mêlait au deuil politique, je me suis fait fabriquer un chandail sur mesure. Dans le dos, on pouvait lire « Je me souviens », accompagné du chiffre 95. Impossible de séparer l’un de l’autre, le sport et la nation, la défaite sur la glace et celle dans les urnes. Je le portais surtout lors de la Fête nationale à Québec. C’était devenu un rituel, presque un acte sacré. Monter vers la capitale, enfiler ce bleu chargé de sens, me perdre dans la foule, et rappeler en silence que quelque chose nous avait été arraché, mais que la mémoire, elle, refusait de mourir. Durant mes années de jeune adulte, ce geste était devenu incontournable.

Mélodie et moi avions l’habitude de célébrer notre fête nationale sur les Plaines d’Abrahams à Québec
Un soir, à un spectacle des Loco Locass, dans cette atmosphère électrique où le nationalisme pulse au rythme des basses et des mots qui frappent, j’ai offert ce chandail à Biz. Un geste instinctif, mais profondément chargé. Je voulais le lui remettre comme on transmet un flambeau, en reconnaissance de leur rôle en première ligne, de leur parole debout dans un Québec où tant de voix se taisaient ou se résignaient. Ce chandail, mon talisman, quittait mes épaules pour continuer sa route ailleurs.

La magistrale chanson Le but de Loco Locass, devenue un hymne incontournable du hockey québécois, porte aussi en filigrane le virage qu’a pris Biz après la disparition des Nordiques. Lui à qui j’avais offert mon chandail « Je me souviens 95 » comme un passage de témoin, un geste chargé de loyauté et de mémoire, a fini par se tourner vers le Canadien. Il a même réussi à réinscrire une part de notre histoire collective dans le récit de cette équipe et à y ramener une parole nationaliste que la Sainte-Flanelle ne portait plus depuis longtemps. C’est admirable, et je respecte profondément la force de son engagement patriotique. Mais je ne cacherai pas une pointe de déception. J’étais resté fidèle au bleu disparu, comme à une promesse intérieure. Incapable, moi, d’embrasser nos anciens rivaux, surtout à mesure que le Canadien se déconnectait de ce que nous étions réellement. Et parfois, je repense à ce chandail offert, en me disant que peut-être, un jour, il retrouvera lui aussi le chemin de la maison.
Et voilà pourquoi, lorsque j’ai vu la vidéo de l’Avalanche annonçant le retour de l’uniforme des Nordiques, tout est remonté d’un coup. Les matchs. L’attente. La perte. La loyauté. Le deuil. L’espoir. Ce n’était pas seulement un chandail qu’on faisait renaître. C’était une mémoire qu’on réveillait, la mienne comme celle d’un peuple.
Quand la mémoire recommence à respirer
Il y a dans ce retour du chandail des Nordiques quelque chose qui dépasse infiniment le sport. Quelque chose qui relève de l’attente, de la veille, presque de la fidélité obstinée. Trente ans ont passé, et pourtant rien ne s’est refermé. Ni dans le cœur des partisans. Ni dans celui de Québec. Ni dans celui de ceux qui n’ont jamais accepté que notre histoire se règle par un déménagement, une vente, un silence. Le Centre Vidéotron se dresse toujours, immense et patient, comme un vaisseau sans équipage. La ville est prête. La mémoire est intacte. Et paradoxalement, il faut aller jusqu’à Denver pour voir se rallumer ce qui devrait naturellement brûler ici. Le paradoxe est violent, presque cruel. Mais il dit déjà quelque chose.
Parce qu’au fond, ce retour de l’uniforme des Nordiques n’est pas qu’un clin d’œil nostalgique ni un exercice esthétique posé par une franchise américaine. C’est une fissure dans le récit que d’autres ont écrit à notre place. Une fissure qui laisse passer l’air du large. Une réouverture de la mémoire. Un rappel silencieux qu’un peuple n’oublie jamais vraiment ce qu’on lui a arraché. Le sport, parfois mieux que la politique, sait ranimer ce que la raison tente de mettre à distance. Une idée recommence alors à circuler. Une question se remet à vibrer. Un symbole retrouve des couleurs. Et dans ce frémissement, quelque chose comme un pays intérieur recommence à respirer.
Le hockey, c’est l’expression d’un peuple
— Jean Béliveau
Ce retour du bleu nordique arrive d’ailleurs au moment précis où le Québec politique se remet lui aussi à bouger. Où le Parti québécois, donné pour mort, reprend l’ascendant. Où l’idée d’indépendance redevient un horizon crédible, presque tangible. Nos symboles refont surface, et notre appétit collectif pour reprendre notre place sur la patinoire, sportive, culturelle, sociale ou politique, se réveille en même temps. Il y a là une synchronicité trop forte pour être un hasard.
Pendant trente ans, on a souvent posé la question à l’envers. On s’est demandé si les Nordiques, restés à Québec, nous auraient donné un pays. Mais peut-être que l’équation doit maintenant être inversée. Peut-être que c’est un Québec redevenu maître de lui-même, libéré des verrous fédéralistes, qui retrouverait naturellement la force et la volonté de ramener les Nordiques. Dans un Québec indépendant, l’idée cesserait d’être un rêve entravé. Elle deviendrait un geste stratégique, culturel, identitaire. Une manière de redevenir ce que nous sommes. Et ce que nous pourrions encore devenir.
Il y a des défaites qui durent longtemps. Il y a aussi des retours qui prennent toute une génération. Et parfois, ils commencent par un simple geste. Un logo. Une fleur de lys sur un chandail qui refuse de mourir. Car rien n’est jamais définitivement perdu quand une mémoire refuse de mourir.

«On aimerait jouer un match de saison à Québec»: Joe Sakic souhaite aller plus loin pour que l’Avalanche salue la mémoire des Nordiques
Je ne sais pas quand Québec retrouvera son équipe. Je ne sais pas si je reverrai un jour les Nordiques entrer sur la glace ici, pour de vrai. Mais je sais ceci. Tant que ce bleu reparaîtra. Tant que des Joe Sakic se souviendront pour nous. Tant que l’on continuera de voir dans ce chandail autre chose qu’un tissu, autre chose qu’un vestige, l’histoire restera ouverte.

Le chandail n’est peut-être qu’un morceau d’étoffe. Pourtant, il soulève une question que ni la LNH, ni le fédéralisme, ni la dynastie Molson ne pourront étouffer éternellement.
Et si l’histoire, un jour, décidait enfin de nous redonner la rondelle ?
Et si, mieux encore, c’était le Québec lui-même qui décidait de la reprendre ?
Reprendre la rondelle : reprendre la nation
C’est le moment de renouer nos lacets, de remettre sur nos épaules le chandail du pays, de redresser la tête et de retrouver cette fierté que certains croyaient éteinte. C’est le moment, surtout, de retourner patiner sur la glace.
Parce que la coupe qu’on nous a arrachée, qu’elle soit sportive ou nationale, n’a jamais sombré dans l’oubli.
Elle attend son moment.
Elle attend son retour.
Elle attend que nous redevenions ce que nous avons déjà été.
Et lorsque cette coupe reviendra enfin là où elle aurait toujours dû être, elle portera un message limpide. Elle dira, aux yeux de toute l’Amérique du Nord, que les Nordiques, c’est-à-dire nous, les francophones du Nord, avons repris notre place dans le grand récit continental.
Elle dira aussi que notre victoire ne sera pas seulement celle d’une équipe, mais celle d’un peuple qui se relève, qui retrouve sa voix, qui regagne le privilège le plus précieux qui soit, celui de continuer à se battre pour son avenir.
Car l’histoire ne s’achève jamais. Elle se joue à chaque période, à chaque match, à chaque génération. Et alors, sur la patinoire comme dans l’histoire, nous ne jouerons plus dans les marges du passé. Nous jouerons au centre de notre propre récit national.
Le sport est le miroir d’une société
— Maurice Richard