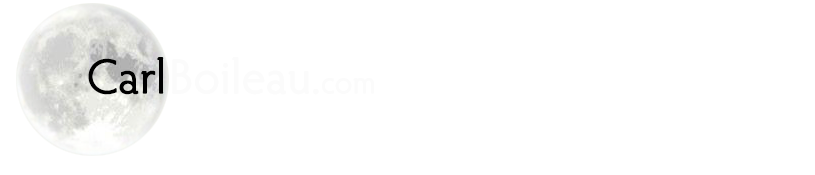Le train fou de Québec solidaire

(ou l’aiguillage manquant de Québec solidaire à l’heure souverainiste)
À l’heure où le Parti québécois reprend de la vitesse et où l’idée d’un troisième référendum refait surface, Québec solidaire semble s’égarer sur une voie parallèle. Entre posture morale et confusion idéologique, ce parti d’opposition permanente risque de transformer la solidarité en inertie, laissant au Canada le soin d’accueillir, dans sa gare bien gardée, le train fou d’une gauche qui aura manqué l’Histoire.
Au lendemain de l’élection de Sol Zanetti au poste de coporte-parole, Québec solidaire donne l’impression d’un parti à la dérive, comme un train bousculé par une série de secousses, encore sonné par une année de turbulences internes. Il succède ainsi à Gabriel Nadeau-Dubois, dont la démission a marqué la fin d’une époque et ouvert une profonde remise en question au sein du parti. Sous son impulsion, QS avait pourtant tenté amorcer un virage pragmatique, espérant se hisser au rang de force politique crédible et se préparer à gouverner. Ce mouvement vers la maturité institutionnelle visait à rompre avec le purisme militant pour faire de la formation une gauche de pouvoir plutôt qu’une gauche de protestation. Mais la tentative a échoué : la base, fidèle à son ADN contestataire, a refusé de suivre cette nouvelle voie, préférant la posture morale et identitaire aux compromis pourtant indispensables pour gouverner dans une démocratie réelle.
Depuis, QS semble avoir perdu sa cohésion et sa boussole. Se voyant comme le successeur naturel du Parti québécois, le parti pensait pouvoir récupérer son héritage social-démocrate et souverainiste tout en séduisant, en parallèle, une nouvelle génération de progressistes urbains, souvent issus de la diversité, voire sensibles au récit postnational popularisé par l’ancien premier ministre canadien Justin Trudeau. Cette gauche déterritorialisée, plus sensible aux causes globales qu’aux questions nationales, portait pour QS la promesse d’un renouvellement électoral, promesse qui tarde à se concrétiser. Mais la réalité a finalement rattrapé le rêve.
Tandis que QS s’enlisait dans ses querelles de principes et ses luttes internes, le Parti québécois a ressuscité, enchaînant trois victoires successives lors des dernières élections partielles et s’apprêtant, selon toute vraisemblance, à en remporter une quatrième à Chicoutimi. Le PQ s’impose de nouveau comme le véhicule naturel du projet national et, si les sondages se concrétisent, devrait former le prochain gouvernement.

Cliquez sur l’image pour lire mon article : La victoire éclatante du PQ dans Arthabaska sonne la fin de la récréation
Pendant que le Parti québécois regagne du terrain, Québec solidaire s’essouffle. Selon un sondage Léger publié le 3 octobre dernier, la formation de gauche ne récoltait plus que 6 % des appuis, loin derrière le Parti conservateur du Québec, crédité de 15 %. Pour un parti qui, il n’y a pas si longtemps, croyait avoir relégué le PQ au passé après avoir fait élire douze députés, la chute est vertigineuse. QS apparaît désormais comme un convoi en repli, limité à quelques wagons accrochés à ses bastions de la ligne orange montréalaise. À mes yeux toutefois, ce déclin ne traduit pas tant un désintérêt pour la gauche en général qu’une panne de locomotive du parti qui tourne à vide, incapable de retrouver la voie du réel et le sens de sa destination.
Le convoi en perte de contrôle
L’élection de Sol Zanetti pourrait donner à QS l’apparence d’une nouvelle direction, puisqu’il assume désormais une orientation officiellement souverainiste qui réactualise l’identité du parti sans toutefois en apaiser les tensions internes. Pour certains militants, Zanetti incarne l’espoir d’un second souffle indépendantiste, le retour du fil rouge au cœur du projet solidaire. Pour d’autres, il n’est qu’un vendeur de rêve et une caution morale provisoire, une tentative de conciliation illusoire entre deux âmes irréconciliables, à la veille d’un éventuel référendum sur la souveraineté du Québec. Car le dilemme demeure entier. De quelle gauche s’agit-il désormais ? Celle que défend le duo Zanetti-Ghazal, c’est-à-dire un souverainisme inclusif cherchant à réconcilier justice sociale et affirmation nationale, ou bien celle d’un intersectionnalisme néo-progressiste proche du NPD, pourfendeur du nationalisme québécois et relais naturel du multiculturalisme canadien ?

Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire (à gauche), lève le bras de Sol Zanetti en signe de victoire après l’élection de ce dernier comme nouvelle co-porte-parole à Québec, le samedi 8 novembre 2025. (Karoline Boucher/Archives La Presse Canadienne)
Ce tiraillement idéologique se manifeste désormais dans la fracture interne du parti. Le fossé entre la base militante et l’aile parlementaire n’a jamais été aussi profond. Pour le meilleur et pour le pire, les membres ont choisi d’envoyer un signal clair en élisant le candidat le plus ouvertement souverainiste, celui qu’aucun député n’avait pourtant osé appuyer. Ironie du sort, Sol Zanetti, ancien chef d’Option nationale, dirige aujourd’hui une formation dont près de la moitié des électeurs se disent fédéralistes. Et pour plusieurs anciens solidaires d’ON, une inquiétude sourd déjà : celle de voir le dernier héritier d’un souverainisme assumé se retrouver forcé, par calcul partisan ou par pression interne, à diluer ou même renier l’héritage qu’il avait autrefois porté sans ambiguïté. Il se retrouve ainsi à la tête d’un train où chaque wagon tire dans une direction différente, chacun rêvant de son propre horizon.
Leur message, pourtant, est limpide. Les militants ont voulu rappeler à l’aile parlementaire que le véritable pouvoir, au sein de QS, demeure entre leurs mains. Étienne Grandmont, seul député à avoir obtenu un appui visible au caucus, notamment celui de Manon Massé, a ainsi été écarté. Ironie du sort, cet élu n’a jamais réellement porté le discours indépendantiste. Il prétendait plutôt incarner la continuité de l’approche institutionnelle et pragmatique amorcée sous Nadeau-Dubois, celle d’une gauche cherchant enfin à gouverner plutôt qu’à protester Son rejet révèle une méfiance persistante entre la base et ses propres élus, mais surtout l’incapacité du parti à trouver l’aiguillage qui lui permettrait de dépasser sa culture de confrontation. À force de se définir contre le pouvoir plutôt que d’aspirer à l’exercer, QS se réfugie dans la marginalité militante au lieu d’assumer les compromis et les responsabilités qu’exige la vie parlementaire.

Parlant du député Étienne Grandmont, on attend encore dans Facebook sa réponse de la définition d’un fasciste
Le mirage du train orange
Maintenant que l’horizon du pouvoir s’éloigne pour de bon, une question s’impose. Quel rôle jouera Québec solidaire à la veille des prochaines élections, et surtout, quelle place prendra-t-il dans le débat national à venir, lorsque le prochain gouvernement péquiste remettra la question de l’indépendance au cœur du projet collectif ? La logique voudrait qu’un parti à la fois de gauche et souverainiste concentre ses critiques sur ses véritables adversaires idéologiques : d’une part, la Coalition avenir Québec, gardienne de l’ordre néolibéral et actuelle détentrice du pouvoir à Québec, et d’autre part, les forces fédéralistes, qu’elles soient libérales ou conservatrices. On aurait pu s’attendre à ce que QS cherche plutôt à unir ses efforts à ceux du mouvement de libération nationale, au nom d’un idéal commun d’émancipation politique et sociale.
Cela ne semble malheureusement pas être le cas. Paradoxalement, QS concentre encore ses attaques sur le parti le plus proche de lui sur le plan des idéaux, celui que la logique de ses intérêts politiques devrait pousser vers la convergence : le Parti québécois. Car malgré la propagande néoprogressiste/fédéraliste qui voit de l’extrême droite partout où s’affirme un discours national, le PQ demeure aujourd’hui la principale formation social-démocrate au Québec… donc bien plus à gauche que le PLQ et la CAQ.
Si bien qu’au lendemain de l’élection de Sol Zanetti, l’autre coporte-parole de la formation, Ruba Ghazal, désormais aspirante au poste de première ministre pour 2026, s’est adressée aux membres avec un ton résolument hargneux. Plutôt que de tendre la main à ses alliés naturels du camp souverainiste, elle a tracé une ligne nette entre son parti et celui de Paul St-Pierre Plamondon, qu’elle affrontera aux prochains débats des chefs. Craignant qu’avec le PQ à sa tête, le camp du Oui ne devienne « un camp qui exclut », elle a dénoncé ce qu’elle appelle un « camp du Oui renfermé sur lui-même » et évoqué la possibilité de faire la campagne référendaire « en train orange » (comprendre seule, à gauche et sans le PQ).
Ironie du sort, ce reproche d’entre-soi et d’exclusion décrit bien mieux la posture actuelle de Québec solidaire que celle de ses adversaires. En refusant de s’arrimer à la locomotive du Parti québécois, celle qui pourrait enfin remettre le convoi souverainiste en marche, QS condamne le mouvement tout entier à demeurer immobile dans la gare canadienne où l’ordre fédéral nous garde soigneusement stationnés. Et pendant que certains s’y complaisent, convaincus d’être sur la bonne voie, d’autres entendent déjà le bruit des outils : à Ottawa, on démonte lentement notre locomotive nationale, pièce par pièce, pour que plus jamais le train du OUI puisse repartir.
Ce discours irresponsable, loin d’appeler à l’unité, a évidemment ravivé les rivalités partisanes au sein du camp souverainiste. Paul St-Pierre Plamondon n’a pas tardé à répliquer, accusant QS de « créer un climat de peur envers l’indépendance » et de « diviser la population ». Selon lui, « Québec solidaire, désespéré, fait mal au climat social en attaquant le Parti québécois », tout en souhaitant que Sol Zanetti, « véritable indépendantiste », parvienne à « élever le débat ».
Pour plusieurs observateurs souverainistes, tel que Richard Martineau ce matin, cet épisode illustre une impasse stratégique plus profonde. Alors que le Parti québécois consolide son avance et remet l’indépendance au cœur du débat public, QS demeure incapable de se situer autrement qu’en contrechamp moral, préférant s’opposer au PQ plutôt que de chercher un terrain d’entente.

Dans une analyse lucide, Josée Legault s’inquiète du duel fratricide entre Québec solidaire et le Parti québécois, alors même que les deux formations se disent souverainistes. Elle rappelle qu’à l’approche d’un possible référendum, leurs querelles risquent de fracturer prématurément le camp du Oui, au grand bénéfice du Canada.
D’ailleurs, certains souverainistes, un brin candides, continuent d’espérer que l’avènement du duo Ghazal-Zanetti offrira l’occasion de rassembler plus largement le camp du Oui. Ils veulent croire que ces deux figures issues de l’aile souverainiste de QS parviendront à réconcilier la gauche solidaire avec le projet national. Or, comme le souligne l’analyste Nic Payne dans Facebook, cette illusion s’effondre dès qu’on prête l’oreille au discours réel du parti. Dans les faits, QS agit moins comme un allié du mouvement souverainiste que comme son contrepoids moral, hanté par la peur d’être éclipsé politiquement par le retour en force du PQ. Pour se distinguer, ce parti s’efforce de redéfinir le sens même de l’indépendance en présentant le projet du PQ comme « trop étroit » et trop identitaire, c’est-à-dire suspect de dérive nationaliste, tandis qu’il érige le sien comme un projet nécessairement « inclusif », « bienveillant » et « progressiste ». Dans cette logique morale, le pays rêvé par QS n’existe qu’à condition d’être inscrit, dès sa naissance, dans un cadre idéologique de gauche. À l’inverse, le projet porté par le PQ ne se veut ni de gauche ni de droite, mais d’abord national, c’est-à-dire fondé sur la souveraineté politique plutôt que sur une orientation partisane.
On peut déjà craindre, d’ailleurs, que QS prépare déjà sa sortie de la coalition du Oui, en prétendant que la démarche proposée par un futur gouvernement péquiste serait trop à droite, voire carrément “raciste“. Le scénario serait connu : marchander un appui au Oui contre des conditions irréalisables, comme l’abrogation de la loi 21 sur la laïcité (pourtant soutenue par plus de 70 % des Québécois) ou l’adoption d’une constitution socialiste. Autant de prétextes commodes pour justifier, le moment venu, un retrait stratégique du convoi souverainiste au nom de la pureté morale.
Ce discours, qui reprend d’ailleurs à son compte le lexique du multiculturalisme canadien, brouille le message et confond la question nationale avec un simple programme de gouvernement. Il s’inscrit surtout dans le conditionnement d’un paysage médiatique profondément fédéraliste, où l’hostilité envers le PQ demeure le moyen le plus sûr d’obtenir visibilité et sympathie. Les caméras et les micros, toujours prompts à se tendre lorsque QS attaque ses rivaux souverainistes, récompensent cette posture de division. D’une certaine manière, QS ne fait plus de politique, il réagit aux incitatifs médiatiques d’un système qui le manipule sans qu’il s’en rende compte.
Résultat, le contraste entre la couverture médiatique du parti et sa réelle influence politique devient difficile à ignorer. À 8 % dans le le dernier sondage, QS continue pourtant de bénéficier d’une attention démesurée, comme si sa fonction symbolique (celle d’incarner la « bonne conscience » de la gauche fédéraliste) valait plus que son poids réel dans les urnes.
Cette dynamique n’est pas nouvelle. Gabriel Nadeau-Dubois l’avait admis dès 2018, dans une franchise désarmante : « À Québec solidaire, si on veut avoir de l’attention médiatique, la meilleure manière, c’est d’attaquer le Parti québécois. Là, on sait que tous les micros vont se tendre et toutes les caméras vont être sur nous. » Sept ans plus tard, la formule reste inchangée.
Comme l’a souligné Steeve Fortin, cette tactique, devenue réflexe pavlovien, attire certes les projecteurs, mais ne masque plus le vide idéologique d’un parti en perte de sens. Ce théâtre permanent n’a plus rien de stratégique : il traduit moins une opposition de principes qu’une impasse existentielle. Cette ambiguïté se cristallise dans ce que l’on pourrait appeler la posture du « OUI, mais ». QS affirme vouloir l’indépendance, mais toujours à ses conditions, en y greffant ses priorités idéologiques comme s’il s’agissait d’un test de pureté politique. Ce n’est pas un ralliement, c’est une mise en demeure. Le « OUI, mais » devient une façon commode de faire semblant de se tenir dans le train mais sans jamais s’engager à tirer la locomotive. On soutient le pays en théorie, mais à condition qu’il corresponde d’emblée à un idéal moral et socialiste, ce qui revient, dans les faits, à retarder son départ indéfiniment.
Le wagon de la morale
En refusant le virage de professionnalisation et de pragmatisme amorcé par Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire s’est détourné du rail institutionnel pour redevenir un convoi de revendications idéologiques. Prisonnier de sa posture moralisatrice, presque dogmatique, le parti semble condamné à condamner, incapable de construire. Ironie du sort, le parti qui se dit « solidaire » paraît aujourd’hui incapable de l’être, ni avec ses alliés naturels, ni même avec la nation qu’il prétend émanciper.
Inapte à endosser le rôle d’un parti de gouvernement, QS s’est réfugié dans la communication et la vertu, attaquant le PQ non plus par conviction, mais par réflexe de survie partisane. Pendant que la locomotive péquiste reprend de la vitesse et rallume le feu souverainiste, QS, lui, patine sur place, enfermé dans sa voie morale et incapable de trouver l’aiguillage du réel.
Reste alors une question fondamentale, à la fois politique et existentielle : à quoi sert un parti qui choisit de s’opposer ad vitam æternam au gouvernement québécois, sinon à freiner toute victoire collective face au pouvoir fédéral ? Car cette dérive dépasse le seul cas de Québec solidaire. Elle révèle un mal plus profond, celui d’une gauche québécoise qui, en refusant de grandir et d’assumer le risque du pouvoir, condamne la nation à rester immobile sur un quai, à regarder passer le train du pays sans jamais y monter.

L’aiguillage décisif
Québec solidaire n’est plus seulement un parti en crise, c’est un train fou au bord du gouffre électoral. Loin derrière dans les sondages, vidé de sa cohésion interne et de sa boussole politique, il semble avoir perdu le fil de sa mission historique. Pourtant, à l’heure où le Parti québécois s’apprête à remettre l’indépendance au cœur du débat national, QS demeure face à une responsabilité immense : choisir entre l’idéalisme paralysant et la contribution réelle à la cause du pays.
Deux rails s’offrent à lui.
La première, la plus noble, serait celle du courage et de la cohérence. Sol Zanetti et Ruba Ghazal pourraient assumer pleinement leur souverainisme et contribuer à élargir la coalition du Oui, non pas en la fragmentant, mais en la rendant plus dynamique, plus diverse et plus ancrée dans les réalités du Québec contemporain. Par leur ancrage à gauche, leur capacité à rejoindre les jeunes et leur proximité avec les néo-Québécois, ils pourraient même, mieux que le PQ, étendre le mouvement souverainiste à des milieux qui s’en étaient éloignés. Ce serait renouer avec une gauche assumée, celle qui comprend que la justice sociale passe d’abord par la maîtrise de notre destin collectif.
Mais l’autre rail, plus confortable et tristement prévisible, consisterait à poursuivre la chasse aux ennemis imaginaires. À l’instar de bien des mouvements progressistes, QS s’est laissé happer par la propagande fédéraliste de la soi-disant « lutte antifasciste », où, dans le Canada multiculturaliste, les nationalistes québécois redeviennent les ennemis désignés d’office, suspects idéologiques à neutraliser au nom du Bien (autrement dit, au nom de « l’unité nationale » du Canada). Dans ce brouillard sémantique savamment entretenu, la volonté démocratique de la majorité historique est facilement recodée en menace xénophobe, et le simple attachement à la pérennité de la nation réduit à une dérive identitaire. Pendant ce temps, les libéraux, pourtant parti phare du néolibéralisme canadien et pilier historique de l’ordre fédéral, disparaissent commodément du champ des critiques. Pour une partie de la gauche institutionnelle, ils semblent bénéficier d’une étrange immunité morale, comme si leur participation au maintien d’un régime inégalitaire n’existait pas. Pour certains influenceurs woke, obsédés par le signalement de vertu et la recherche d’approbation dans le carcan médiatique (fédéraliste), l’extrême droite englobe désormais tout ce qui se situe à droite du NPD… tandis que le Parti libéral, gardien colonial du pouvoir central, demeure inexplicablement exempté du procès.
Mais il existe aussi une troisième voie, moins avouée : feindre l’adhésion au Oui tout en conditionnant son appui à un cahier de charges irréaliste. Une telle manœuvre permettrait à QS de se retirer ensuite en accusant le gouvernement péquiste d’avoir trahi ses idéaux, tout en préservant son image morale auprès de sa base militante et de la presse fédéraliste.
Ce choix n’a rien d’anodin, car il déterminera l’avenir constitutionnel du Québec. QS peut continuer à fuir le réel, en se réfugiant dans la posture morale et la vertu dictées par le récit médiatique fédéraliste, ou il peut enfin choisir de participer à l’Histoire. Il lui faudra reconnaître qu’aucune transformation sociale durable ne saurait advenir sans la maîtrise politique de notre destin collectif. En d’autres termes, sans l’émergence d’un pays souverain, il n’existe pas de véritable projet de société pour le peuple québécois.

Comme le souligne le politologue Jean-Christophe Gagnon dans Le Repère, la querelle entre QS et le PQ n’est pas une simple rivalité électorale, mais une fracture cognitive au sein du mouvement national. Les deux formations visent la même finalité, la souveraineté du Québec, mais n’emploient plus le même langage. L’une parle de justice sociale, l’autre d’État-nation, et aucune ne parvient à les réconcilier. Pourtant, Gagnon propose une voie de sortie : refonder une convergence doctrinale fondée sur une souveraineté intégrale (politique, économique, culturelle, écologique et numérique) où chaque parti contribuerait selon ses forces, sans nier la légitimité de l’autre.
Maintenant, qu’on le veuille ou non, même affaibli, QS détient un levier bien réel. Sans son appui explicite, la campagne du Oui risquerait de démarrer avec un handicap certain. On peut toujours rêver d’un référendum sans QS, mais l’enjeu dépasse les querelles partisanes. Et pourtant, au regard de l’attitude récente du parti, une question persiste, lourde de conséquences : pouvons-nous réellement lui faire confiance pour ne pas saboter le départ au moment de l’embarquement ?
Terminus : l’heure du choix constitutionnel
Le train fou de Québec solidaire file toujours, sans conducteur réel ni carte de route, mû par la seule inertie de sa logique partisane. À force de refuser l’aiguillage du réel, il roule dans le brouillard, persuadé d’incarner la vertu alors qu’il s’éloigne lentement de la voie de l’Histoire. Derrière lui, les wagons se détachent un à un, pendant qu’en parallèle, la locomotive péquiste reprend de la vitesse et que, plus loin, le peuple québécois attend toujours qu’un convoi l’emmène enfin vers un pays pour survivre nationalement et y prospérer socialement.
Mais un train fou, par nature, ne sait pas où il va. Il fonce à toute vapeur, fuyant le présent et préférant la pureté de sa trajectoire à la destination commune. Or, la cabine de Québec solidaire, fragilisée par les départs successifs et une ligne idéologique de plus en plus floue, reste entrouverte, exposée aux passagers de circonstance. Certains, stratèges aguerris du fédéralisme bien-pensant, y voient une occasion inespérée d’infléchir la route, de saisir la manette du convoi et d’en dérégler la boussole nationale. Sous couvert d’inclusion et de lutte au fascisme, cette mouvance postnationale, dont Alexandre Dumas constitue aujourd’hui la figure la plus bruyante, s’emploie à reprogrammer silencieusement la destination du train. Elle ne vise plus à mener le Québec vers son émancipation politique, mais à réorienter la gauche québécoise vers les rails dociles du fédéralisme d’État, là où l’idée même d’un Québec libre devient non seulement suspecte, mais presque immorale. Leur horizon n’est plus devant, mais derrière. Vers un Canada assimilateur qui croit solder la question nationale en anesthésiant le désir d’exister d’un peuple sous les bons sentiments du multiculturalisme ambiant.
Pourtant, il n’est pas trop tard pour rappeler aux passagers que la solidarité sans souveraineté politique n’est qu’un wagon sans locomotive. Or le véritable sens de la prochaine élection, c’est de reprendre le contrôle du train avant qu’il ne soit définitivement ramené dans la gare canadienne pour y être remisé à jamais.
Lorsque le convoi du Oui s’ébranlera enfin, Québec solidaire devra choisir : reprendre place dans le train du pays ou poursuivre sa course solitaire vers un horizon sans peuple. Car au bout de la ligne ne se trouve pas la promesse du progrès, mais la gare terminale d’un Canada conquérant, indifférent à nos aspirations et trop heureux de voir un Québec divisé s’y présenter de lui-même, docile et désarmé. Et sur le quai, dans la brume, il ne restera qu’une gauche esseulée, applaudissant le départ du train… sans comprendre qu’elle vient de laisser filer, pour la dernière fois, le wagon de la liberté.
La liberté, c’est une valeur en soi. Quand tu commences à mettre des conditions à l’indépendance, t’es pas un progressiste, t’es un trou de cul !
— Pierre Falardeau