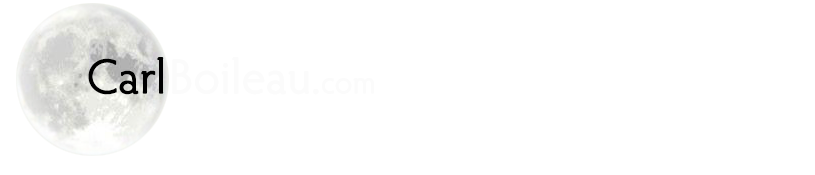La clôture et ce souffle qui veille encore : Retour sur Québec 2001

Vingt-quatre ans après le Sommet des Amériques, je remonte le fil de mes souvenirs : l’éruption du Black Bloc, la chute du « mur de la honte », la transe collective de l’îlot Fleurie… et l’oubli qui menace aujourd’hui la mémoire de ce combat. Entre archives perdues, camarades devenus fantômes et récupération politique, je raconte comment une clôture est devenue le symbole d’un monde à repousser, et pourquoi la flamme de 2001 ne doit pas s’éteindre.
À l’heure où une élection partielle se joue dans la circonscription d’Arthabaska, j’ai ressenti le besoin de rouvrir une page d’histoire qu’on a peut-être refermée trop vite.
Ce texte n’est pas seulement un récit personnel ou une évocation nostalgique. Il constitue une plongée au cœur d’un moment-charnière de l’histoire récente du Québec, révélant comment la lutte altermondialiste de Québec en 2001 annonçait déjà le monde d’aujourd’hui.
À travers les souvenirs vibrants d’un jeune militant engagé, vous découvrirez la portée universelle d’un affrontement symbolique qui dépasse largement le cadre individuel. Ce qui s’est passé à Québec en avril 2001 résonne encore aujourd’hui, car il annonçait une fracture politique et sociale qui structure toujours notre époque.
Ce texte n’est ni une chronique d’actualité ni un manifeste partisan. C’est un témoignage de terrain – peut-être l’un des plus complets à ce jour sur le Sommet des Amériques vu de l’intérieur, par un acteur de la contestation. J’y étais. Et près de vingt-cinq ans plus tard, je m’interroge : que reste-t-il de cette gauche qui, à Québec, s’était levée contre la marchandisation du monde et pour le droit des peuples à choisir leur avenir ?
Si je publie ce texte aujourd’hui, c’est aussi pour défendre l’un des nôtres : Alex Boissonneault, candidat du Parti Québécois, attaqué par Éric Duhaime pour ses idéaux de jeunesse. Une manœuvre révélatrice, de la part d’un prétendu libertarien qui ne défend jamais la liberté des peuples… seulement celle des puissants.
Ce texte est une invitation à la réflexion.
Sur ce que nous étions.
Sur ce que nous sommes devenus.
Et sur ce que nous pourrions redevenir.
Quand le passé militant devient une arme électorale
L’élection partielle dans Arthabaska est déclenchée ; les électeurs seront appelés aux urnes le 11 août. Ce scrutin est particulièrement stratégique pour Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, qui y voit l’occasion, tant attendue, de faire enfin son entrée à l’Assemblée nationale. Habitant Laval, il tente aujourd’hui sa chance dans une circonscription de région.

Une élection partielle entre le chef du PCQ et le candidat vedette du PQ
Dès l’annonce du déclenchement en pleine période estivale, Duhaime a dénoncé le gouvernement Legault, l’accusant de « cynisme » et de vouloir « diminuer la portée de l’élection partielle ». Mais le véritable cynisme se loge peut-être ailleurs. Car au lieu de débattre du fond ou de proposer des solutions sociales, Duhaime a choisi de raviver une vieille affaire remontant à 2001 pour salir son principal adversaire, Alex Boissonneault, un candidat local du Parti québécois. Plutôt que de confronter des idées, il recycle des peurs.
À l’époque, Boissonneault avait 22 ans. Il militait au sein de Germinal, un collectif altermondialiste créé pour s’opposer au Sommet des Amériques à Québec, où des dirigeants économiques internationaux négociaient, à huis clos, un traité de libre-échange continental. Barricadé derrière des kilomètres de clôtures et protégé par un déploiement policier massif, ce sommet symbolisait la dérive antidémocratique d’une mondialisation néolibérale imposée d’en haut.
Le groupe Germinal, infiltré pendant des mois par deux agents doubles de la GRC, préparait une action strictement symbolique : percer une brèche dans le « mur de la honte », cette clôture destinée à tenir le peuple québécois à distance. Rien de réellement violent, rien de concrètement dangereux. Pourtant, quelques jours avant l’ouverture du sommet, plusieurs membres furent arrêtés de manière spectaculaire, Boissonneault compris. L’opération, montée dans un climat de peur, servit à justifier le verrouillage complet de la Haute-Ville par les forces de l’ordre.
Ce passé, largement oublié, a été ramené à l’avant-plan par Éric Duhaime lui-même, fidèle à sa stratégie de diversion, manifestement en panique face à l’arrivée surprise d’un candidat vedette pour le PQ. Plutôt que de parler d’enjeux locaux, Duhaime mise sur l’émotion et les procès d’intention. Il tente de faire passer Boissonneault pour un militant communiste d’extrême gauche, voire carrément un terroriste criminel. Or, il s’agissait simplement d’un jeune citoyen engagé, indigné de voir des décisions majeures se prendre dans l’ombre, à l’abri du regard démocratique.
Même à l’époque, plusieurs magistrats avaient dénoncé l’ampleur démesurée du dispositif policier déployé à Québec. Et aujourd’hui encore, les accusations portées contre les manifestants, comme la possession de bombes fumigènes ou le complot pour méfait, paraissent dérisoires au regard des véritables enjeux. Le collectif ne visait personne en particulier. Il s’attaquait à un symbole. Car les seules armes réellement menaçantes pour l’avenir des peuples, des sociétés démocratiques et de l’environnement global n’étaient pas quelques canettes fumigènes brandies par des militants, mais bien les dogmes néolibéraux imposés d’en haut, à huis clos. Ainsi, les véritables dangers venaient d’un système barricadé, incapable de se remettre en question, et qui imposait ses règles sans débat.
Ce système, au nom d’une mondialisation prétendument inévitable, n’hésitait pas à instrumentaliser les forces policières pour écraser la dissidence populaire.
Et aujourd’hui maintenant, Duhaime s’agite, gesticule, accumule les hyperboles. Mais derrière tout ce vacarme, rien de concret. Rien d’autre qu’un libertarien démagogue de Laval tentant de se faire élire à Victoriaville sur le dos d’un militantisme vieux d’un quart de siècle.
Et puisqu’il est question de ce passé militant… j’y étais moi aussi, à Québec en 2001. Comme Alex Boissonneault projetait de le faire, j’y suis allé manifester, convaincu qu’il fallait s’opposer à ce sommet opaque et verrouillé. La seule différence entre lui et moi… c’est que je ne me suis pas fait arrêter. D’ailleurs, mon activisme, loin d’être un frein, ne m’a jamais empêché d’être élu conseiller municipal à Montréal, puis de poursuivre mon engagement dans d’autres sphères, y compris aujourd’hui comme nouvel enseignant. Alors franchement, voir Duhaime et ses relais médiatiques de droite s’efforcer de transformer ce militantisme passé en actuelle menace terroriste relève du grotesque.
Je ne connais pas personnellement Alex Boissonneault, mais je voterais pour lui sans hésiter si j’étais dans Arthabaska. Certes, je suis un peu déçu d’avoir appris son nouveau positionnement politique au centre droit, ainsi que de la manière dont il a exprimé publiquement des regrets en qualifiant son engagement militant d’erreur de jeunesse. Cela dit, le Parti québécois reste une coalition nationaliste dont la vocation est de rassembler un large spectre politique, allant de la gauche progressiste jusqu’à la droite conservatrice. Pour ma part, je suis tout à fait disposé à collaborer avec des gens de tous les horizons démocratiques, dans la mesure qu’on puisse avancer vers l’indépendance du Québec et qu’en attendant, mon courant social-démocrate puisse continuer d’y faire entendre sa voix avec clarté et conviction.
Mais revenons à ce printemps 2001, histoire de raviver ces souvenirs et de mesurer le chemin parcouru. Car ce sommet n’était pas un simple épisode de contestation. C’était un moment de rupture, un éveil collectif, une solidarité retrouvée. Voici ce que j’en garde.
2001 : l’année de tous les embrasements
L’année 2001 fut, sans contredit, l’une des plus intenses de ma vie politique. J’étais jeune, fougueux, habité par cette conviction que le Québec pouvait, et devait, redevenir un projet collectif ambitieux. À cette époque, tout semblait encore possible. Les idées circulaient vite, les alliances se nouaient dans les cafés, les salons… et jusque dans le salon de mon père.
C’est justement là que j’ai rencontré Paul Cliche, à la veille de l’élection partielle dans Mercier (sur le Plateau-Mont-Royal). Candidat indépendant associé au Rassemblement pour une alternative progressiste (RAP), Cliche rêvait de rassembler les différentes factions de la gauche québécoise dans un même front politique. Et très vite, l’idée a germé entre nous : poser un geste symbolique fort, provoquer un électrochoc au sein du Parti québécois, alors enlisé dans un virage néolibéral sous la gouverne de Lucien Bouchard. J’en avais assez de voir mon parti trahir les idéaux progressistes qui m’avaient inspiré.
C’est ainsi que, le 4 mars, je me suis présenté à l’investiture du PQ dans Mercier. Pas pour l’emporter, mais pour déranger, provoquer, secouer la cage. Vêtu tout de noir, en signe de deuil pour mon parti, je suis monté sur scène avec le cœur en feu et la gorge serrée, déterminé à faire entendre une voix alternative. Mon discours, tranchant et sans concession, a remué l’assemblée. Et parmi ceux qui ont levé la main pour m’appuyer, il y avait nul autre que Pierre Falardeau. Il me l’a dit lui-même, après coup : il avait voté pour moi. Ce geste, aussi simple qu’inoubliable, reste à ce jour l’un des honneurs les plus chargés de sens que j’aie reçus dans ma vie.

J’étais trop fier d’avoir reçu l’appui de Pierre Falardeau, déjà une légende vivante du mouvement indépendantiste, une figure mythique qui incarnait sans compromis la révolte et la liberté.
Je suis sorti de la salle avec mes sympathisants, sans me rallier, mais déterminé à ouvrir un chemin vers l’extérieur, vers un mouvement plus large.
Dans la salle, Amir Khadir était présent. Quelques instants après mon intervention, il est venu me voir : « On a besoin de toi », m’a-t-il dit. C’est lui qui m’a mis en contact avec d’autres jeunes révolutionnaires, dont Patrice Masse, alors coordonnateur de l’aile jeunesse du RAP. C’est à partir de là que j’ai officiellement rejoint le mouvement altermondialiste. Et tout s’est mis à s’accélérer.
On rêvait d’unir la gauche québécoise, de dépasser les chapelles, de bâtir un projet à la fois indépendantiste, écologiste et profondément enraciné dans la justice sociale. Et tout cet élan allait bientôt converger vers un moment-charnière de notre histoire commune : le Sommet des Amériques à Québec.
Québec sous haute tension
Le Sommet des Amériques de 2001 n’était pas seulement un moment fort de contestation. C’était un appel à repenser le monde. Une tentative collective de rompre avec l’ordre établi, de faire entendre une autre voix que celle des puissants. Pour nous, jeunes militants de cette époque, ce sommet représentait un point de bascule. Je m’en souviens comme si c’était hier.
Notre révolte ne relevait pas d’une simple bouffée de colère : nous savions que, ces jours-là, l’avenir politique, économique et social de l’Amérique du Nord se jouait à Québec. Il fallait y être, visibles et audibles. Le vendredi 20 avril 2001, nous avons donc filé vers la capitale, serrés dans la petite voiture de Patrice Masse, aussi fébrile que nous. À l’avant, Olivier Huard, futur activiste des luttes écologistes au Québec ; à l’arrière à mes côtés, un certain David, dont je revois le regard impatient. La tension et l’euphorie se relayaient pendant que tournaient nos chansons révolutionnaires; parfois stridentes, toujours galvanisantes. Entre deux couplets, nous refaisions le monde : tactiques, éthique de la confrontation, rêves de renversement. Jeunes, un peu fous, mais plus vivants que jamais.
J’étais monté à Québec avec une énorme caméra VHS que j’avais empruntée au service audiovisuel de l’UQAM. C’était un vrai mastodonte, un engin qu’on portait à l’épaule, mais j’y tenais : je voulais documenter ce sommet, filmer les scènes fortes, en faire une sorte de reportage maison pour garder une trace. Dans mon sac, j’avais aussi glissé un vieux masque à gaz de surplus militaire, acheté la veille, un peu à la blague, un peu par prudence (Je ne savais pas encore à quel point ce masque allait m’être utile). Et pour compléter l’équipement, j’avais aussi apporté mes rollers. En tant qu’ancien moniteur au Taz, je maîtrisais parfaitement ce moyen de locomotion. Mon idée était simple : pouvoir couvrir rapidement de larges secteurs, capter différentes scènes de la manifestation, et documenter en temps réel les déplacements de foule. Dans ma tête, j’étais à la fois militant, témoin et reporter mobile, prêt à glisser là où l’histoire s’écrivait.
En arrivant à Québec, le décor nous a aussitôt happés. La ville avait des allures de zone de guerre. Des kilomètres de grillage gris métallisé, rapidement surnommés le « mur de la honte », encerclaient le périmètre du sommet. Derrière cette barrière, les chefs d’État, les négociateurs et les experts en costume incarnaient l’esprit froid du contrôle capitaliste. Au centre de cette galerie des puissants siégeait le tout nouveau président américain, George W. Bush : à peine investi, il s’imposait déjà comme figure conquérante d’un ordre mondial verrouillé. Et nous, de l’autre côté du mur, à crier dans le vide, comme si nos voix pouvaient vraiment l’atteindre.
À huis clos, ils redessinaient l’Accord de libre-échange des Amériques (ALÉA), une entente conçue pour cadenasser notre avenir politique sans consultation, ni consentement. Mais à l’extérieur, un tout autre souffle traversait la ville. Dans les rues, une agora vivante s’était formée, animée par des milliers de citoyennes et citoyens venus refuser l’évidence imposée, et réinventer collectivement le sens du mot démocratie. Face aux grilles, le peuple insurgé incarnait une vision radicalement opposée du monde, fondée sur la convergence des peuples, le bien commun et la souveraineté populaire.
Ce jour-là, à Québec, deux visions du monde se faisaient face. Deux logiques inconciliables. Deux récits dressés l’un contre l’autre, séparés par une clôture… et tout un système.

À l’époque, alors que des chroniqueurs de droite prétendaient que nous ne savions même pas pourquoi nous manifestions, j’avais été heureux d’expliquer nos revendications à la journaliste Katia Gagnon, venue comprendre notre opposition à l’ordre néolibéral.
Notre point de rendez-vous était le campus de l’Université Laval. Déjà, une fébrilité palpable flottait dans l’air, comme un grondement sourd annonçant l’orage. Ce n’était encore que les préparatifs, l’échauffement avant ce que plusieurs appelaient déjà la grande bataille du samedi. L’atmosphère évoquait un immense rassemblement festif : une sorte de party militant à ciel ouvert, un bouillon social en ébullition où convergeaient des contingents progressistes venus des quatre coins du Québec, et même d’au-delà. On débattait à voix haute, on riait, on échangeait des tracts comme on distribue des poignées de main. C’était une ruche d’idées, de convictions et de complicités naissantes. Une foule à la fois sérieuse et joyeusement désorganisée, vibrante d’espoir et d’impatience.
Puis, en fin de journée, nous nous sommes avancés en grappe vers le fameux mur de la honte, pour le voir de nos propres yeux. Histoire de jauger la scène, mais aussi de se défouler un peu. Des kilomètres de grilles métalliques surmontées de barbelés encadraient le sommet. À chaque accès du périmètre : policiers en armure, véhicules blindés, canons à eau sur le qui‑vive. L’endroit dégageait l’impression d’un décor tiré d’un film dystopique. On avait peine à croire que l’on se trouvait encore au Québec. Pour nous, jeunes militants idéalistes, la vérité était cinglante : la démocratie que nous pensions acquise s’était drapée de noir. Et si on nous autorisait à marcher, c’était seulement à condition de rester loin, bien loin des lieux de pouvoir.
Déjà, des centaines de manifestants étaient sur place, criant leur colère contre cette clôture d’acier qui incarnait tout ce qu’on rejetait : l’exclusion, l’opacité, le mépris du peuple. En face de nous, les policiers, impassibles et muets, en armure complète, formaient une ligne compacte. Le contraste était frappant : d’un côté, la vitalité, la créativité, la colère collective et le chaos; de l’autre, la froideur de l’ordre institutionnelle, rigide et menaçante.
Mais ce soir-là, malgré les cris, les chants et la colère, aucune étincelle n’avait encore mis le feu aux poudres. La ville retenait son souffle, figée dans une tension électrique, suspendue à l’instant d’avant. Les manifestants observaient les dispositifs, les policiers restaient impassibles, et chacun, dans ce face-à-face muet, semblait jauger l’autre, comme conscient de la gravité de ce qui allait suivre. L’atmosphère était dense, chargée, mais étrangement contenue, comme si une force souterraine, immense et indocile, guettait son heure pour jaillir le lendemain.

La veille du chaos. Nous posions, costumés en révolutionnaires d’un jour, loin de soupçonner que, dès le lendemain, nos masques à gaz deviendraient essentiels pour survivre aux lacrymos près du mur de la honte. Un instant suspendu, presque théâtral, figé dans l’insouciance juste avant la tempête.
Tandis que mes camarades du RAP s’installaient pour la nuit dans le grand gymnase de l’Université Laval, transformé pour l’occasion en dortoir géant, j’eus droit à un privilège rare : un vrai lit, dans une vraie maison. Mélodie, ma copine de l’époque, m’attendait chez son père, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, si ma mémoire ne me trahit pas. Elle n’était pas militante à proprement parler, mais elle m’avait suivi dans cette aventure, par amour sans doute, ou peut-être par curiosité.
Tout sauf calme, Mélodie irradiait une énergie sociale difficile à contenir. Vive, volubile, intensément tournée vers les autres, elle possédait un charisme instinctif, souvent imprévisible. Une force de la nature qui attirait et déroutait à la fois.
Il faut dire que moi non plus, je n’étais pas alors de tout repos. À cette époque, j’étais radical, intransigeant et incapable du moindre compromis. Habité par une colère politique que je portais comme un feu sacré, je vivais chaque instant comme une urgence. Ensemble, nous formions un duo fougueux, toujours sur le fil, brûlant la chandelle par les deux bouts… comme si chaque nuit pouvait être la dernière avant que tout n’explose.
Mélodie fut ma première véritable blonde : une relation intense, marquée par l’exploration, les fêtes, les excès, et cette ivresse propre aux débuts où l’on découvre le monde à deux. Sa mère était entrepreneure, son père, un bon vivant de Québec, chaleureux et accueillant. Mélodie ne parlait pas vraiment de politique, mais elle portait déjà en elle une culture de la réussite et de la performance, héritée de son milieu plus conservateur. Cette sensibilité, à son insu, l’amenait à pencher vers une vision plus individualiste des choses. Une confiance instinctive dans le système en place, dans la méritocratie, dans l’idée que l’on peut se faire une place à condition d’y mettre l’effort. Ce n’était pas réfléchi, encore moins revendiqué, mais certains de ses réflexes trahissaient cette orientation tranquille vers la droite.
Paradoxalement, elle avait aussi un tempérament farouchement rebelle, sans trop savoir contre quoi se rebeller. Ce tiraillement faisait partie de son charme. Plus tard, elle allait se reconnaître dans la montée de l’ADQ, qu’elle percevait comme une troisième voie. Un souffle neuf face aux vieux affrontements partisans encore marqués par le référendum de 1995. Pour elle, l’ADQ représentait une forme de renouveau pragmatique, moins idéologique que générationnel, et peut-être, sans qu’elle le sache, une façon d’accorder ses ambitions personnelles avec une envie diffuse de changement.

Mélodie et moi avions déjà l’habitude de célébrer notre fête nationale sur les Plaines d’Abrahams à Québec
Et cette nuit-là, dans la chaleur d’un lit prêté par son père, j’ai trouvé, enfin, un peu de répit… juste avant la tempête.
Les remparts de Québec
Le samedi matin 21 avril, alors que la ville s’éveillait sous haute tension, nous nous sommes retrouvés entre camarades de l’aile jeunesse du RAP autour d’un déjeuner dans un petit resto populaire du centre-ville. C’était un moment simple, presque banal, mais il portait en lui la douceur d’un dernier souffle de normalité. Comme si le quotidien, dans sa plus humble expression, s’apprêtait à être submergé par la déferlante des événements à venir. À ma table se trouvait Gabriel Béland, jeune intellectuel au regard affûté, que l’on retrouverait plus tard dans les pages de La Presse comme journaliste. Nous partagions tous ce mélange d’anxiété, de lucidité politique et de solidarité tendue, conscients qu’une page d’histoire allait se tourner sous nos pas, et que nous en serions les témoins autant que les acteurs.

David, Mélodie, moi et Gabriel déjeunant avant la manifestation
Rapidement, la conversation a convergé vers l’arrestation de Jaggi Singh survenue la veille. Il avait été happé par des agents en civil alors qu’il participait à une action symbolique, calme et éloignée des zones de confrontation. D’autres récits circulaient déjà, comme celui de Joan Russow, cheffe du Parti vert du Canada, arrêtée sans ménagement pour avoir simplement tenté de photographier la prison d’Orsainville, là où plusieurs de nos camarades étaient peut-être détenus sans justification claire. Les arrestations sans mandat, les opérations dites « préventives » et les infiltrations de cellules militantes comme Germinal contribuaient à installer un climat de répression feutrée, mais bien réel. Pourtant, ce matin-là, chaque gorgée de café semblait raviver notre rage tranquille. Il n’était plus question d’hésiter. La peur, déjà, s’était transformée en lucidité. Et la lucidité, en courage.
Nous avons ensuite rejoint le cortège officiel de la Marche des peuples, qui prenait son départ à la Gare du Palais pour remonter le boulevard Charest Est, en basse-ville, tout près de la Haute-Ville bouclée par les forces de l’ordre. L’ambiance évoquait un carnaval militant : fanfares improvisées, marionnettes géantes, tambours effervescents, slogans acérés, chants de lutte et d’espoir. Plus de 50 000 personnes avaient investi les rues de Québec. Le RAP n’était qu’un petit groupe parmi tant d’autres, disséminé dans cette mer de banderoles et de causes portées à bout de bras. Il y avait des syndicats, des féministes, des écologistes, des étudiants, des groupes communautaires, des ONG venues des quatre coins du continent, des artistes, des poètes… toute une mosaïque d’êtres engagés, rassemblés dans un même refus, mais porteurs d’idéaux parfois très différents. Je déambulais parmi eux, caméra en main, avide de saisir les chants, les regards, les élans collectifs, les alliances de fortune, les tensions aussi. On avait la nette impression que quelque chose d’important se jouait là, sous nos yeux.

Aux côtés de Greenpeace, du NPD, du Parti québécois, d’Appel transnational, de l’Alliance sociale continentale et d’un foisonnement de collectifs locaux, nous avancions ensemble. Ce n’était plus une marche, mais une prise de parole incarnée.
La mobilisation était organisée selon un système de zones inspiré des manifestations de Montréal en 2000 : verte, jaune, rouge. Nous évoluions dans la zone verte, la plus pacifique, longeant les vitrines de la basse-ville. Mais cette atmosphère bon enfant n’était qu’une pellicule fragile posée sur une tension croissante. Tous savaient que certains finiraient par quitter le tracé officiel pour aller défier le fameux mur de la honte qui incarnait le mépris des élites pour la population. Même si les consignes étaient claires, nombreux étaient ceux dont la rage de la veille brûlait encore. Le vrai pouvoir se trouvait là-haut, bien protégé derrière les blindés. Et nous, nous étions maintenus en périphérie.
Puis, l’intersection s’est dressée devant nous comme une invitation muette. La rue Dorchester montait en pente raide vers la barricade principale. Elle ouvrait une brèche, une faille dans le scénario. Nous étions alors juste en avant d’une bannière de tête d’un grand syndicat anglophone, discipliné, organisé, suivi d’un imposant contingent.
Dans un geste improvisé mais résolu, j’ai demandé à Mélodie (bien plus bilingue que moi à l’époque) d’aller parler aux responsables syndicaux pour leur indiquer que la manifestation se poursuivait par là, tout bonnement vers le haut de la ville. Elle s’est élancée sans hésiter, et quelques phrases bien tournées ont suffi. Mélodie fut manifestement convaincante. En moins d’une minute, le groupe syndical a bifurqué du tracé officiel, entraînant derrière lui tout son contingent, et, dans son sillage… l’ensemble des milliers de manifestants qui suivaient en arrière.
Dans la fluidité du mouvement et l’anonymat le plus complet, nous venions, Mélodie et moi, de faire dévier l’itinéraire de l’une des plus grandes manifestations de l’histoire récente du Québec. Ce n’était plus le parcours officiel. C’était une échappée. Une déviation spontanée. Un acte politique. Et, quelque part, l’un de mes petits faits d’armes à vie, certes invisible, mais bien tangible.
À mesure que la foule s’engageait dans la montée, le rythme s’accélérait. Des cris de joie fusaient, des slogans retentissaient plus fort, les tambours battaient à tout rompre. Mais plus on approchait de la barricade, plus l’ambiance virait à la confusion. Les gens se pressaient, certains hésitaient, d’autres scandaient encore avec entrain, inconscients du piège qui se refermait. La tension claquait maintenant comme une toile trop tendue. Un souffle de silence a parcouru la foule… ce minuscule battement après les premières déflagrations. Nous étions au bord du point de rupture.
Le baptême du feu
On dit parfois que ce sont les brèches qui laissent entrer la lumière. Mais ce jour-là, c’est plutôt la fumée qui s’est engouffrée partout.
À peine arrivés en haut de Dorchester, devant la fameuse barricade, les forces de l’ordre ont riposté sans sommation. Une salve de bombes lacrymogènes nous a frappés de plein fouet. Cette fois, le gaz ne flottait pas mollement dans l’air comme la veille : il fonçait sur nous, projeté par d’étranges souffleuses à neige reconverties pour pulvériser les irritants chimiques à hauteur d’homme. C’était surréaliste.
La panique a été immédiate. Les yeux brûlaient, la gorge se fermait, les poumons hurlaient. Je découvrais moi-même, comme tant d’autres autour, les effets réels du gaz lacrymogène. La veille encore, le vent soufflait les fumées vers les policiers. J’avais même laissé mon masque à gaz chez le père de Mélodie, pensant naïvement qu’il ne servirait pas. Cette fois, nous étions pris en étau, coincés entre la clôture et la masse compacte de la foule. Impossible d’avancer. Impossible de reculer. La fête devenait affrontement. La rue basculait.
Le réel se brouillait. C’était une détonation sensorielle, une onde de choc invisible. La gorge en feu, les yeux noyés, le souffle coupé… on suffoquait avant même de comprendre ce qui nous frappait. Les slogans se sont éteints. Les tambours se sont tus. Et les convictions, elles aussi, semblaient se dissoudre dans l’âcre brûlure de l’air.
Tout autour, c’était la débandade. Une marée humaine désorganisée fuyait en tous sens. Certains couraient à l’aveugle, d’autres s’effondraient. On se piétinait, on se cognait aux murs. Les cris, les pleurs, les halètements composaient une cacophonie de détresse. Ce chaos me glaçait bien plus que le gaz lui-même.
Et dans ce tumulte, nous avons été emportés. Engloutis dans le flot, ballotés comme deux particules d’un même courant, nous luttions pour rester debout, pour ne pas nous perdre. Je serrais la main de Mélodie avec force, et elle la mienne, comme si nous ne formions plus qu’un seul être, déterminé à traverser l’épreuve sans se disloquer. Puis, au détour d’une ruelle, dans une brèche du chaos, nous avons trouvé un repli d’asphalte, un abri précaire mais salutaire. Nous nous sommes ainsi recroquevillés l’un contre l’autre, en boule sur le sol brûlant, le visage enfoui dans nos bandanas détrempés.
Les paupières en feu, la gorge nouée, nous mâchions frénétiquement des quartiers de citron qu’un camarade mystérieux nous avait glissés dans les mains quelques instants plus tôt. Il n’avait dit qu’une chose, d’un ton calme et pressé : « Mordez là-dedans quand vous serez dans les gaz. » C’était dérisoire, presque absurde, mais ça nous donnait un mince sentiment de contrôle.
Mélodie criait. Un cri lancinant et primaire, jailli du plus profond d’elle-même. Il n’obéissait à aucune raison, aucun mot. Il condensait la panique, la surprise, la peur… et surtout cette incompréhension viscérale qu’aucun mot ne pouvait encore nommer.
Et moi, je devais rester lucide. Retenir mon souffle. M’obliger à penser pour ne pas céder. Chaque seconde durait une éternité. J’avais compris que nous ne pouvions plus fuir. Que le plus sage, dans ce chaos, était simplement d’endurer. Attendre que la tempête humaine se disperse. Survivre, à tâtons.
Autour de nous, le sol était jonché de lunettes brisées, de banderoles piétinées, de sacs abandonnés. Tout témoignait d’une fuite précipitée. Et nous, deux silhouettes immobiles au milieu de la débâcle, nous résistions à notre manière. Fragile et héroïques, enfermés dans cette posture de survie.
Mélodie était en état de choc. Je le lisais dans ses yeux éteints, dans l’étrange silence qui l’habitait soudainement. Elle, qui quelques minutes plus tôt avait su détourner à elle seule l’itinéraire de toute une manifestation, atteignait maintenant ses limites. Surprise, désemparée, vidée par la violence soudaine de l’assaut, elle n’avait plus la force d’avancer. C’en était trop.
Quand le nuage de gaz s’est enfin dissipé, nous avons quitté les lieux ensemble, errant dans la basse-ville comme deux survivants égarés. Arrivés chez son père, elle m’a regardé droit dans les yeux et m’a simplement dit que c’était fini. Elle quittait le front. Pour de bon. Et je n’ai pas cherché à la faire changer d’avis. Je comprenais. Vraiment. Après tout, ce combat n’avait jamais été le sien. Elle s’y était plongée un instant, portée par l’élan de m’accompagner dans ce moment historique, qui avait lieu dans sa propre ville natale. Et là, elle venait de heurter sa limite. C’était humain. C’était légitime.
Dans mon for intérieur, je réalisais que c’était aussi une métaphore de notre propre relation qui s’achevait. Une histoire née dans la fougue de la jeunesse, nourrie d’élans bruts, d’absolu, de révolte, de grandes causes et de grandes émotions. Un feu de passage, incandescent, imprévisible, et forcément éphémère.
Après un parcours naïf, rebelle et mouvementé, nos chemins se séparaient ainsi, au sortir de l’épreuve du feu. Sans trop lui dire, sans grands adieux, je lui ai séché une larme du bout des doigts. Puis je lui ai offert un dernier baiser, discret, doux, plein de gratitude.
Et dans le même souffle, j’ai fait demi-tour. Caméra au poing, masque à gaz au visage, patins aux pieds. J’étais prêt à retourner dans l’arène politique… affronter mon propre destin. Quelque chose s’était embrasé en moi. Une soif, un feu, une exaltation brute. L’adrénaline me dévorait. Mes veines pulsaient comme jamais. J’en voulais plus. Bien plus. Je suis ainsi reparti au front. Seul… mais plus vivant que jamais.

Ce qui allait suivre tenait autant du récit de guerre que du voyage intérieur. Une plongée en apnée dans l’instant. Une errance lucide. Une exaltation dangereuse.
Caméra au poing, cœur en feu
Je revenais tout juste de mon refuge de circonstance. Quelques rues plus bas, Mélodie s’était ainsi retirée, brisée. Mais moi, je faisais le chemin inverse. J’étais remonté vers les hauteurs, là où la ville basculait. Devant moi s’ouvrait un paysage de guerre : fumée flottante, débris épars, silhouettes errantes, sirènes lointaines. Les barricades, toujours dressées, scindaient le centre-ville en zones mouvantes. C’était un champ de bataille urbain au sens le plus brut du terme. Un décor que je croyais réservé aux reportages étrangers m’apparaissait soudain dans toute sa réalité, et j’y entrais, caméra au poing, cœur en feu.
Dès que je fus de retour dans la rue, une énergie neuve me traversa. L’air sentait encore le gaz, la peur, le danger. Mais moi, j’étais ailleurs. Mon masque à gaz, aussi étanche que rassurant, me conférait un pouvoir presque surnaturel. Comme un avantage bonus dans un jeu vidéo, il me permettait d’évoluer librement dans un monde devenu toxique pour les autres. Là où certains suffoquaient, moi je respirais. Là où d’autres reculaient, je fonçais.
Et mes patins… mes patins décuplaient ma mobilité. Ils étaient devenus l’extension de mon instinct. Je glissais à travers la ville comme une onde furtive, entre les fronts, les replis, les interstices. Je dansais entre les débris, les lignes policières, les poches de résistance. Le chaos ambiant n’était plus un obstacle, mais un terrain de jeu. Une arène vivante. Une partition improvisée.
Je traversais les zones comme un électron libre, passant d’un quartier à l’autre au rythme des vagues de répression. Je captais ce que peu voyaient. J’étais mobile, insaisissable. Le mouvement lui-même me protégeait. Invisibilisé par la vitesse, protégé par la technique, j’étais partout et nulle part. Une particule libre dans une mer humaine en ébullition.
Et dans ma main, cette caméra. Ce troisième œil. Ce bouclier symbolique. Elle pointait vers le monde un regard à la fois fragile et affirmé. Par sa simple présence, elle instaurait une retenue, un doute, parfois même une forme de respect. Les policiers hésitaient. Les regards se détournaient. J’étais là, mais d’une manière à part. Ni tout à fait manifestant, ni tout à fait journaliste. Une figure flottante entre les rôles.
Je me faufilais entre les manifestants radicaux, les escouades antiémeutes et les barricades improvisées. Mon regard cherchait la lumière dans la fumée, la beauté dans la fureur. Je n’étais plus seulement un militant. J’étais un témoin. Un regard tendu là où la majorité préférait détourner les yeux.
Et soudain, un flash. L’impression brutale de vivre une scène arrachée à un conflit armé. Au-dessus de nos têtes, les hélicoptères de surveillance vrombissaient, comme une menace suspendue. En bas, les cris, les gaz, les projectiles, les affrontements à visages masqués… Tout évoquait Gaza. C’était irréel. Comme si la guerre, sans prévenir, s’était invitée chez nous.
Et pourtant, au milieu du chaos, je sentais quelque chose d’autre s’ouvrir. Une zone étrange, intime, presque calme. Comme si ma conscience se détachait du fracas ambiant pour entrer dans un espace plus dense, plus clair. Mon corps évoluait dans l’urgence, mais mon esprit, lui, basculait ailleurs.
C’est là, au cœur du tumulte, que j’ai compris, avec une intensité inédite, ce que signifie vraiment le mot liberté. Pas celle qu’on scande sur des pancartes, ni celle qui s’inscrit dans les discours officiels. Mais une liberté viscérale, fugace, organique. Celle du corps qui avance sans consigne. Du regard qui choisit ce qu’il veut voir. De l’individu qui, pour une fois, agit sans permission. Qui ose défier l’ordre établi, non par idéologie, mais par vitalité.
Cette liberté-là ne se revendiquait pas, elle se vivait. Elle surgissait dans l’instant, dans la tension, dans l’alignement étrange entre le risque et la clarté. Elle était brute, éphémère, mais d’une puissance inégalée. Et pourtant, cette sensation jaillissait d’un paradoxe.
Car ce que je vivais individuellement, en état de grâce presque, n’était que le reflet inversé d’un combat collectif : celui de peuples empêchés de s’autodéterminer, d’États asphyxiés au nom d’un idéal supérieur, celui du marché libre. Libre, vraiment ? Toute l’ironie était là. Ce marché prétendument affranchi ne faisait qu’enchaîner les démocraties. Il soumettait les volontés populaires à ses dogmes et imposait aux nations une reddition silencieuse.
C’était ça, le cœur du paradoxe : me sentir plus libre que jamais, alors même que je constatais l’érosion du pouvoir collectif. Mon euphorie individuelle jaillissait au milieu d’un soulèvement qui dénonçait cette dépossession globale.
Et malgré tout, j’avançais. Plus seul. Plus vivant. Plus lucide aussi.
La brèche des ombres
Je continuais de glisser à travers la foule, quand un contingent singulier attira mon attention : des silhouettes vêtues de noir de la tête aux pieds. Pas de logos, pas de pancartes, rien qui dépasse. C’était manifestement des membres du fameux Black Bloc, un regroupement anarchiste aussi redoutée que fantasmée.
Contrairement à ce que prétendaient les autorités ou les médias, le Black Bloc n’était ni une organisation secrète ni un groupe terroriste structuré. Il s’agissait formellement d’une tactique ; c’est-à-dire d’une stratégie militante utilisée ponctuellement dans les manifestations. Une manière de faire corps, anonymement, dans l’espace public. Leur objectif n’était pas de représenter, mais de perturber. De faire vaciller l’ordre établi. De révéler les contradictions d’un système qui proclame la libre circulation des biens… tout en érigeant des murs pour contenir les peuples.
J’ai rapidement remarqué qu’ils communiquaient entre eux exclusivement en anglais, sans accent francophone. J’en ai déduit qu’ils étaient pour la plupart venus des États-Unis, peut-être inspirés, ou directement issus, de cette mouvance radicale née à Seattle lors des émeutes de 1999 contre l’OMC. Le Black Bloc, tel qu’il se manifestait ici, était l’expression d’un rejet globalisé du néolibéralisme, une riposte directe à l’architecture même de la mondialisation.
Comme plusieurs altermondialistes, ils voyaient dans le Sommet des Amériques une tribune pour dénoncer un capitalisme globalisé imposant l’austérité aux peuples tout en protégeant les élites économiques. Leur stratégie : créer la rupture. Et parfois, forcer l’image.
Leur démarche était résolue, presque paramilitaire. Je décidai de les suivre. Leur cohésion tranchait dans le désordre ambiant. Ils avançaient par grappes, se consultaient d’un signe de tête, disparaissaient derrière une ruelle puis réapparaissaient plus loin, toujours au bon endroit. Ils semblaient savoir où frapper, quand apparaître.
Ma caméra à l’épaule semblait leur convenir : aucun regard méfiant, aucune main pour masquer l’objectif. Peut-être parce qu’en patins je restais à bonne distance, ou parce que dans le vacarme général un témoin de plus ou de moins ne changeait rien. Peut-être voyaient-ils en moi un observateur utile, ou simplement un corps de plus dans la masse.
Nous arrivâmes à l’angle d’une intersection faiblement gardée. Pas un policier en vue. En moins de dix secondes, un grappin sortit d’un sac, vola dans les airs et mordit le sommet de la clôture. La corde fut tendue, et les mains affluèrent. Des militants masqués, mais aussi divers manifestants sortis de nulle part : tous agrippèrent la même ligne, tirant la corde comme un seul muscle. En quelques secondes, la palissade vacilla. Le métal gémit, plia, puis céda. Une partie du « mur de la honte » tomba, emportée par une foule sans visage. Je filmais. Ce n’était pas un simple acte de vandalisme. C’était un symbole qui s’effondrait. Celui d’un libéralisme si pur qu’il en devient autoritaire.
Personne ne chercha à franchir l’ouverture. La brèche suffisait. Elle disait : votre mur n’est qu’une illusion. Et votre sommet, un huis clos de verre. Mon objectif tremblait sous l’émotion ; je savais que j’enregistrais l’instant précis où le symbole cédait. Je pensai à Germinal. À l’arrestation préventive qui avait voulu étouffer ce geste avant même qu’il existe. Or voilà, la clôture gisait maintenant sur l’asphalte, et tout ce que les services secrets avaient redouté s’accomplissait sous l’œil de ma caméra.
Dans la mêlée, je ressentais l’ambiguïté de ce moment. L’exaltation d’un basculement symbolique. Autour de moi, les gens se tapaient dans les mains et se prenaient en photo. Les forces de l’ordre, manifestement prisent de court, demeurait invisible, occupée plus loin à resserrer l’étau dans les artères principales.
Je coupai brièvement le moteur de la caméra, juste quelques secondes, pour savourer pleinement ce moment. Le masque me donnait toujours cette impression étrange d’être un être amphibie, capable de respirer dans un air devenu toxique. Mon cœur cognait comme un tambour métallique, non pas de peur, mais d’une joie brute : j’avais vu la fissure naître, et je savais que j’en gardais la trace, gravée un peu plus tôt sur la bande encore tiède dans le boîtier.
Et à l’instant où l’excitation semblait retomber, un nouveau frisson parcourut la foule : il fallait évacuer avant que la contre-attaque n’arrive. Le Black Bloc replia son matériel aussi vite qu’il l’avait déployé, puis s’évanouit dans la masse. Je repris ma course, patins crissant sur le béton, caméra à l’œil, prêt à capter l’après-coup.
Ce n’était qu’un panneau de clôture couché sur le sol, mais pour nous tous, c’était une victoire morale : une preuve qu’aucun mur, fût-il de fer galvanisé ou de dogme économique, ne tient éternellement face à la volonté humaine. Les sommets peuvent bien promettre des « marchés libres » ; la liberté, la vraie, se niche parfois dans le simple fait de faire tomber une barrière.
J’avançai de nouveau, solitaire et incandescent, conscient d’avoir respiré, l’espace d’un instant, l’oxygène rare de l’insoumission concrète. Une brèche dans le métal, une autre dans mon propre horizon : voilà ce que je tenais maintenant en mémoire, gravé sur bande magnétique et dans chaque fibre de mon corps. J’avais vu une brèche dans le récit officiel. Et moi, je l’avais captée.
🎥 Documentaire à voir : Le Sommet des Amériques à Québec en 2001 – Une Ville assiégée
L’ordre contre l’élan
La journée s’étirait, hors du temps, hors de toute normalité. J’avais oublié la faim, littéralement coupée par l’intensité de ce moment unique. Mon corps aurait dû flancher, mais une autre force me portait. Une énergie brute, étrangère à la biologie. Comme si mon souffle s’était synchronisé à celui d’un être plus vaste, cette foule encore debout. J’étais en transe lucide, suspendu entre vigilance tactique et extase pure.
Je me souviens surtout de ce bruit. Ce rythme grave, répété, presque hypnotique. Le battement de cœur d’un organisme collectif, vibrant dans les entrailles métalliques de l’échangeur. Le son tribal d’une foule repoussée par les gaz mais toujours vivante. Ils étaient là, des centaines, haletants, engagés. Et pour signifier leur présence, ils frappaient. Encore et encore. Des pierres, des bâtons, des pavés cognés à l’unisson contre les rebords d’acier.
CLANG TAKA-CLANG!
CLANG TAKA-CLANG!
CLANG TAKA-CLANG!
Un écho brut. Un chant de guerre sans paroles. Une pulsation entêtée qui refusait de disparaître. Ce grondement n’était ni spectacle ni menace : c’était un cri de dignité. Une transe viscérale, tissée de rage, d’espoir, et d’une beauté féroce. Ce rythme ancestral éveillait une mémoire enfouie. Celle des peuples debout, de l’humanité en résistance. Comme si chaque coup faisait remonter à la surface la trace tenace de ceux qui, siècle après siècle, ont refusé de plier.
Mais peu à peu, l’air s’alourdit. Comme un changement de pression. L’exaltation se mua en tension. Le ciel s’assombrit, à l’image des intentions de l’ordre établi.
Jusqu’ici, les policiers s’étaient contentés de contenir. Puis, lentement mais sûrement, la logique de confrontation s’est affirmée. Ce n’était ni une réaction à chaud ni un dérapage isolé. C’était une contre-offensive. Une manœuvre réfléchie, menée avec une précision glaciale. Il ne s’agissait plus simplement de tenir une ligne, mais de reprendre chaque rue, de briser l’élan, de reconquérir la ville rue par rue.
Caméra en main, je filmais cette avancée implacable. Chaque escouade agissait comme un rouage dans un engrenage plus vaste. La Haute-Ville fut quadrillée. Les accès verrouillés. En moins d’une heure, la foule de manifestants fut fragmentée en petits groupes, repoussés dans les ruelles, encerclés dans les interstices de la ville. À chaque coin de rue, une ligne progressait, invariablement.
Ce n’était plus une manifestation. C’était un repli contraint, une désagrégation orchestrée par une machine bien huilée.
Puis je me suis retrouvé, avec une centaine d’autres, coincé dans l’un des bras de l’échangeur de l’avenue Honoré-Mercier. Cette artère escarpée, qui relie la colline parlementaire au Vieux-Québec, s’était transformée en entonnoir de béton. Devant nous, plus d’issue. Seulement l’avancée implacable d’une escouade d’une trentaine de policiers qui approchait en ligne.
À chaque pas, leurs matraques frappaient leurs boucliers dans une cadence sèche, presque mécanique. Leur progression était lente, mais irrésistible. Ensemble, ils formaient un mur vivant, une masse compacte et disciplinée qui se déplaçait comme un seul organisme. Nous étions contraints de reculer, pas à pas, dans une chorégraphie imposée, dictée par leur avancée menaçante.
Je continuais de filmer, appuyé contre la rambarde, complètement à gauche du groupe. C’est alors que mon attention se fixa sur un policier posté à l’extrême droite de leur formation. Légèrement en retrait, il se distinguait nettement des autres. C’était le seul à manier un fusil à balles de plastique. Et c’était lui qui dirigeait la manœuvre.
Je l’ai vu recevoir des consignes par radio, discrètes mais constantes. Puis, avec des gestes brefs et précis, il relayait ces ordres à l’escouade. Une série de signes courts, exécutés avec assurance, et immédiatement compris par les policiers autour de lui. Il agissait comme un pivot, un relais stratégique entre la chaîne de commandement et l’unité d’intervention sur le terrain.
Il incarnait une autorité froide, sans colère ni fébrilité. Juste une rigueur tranchante. Toute l’escouade semblait calquée sur son tempo. Il n’avait pas besoin de crier. Sa maîtrise suffisait.
Il visait. Pas au hasard. Avec méthode. Un à un, il fixait les manifestants les plus avancés. Le faisceau rouge de son pointeur laser apparaissait sur une cuisse, une poitrine, une épaule. Puis… il attendait. Une dizaine de secondes. Comme une injonction muette : « Recule, ou subis. »
Ce moment suspendu, entre la visée et le tir, créait une tension étouffante. Un chantage silencieux. Un faux choix. Et si le manifestant ne bougeait pas… le tir partait. Toujours vers le sol. Le projectile éclatait sur l’asphalte, ricochait dans les jambes, semait cris et panique. Chirurgical. Humiliant. D’une efficacité glaçante.
Oui, plusieurs manifestants ont été blessés durant ce fameux sommet. Mais ce policier face à moi n’a jamais perdu le contrôle. Il n’en avait pas besoin. Il était le contrôle.
Pris au piège, je filmais encore. L’évacuation avançait au rythme d’un métronome implacable. Je reculais, moi aussi. Non pas par peur, mais parce qu’en cet instant précis, une vérité m’avait traversé : chaque soulèvement appelle sa répression, chaque élan, son barrage. L’ordre ne réagit pas. Il s’impose.
Mais ce que l’ordre ignore… c’est qu’il ne pourra jamais vraiment éteindre ce qu’il tente de contenir. Il peut disperser les corps, mais pas la vibration.
Nous avions été rabattus en Basse-Ville comme de vulgaires barbares, rejetés hors des murs de la citadelle, au profit d’un ordre mondial imposé, incarné par des dirigeants étrangers et une police qui ne semblait plus être au service de notre société. La ville, verrouillée de toutes parts par une autorité étrangère, ne nous appartenait plus.
C’est alors que ma caméra s’est éteinte. Ma dernière batterie venait de rendre l’âme. Cette panne soudaine m’a figé. Un silence intérieur s’est imposé, une pause que je n’avais pas choisie. Là, à l’endroit précis où la route plonge vers l’îlot Fleurie, je me suis arrêté.
J’étais au cœur d’un no man’s land urbain. Un interstice en dehors des lois, suspendu entre la ville haute et la ville basse, entre béton et vertige. Un sanctuaire provisoire, chargé de tensions invisibles et d’ondes résiduelles. Quelque chose palpitait encore, en sourdine. Une énergie brute, sans contour, à la recherche d’un exutoire.
Alors j’ai déposé ma caméra. Comme un soldat dépose son arme. J’ai levé les bras au ciel, fermé les yeux… et j’ai commencé à danser.
Danser au bord du gouffre
Ce fut l’un des souvenirs les plus puissants, les plus intimes que je garde du Sommet… peut-être même de ma vie entière. Un moment suspendu, hors du temps, hors des mots. La nuit était tombée sur Québec, mais la tension flottait encore dans l’air, comme un tambour étouffé au loin. Des nappes de gaz lacrymogène traînaient dans les hauteurs, accrochées aux corniches comme les relents d’un affrontement inachevé. Les grandes artères, désertes et verrouillées, semblaient figées dans une veille muette.
Et pourtant, à l’îlot Fleurie, un morceau de ville relégué aux marges, suspendu entre la Basse-Ville et la colline parlementaire, quelque chose battait encore. Ce territoire abandonné des plans d’aménagement, ignoré des forces de l’ordre comme des circuits officiels, offrait une échappée. Une poche d’oxygène hors du quadrillage. Un creux de béton en dehors du contrôle. Un souffle y persistait. Une vibration souterraine. Un appel à rester vivant, coûte que coûte.
Tout au long de la journée, j’avais entendu ce rythme. Un son tribal, brut, entêtant : des manifestants qui frappaient des pierres, des bâtons, des débris contre les glissières métalliques de l’échangeur. Ce vacarme improvisé, organique, était devenu la bande-son de notre révolte. Le souffle d’une foule en résistance. Une réminiscence inconsciente, millénaire, de luttes passées. Le cœur battait à travers le métal, les générations et les siècles.
Mais ce cœur commençait à s’essouffler. Le feu symbolique de la manifestation vacillait. Les bras s’alourdissaient. Un à un, les percussionnistes ralentissaient, puis cessaient de frapper. Le battement collectif se fragmentait.
Alors j’ai décidé de ne pas encore le laisser s’éteindre.
Toujours en patins, j’ai traversé l’îlot d’un mouvement souple, presque flottant, me laissant guider par le souffle du rythme qui s’éteignait. Dans un enchaînement instinctif de glissements et de demi-cercles, je dessinais autour de moi une chorégraphie tribale, comme une danse d’invocation. Chaque passage près d’un percussionniste devenait un rituel. Je ralentissais, m’approchais, le fixais droit dans les yeux. Sans un mot, mais avec ce regard insistant, chargé de sens. Un appel silencieux : « Continue. Continue pour la résistance. Pour qu’on n’oublie jamais. Pour que ça brûle encore en nous. » À chaque contact, c’était comme si je tissais un fil invisible, une énergie partagée, reliant chacun de ces points vivants autour de la rambarde. Ensemble, nous redevenions cercle. Ensemble, nous reprenions feu.
Pendant tout ce temps, les gyrophares tournoyaient dans les rues basses de la ville. On les entendait hurler au loin, omniprésents, martelant l’oreille comme une menace. Mais à mesure que nos percussions reprenaient de la force, ce vacarme de sirènes semblait s’effacer, englouti sous nos rythmes primaires. Comme si le battement de nos percussions pouvait recouvrir celui de la peur.
C’est ce que mon ami Gaston, ancien raver comme moi, appelait un « motivateur ». Ni meneur, ni animateur, mais catalyseur d’intensité. Un veilleur d’ambiance, là pour empêcher que l’élan ne retombe sur le dancefloor. Dans chaque rave, il y a un moment fragile, juste avant qu’un bon DJ prenne le relais, quand l’énergie vacille et que la foule hésite entre l’attente et l’ennui. C’est là que surgissent les motivateurs. Par leur présence, leur souffle, leur danse, ils rallument la flamme sans jamais se mettre en avant. Et parfois, c’était pour préparer le terrain à un DJ que nous connaissions. Un ami. Un membre de notre propre groupe qui évoluait dans la vibe psytrance. Il fallait amplifier l’énergie, l’orienter, pour que son set atterrisse dans une foule déjà frémissante. Ces motivateurs n’ordonnaient rien. Ils incarnaient. Ils servaient de pont entre l’inertie et l’extase, entre le battement intérieur et l’explosion collective.
Et ce soir-là, à l’îlot Fleurie, comme dans le cours naturel du moment, c’est ce rôle que j’ai assumé.
Je me suis ainsi mis à danser au centre de la chaussée, au cœur de cette bretelle désertée des voitures. Les bras ouverts, les yeux mi-clos, les patins battant la poussière, je tournais sur moi-même dans un mouvement de spirale, habité par une énergie plus grande que moi. Chaque geste puisait dans le trop-plein de la journée. Chaque mouvement devenait prière, offrande, exorcisme.
J’étais dans un état second. Une lucidité altérée, presque hallucinée. Et pourtant, je n’avais rien consommé d’autre que mon café du matin. Aucun psychotrope. Rien qui puisse expliquer cette étrange sensation de dissociation. Jamais, sobre, je ne m’étais senti aussi ailleurs. Aussi vivant. Je ne pensais plus. J’étais devenu mouvement pur. Je transpirais l’énergie qui me restait, comme un trop-plein à libérer. Mon corps projetait dans l’espace un langage instinctif, fait de gestes bruts. Une transe salutaire. Un exutoire.
Au début, j’étais seul à danser. Puis, deux silhouettes m’ont rejoint. Trois. Sept. Une douzaine. Des corps sortis de la brume lacrymogène, encore secoués mais vivants. Certains reprenaient le rythme sur les garde-fous, réveillant les percussions comme on ranime des braises. D’autres entraient dans la danse, hésitants d’abord, puis de plus en plus libres. Nous ne suivions aucune chorégraphie, mais nos corps parlaient d’eux-mêmes. Une logique intérieure nous guidait, comme un langage ancien ressurgi du fond des âges. Et ce battement, ce battement ancestral, reprenait vie.
Puis ce fut l’afflux.
Les manifestants refoulés tout au long de la soirée aux abords de l’îlot se mirent à converger. Lentement, comme une marée nocturne, ils se joignaient à nous. Ce n’était plus une foule. C’était une pulsation. Une reformation spontanée, viscérale. Il n’y avait plus de pancartes. Plus de slogans. Plus de discours. Seulement nos corps, nos cris, nos mains frappant sur le métal, nos rythmes improvisés qui faisaient vibrer la nuit. Une danse née de nos propres battements. Un soulèvement d’instinct, d’entêtement.
L’îlot Fleurie, ce morceau d’échangeur transformé pour quelques jours en zone libre, en refuge pour les gazés, en espace de création et de rituels, redevenait un foyer vivant de résistance. C’est là, dans cet entrelacs de béton suspendu, que battait le cœur obstiné de notre présence. Et en cette nuit du samedi 21 avril, ce cœur dansait.
Mais tout regroupement arrive toujours à ses limites.
Les heures ont passé. Les percussions s’épuisaient. Les corps retombaient lentement sur l’asphalte. La fatigue, immense, nous rattrapait. Certains s’allongeaient là même, à la belle étoile, sans rien d’autre que l’écho des battements dans les oreilles.
J’étais exténué, vidé de tout.
Alors, dans un dernier spasme d’énergie, j’ai quitté l’îlot pour aller dormir chez le père de Mélodie. Le cœur encore vibrant, les jambes flageolantes, mais étrangement serein.
Sur le chemin du retour, pourtant, je n’étais pas tout à fait seul. Dans les rues assombries de la Basse-Ville, j’ai croisé plusieurs voitures banalisées de la police. Certaines roulaient lentement, en filature. D’autres restaient immobiles, tapies dans l’ombre. Un fourgon, retournant vers le poste, était déjà rempli de manifestants arrêtés. On aurait dit une traque silencieuse, une chasse méthodique aux dernières traces de révolte.
J’ai même assisté, de l’autre côté de la rue, à une scène digne d’un film d’action : quatre agents surgissant d’une camionnette, plaquant un jeune homme contre un mur avant de le faire disparaître à l’arrière du véhicule en quelques secondes. Pas un mot. Pas un cri. Une arrestation-éclair, comme un rapt.
Et moi, je glissais toujours. Je patinais entre les mailles du filet, encore une fois. Comme si mes roues effaçaient mes traces.
Encore une fois, toujours anonyme… j’étais passé inaperçu.
Mais cette nuit-là, quelque chose en moi s’était transformé. Je le sentais dans mes jambes vacillantes, dans mon souffle raccourci, dans le tremblement discret qui persistait sous ma peau. Une empreinte s’était déposée en moi. Pas une blessure, non. Plutôt une initiation. Comme un sceau invisible que seul l’esprit peut reconnaître.
Et tandis que l’aube approchait, je pressentais déjà que les lendemains seraient tout aussi importants. Après la danse, après l’extase et l’épreuve, viendrait le temps d’intégrer cette expérience, d’en tirer du sens, d’en prolonger l’écho dans les jours, les mois, les années à venir. Cette nuit n’était pas une fin. C’était une ouverture. Une invitation à poursuivre le combat autrement.
Aux lendemains du Sommet
Je n’étais plus sur place pour le voir de mes propres yeux. Je l’ai appris sur la route du retour entre Québec et Montréal, entassé dans la voiture de Patrice. Nous refaisions ensemble le fil des événements, encore électrisés par ce que nous venions de vivre, lorsque l’un de mes camarades du RAP a reçu un appel sur son téléphone cellulaire (un objet peu fréquent à cette époque). Par cette voix lointaine, j’ai compris que, ce dimanche matin 22 avril, les forces policières étaient venues cueillir les militants endormis à l’îlot Fleurie. Sans heurts. Sans matraques. Juste des corps étendus, méthodiquement ramassés comme des fruits mûrs.
Cette rafle silencieuse sonnait comme un réveil brutal. La fin d’un rêve trop intense pour durer. Et c’est là que j’ai saisi, avec un frisson rétrospectif, que j’étais passé tout juste entre les doigts des forces de l’ordre. Je l’avais échappée belle. Une fois de plus. Cette réalisation donnait au moment vécu une texture presque irréelle. Comme si j’en étais sorti par effraction, les pieds à peine revenus au sol, avec dans le corps les restes d’une transe, et dans l’esprit l’étrange vertige d’avoir habité un rêve éveillé.
Malgré tout, dans l’habitacle de la voiture, régnait cette chaleur étrange qui succède aux tempêtes : une paix intérieure née de la révolte. Chacun racontait son fragment d’histoire, ses anecdotes personnelles. Il y avait du feu dans les yeux, une intensité rare. Nous avions vécu chacun une portion différente de ce grand récit, mais en le partageant, nous en faisions déjà un mythe commun.
Personnellement, j’étais fébrile à l’idée de retrouver mon salon pour visionner les deux cassettes VHS que j’avais remplies jusqu’à la dernière seconde. Deux bandes saturées d’images saisissantes captées au cœur de l’action : des foules en colère avançant dans les gaz lacrymogènes, les visages masqués du Black Bloc frappant le mur de la honte comme une armée fantôme, cette clôture symbolique qui finit par s’effondrer dans un fracas libérateur, l’opération policière méthodique et implacable nous rabattant vers la basse-ville, les cris, la confusion, et au détour d’une rue, cette rencontre improbable avec le chansonnier Renaud. Ces cassettes contenaient un témoignage brut, filmé à bout portant, que j’avais hâte de partager avec mes pantouflards colocs pour leur montrer, de l’intérieur, ce que signifiait vraiment résister.
Malheureusement, ces précieuses bandes ont été perdues depuis, probablement prêtées un jour à un ami de passage, ou oubliées dans une boîte reléguée au fond d’un garde-robe chez un ancien coloc. Égarées au fil des déménagements, elles se sont fondues dans le grand désordre de la vie. Alors, j’en appelle à l’univers : si quelqu’un tombe un jour sur deux vieilles VHS sommairement étiquetées « Québec #1 » et « Québec #2 », ou s’il détient des images de cette fameuse nuit, qu’il sache qu’elles contiennent un fragment de notre histoire… et une part essentielle de ce que j’ai été.
D’ailleurs, certains ont laissé une trace autrement plus visible.
Chacun, à sa manière, avait trouvé comment inscrire sa présence. Mon fantasque ami et futur coloc, Muller Hammadi, n’était pas un militant au sens strict. Ni pancarte, ni slogan à défendre. Mais il possédait un talent inné pour attirer l’attention. Un acteur dans l’âme. Armé d’un simple bâton de hockey, il renvoyait vers les lignes policières les bombes lacrymogènes lancées sur la foule. Geste absurde, chorégraphique, mais chargé de défi. Cette scène improbable fut captée par un photographe de Sports Illustrated. La photo, saisissante, fit la Une du magazine. Ainsi, Muller entra formellement dans l’iconographie du Sommet. Et à travers lui, c’est toute une jeunesse québécoise qui s’exprimait. Une jeunesse insolente, créative, libre.

J’ai recroisé Muller l’hiver dernier en me baladant au Quartier des spectacles à Montréal. Il m’a confié, sourire en coin, que cette photo avait été son fameux cinq minutes de gloire dans sa vie. Et il avait raison de le dire avec fierté : Muller avait toutes les qualités pour devenir un acteur formidable. Ce jour-là, sans scène ni script, il avait trouvé son rôle.
Puis il y eut les chiffres officiels : 463 arrestations. 5148 grenades lacrymogènes. 903 projectiles de plastique.
Mais aucun rapport officiel ne pourra jamais saisir la véritable portée de ce que nous avons vécu, ni la force symbolique de cette manifestation historique. Car ce n’est pas dans les chiffres, les bilans ou les communiqués qu’on retrouve l’essence d’un événement pareil, mais bien dans les corps vivants qui l’ont traversé, dans les récits fragmentés qu’on se transmet encore à voix basse, et dans cette mémoire collective qui tente de résister à l’érosion du temps.
Nous n’étions pas simplement des manifestants. Nous étions des éclats d’un même feu, éparpillés dans la ville, portés par une énergie qu’aucune clôture ne pouvait contenir. Une énergie indocile, sensible, et intensément humaine. Elle vibrait dans chaque regard, dans chaque pas de danse improvisé sur l’asphalte, dans chaque cri lancé contre les murs d’acier. Et peut-être vibre-t-elle encore, aujourd’hui, discrètement, dans les fibres de l’espace-temps. Comme un souffle ancien, prêt à se raviver chaque fois que la liberté vacille.
Les jours qui suivirent, chacun retourna à sa vie, avec sur la peau l’odeur du feu et dans les yeux des images qu’aucune caméra ne pourrait fixer. Nous étions fatigués, écorchés, exaltés. Un chapitre s’était refermé, mais ses échos résonnaient encore dans nos gestes, nos silences, nos rêves éveillés.
Le Sommet avait eu lieu. Nous l’avions traversé. Il allait désormais nous habiter.
Ce qui reste du Sommet en nous
Près d’un quart de siècle plus tard, il m’arrive encore de ressentir ce tremblement sous la peau. Pas seulement des images ou des souvenirs, mais une sensation plus profonde. Quelque chose d’organique. Comme si les jours d’avril 2001 avaient laissé en moi une empreinte invisible, un éclat de vérité planté dans la chair.
Car au-delà des cortèges, des cris, des affrontements, quelque chose s’est joué là-bas, dans les rues de Québec, qui nous dépasse encore. À travers le chaos, j’ai entrevu la silhouette d’un monde alternatif. Un monde qu’il nous appartient encore d’imaginer. Et de bâtir.
Il ne suffit pas de vouloir changer le monde, encore faut-il s’en donner les moyens
– Jacques Parizeau
Avec le temps, une autre certitude s’est imposée. Une lucidité née du recul, de l’expérience, et peut-être aussi d’un certain désenchantement. Ce que nous avons vécu là-bas n’était pas qu’une simple fête de la contestation. C’était un moment charnière. Un point de bascule historique. Une frontière nette entre deux époques.
Du haut de mes tout récents cinquante ans, avec la mémoire vive du Sommet de Québec gravée en moi, je peux aujourd’hui l’affirmer sans détour : ce printemps 2001 fut un jalon essentiel. Il a marqué la fin d’un cycle politique et l’entrée définitive dans un nouveau paradigme. Avant, tout semblait encore ouvert. On croyait sincèrement que les peuples pouvaient ralentir l’uniformisation marchande, opposer un véritable rempart démocratique à la montée du capitalisme globalisé. Il subsistait encore des traces vivantes de la social-démocratie, des brèches où nous osions imaginer un autre monde possible.
Les plus jeunes ne peuvent même pas imaginer ce qu’était le monde d’avant. Savent-ils seulement ce que signifient réellement les termes « néolibéralisme » ou « altermondialisme »? Ils n’ont pas connu cette époque où l’on pensait que le politique pouvait véritablement primer sur les marchés. Où l’on rêvait d’un avenir collectif basé sur la redistribution équitable des richesses, la protection du bien commun et la souveraineté populaire. Où la gauche incarnait un projet authentiquement émancipateur, porté par un héritage riche des luttes ouvrières, syndicales et démocratiques. À l’époque, la gauche n’était pas simplement un code moral superficiel destiné à afficher publiquement sa vertu sur les réseaux sociaux ou dans les médias pour gravir les échelons du système capitaliste.
Alors même que le néolibéralisme consolidait son emprise, une partie de la gauche a égaré ses repères. Plutôt que de prolonger l’élan de Québec 2001 et de s’opposer frontalement à la mondialisation des marchés, elle a détourné ses énergies vers des luttes identitaires fragmentées, de plus en plus déconnectées des rapports de force économiques et des conditions matérielles des classes populaires. Engluée dans des affrontements symboliques sans prise réelle sur les structures concrètes du pouvoir, elle a abandonné ses fondements politiques historiques au profit d’une posture morale individualisée.
Indépendance des États, universalisme républicain, laïcité, égalité réelle des citoyens face à la loi, droits des travailleurs, démocratie participative et souveraineté populaire : autant de principes fondamentaux autrefois portés par la gauche au nom de l’intérêt général et de l’émancipation collective. Ces idéaux, aujourd’hui, sont systématiquement relégués au second plan — voire disqualifiés — par une nouvelle gauche qui privilégie la reconnaissance différenciée des groupes au nom de l’« équité », et qui place les revendications minoritaires au-dessus de la volonté démocratique majoritaire, jugée suspecte, conservatrice, blanche, raciste ou coloniale. Dans cette logique, toute visée universaliste est perçue comme une oppression en soi. Autant d’étiquettes simplistes et disqualifiantes, qui servent à réduire au silence ceux qui défendent encore l’idée d’un bien commun, et à interdire toute pensée critique sortant du cadre néolibéral imposé.
Pire encore, cette gauche nouvelle génération s’est alignée sur les logiques individualisantes du néolibéralisme en adoptant un moralisme bourgeois mondialisé qui mime la dissidence tout en renforçant le statu quo capitaliste. La critique systémique des inégalités économiques et des rapports de classes s’est effacée au profit de récits victimaires fragmentés, instrumentalisés à des fins médiatiques, identitaires ou carriéristes. Ce n’est plus l’émancipation collective ni la transformation structurelle de la société qui guident leur action, mais une quête narcissique de reconnaissance validée par les mécanismes mêmes du pouvoir qu’ils prétendent combattre.
Après le Sommet, le rapport de force s’est définitivement inversé. Le néolibéralisme ne s’est plus jamais replié. Il s’est imposé partout en Occident comme l’unique horizon pensable. Il a redessiné nos valeurs, reformulé nos intérêts, modifié nos comportements, influencé nos relations et jusqu’à nos désirs les plus intimes. Il s’est immiscé dans notre quotidien, jusque dans nos gestes les plus anodins. Il s’est infiltré à un point tel que nous en avons oublié jusqu’à son nom. Et sans nom, il devient difficile à désigner, donc impossible à combattre. Voilà son plus grand triomphe : s’être tellement normalisé qu’il a disparu de notre conscience collective. Et aujourd’hui, nous en payons le prix.
Nous le payons au Québec par l’effondrement de nos institutions publiques, devenues inefficaces, clientélistes, corrompues. Par la lente érosion de la souveraineté populaire, diluée dans une gouvernance technocratique au service exclusif des marchés. Par le transfert progressif de nos responsabilités collectives vers le secteur privé, comme en témoigne la privatisation rampante d’Hydro-Québec ou l’abandon volontaire de toute régulation du marché locatif, laissant les citoyens ordinaires à la merci des spéculateurs.
Le wokisme, donc, qui prétend aujourd’hui incarner l’avant-garde progressiste, n’est qu’un simulacre de radicalité. En déplaçant le combat vers des micro-conflits identitaires, il détourne l’attention des véritables luttes économiques, sociales et démocratiques. Il offre aux individus un exutoire moral et narcissique qui finit par conforter l’ordre néolibéral en place. Plutôt que d’unir les classes populaires contre leurs véritables oppresseurs économiques et financiers, il divise et affaiblit les forces progressistes en réduisant le progrès social à une simple posture individuelle de pureté morale. Cette dérive, loin d’être anecdotique, constitue une véritable diversion stratégique au service du système capitaliste dominant.

La diversion woke au service du néolibéralisme
Pire encore, au nom d’un progrès supposé, cette gauche contemporaine assimile désormais toute résistance nationale à la mondialisation néolibérale à une dérive fascisante. La volonté populaire de préserver les frontières nationales comme leviers démocratiques d’autonomie économique et culturelle est désormais caricaturée comme une forme de xénophobie dangereuse allant à l’encontre du “progrès” mondial… autrement dit du néolibéralisme. Si ces militants contemporains étaient projetés dans le passé, ils n’hésiteraient pas à qualifier d’extrême droite les militants altermondialistes de mon époque, alors même que nous défendions précisément les frontières nationales comme remparts essentiels face à la domination du marché globalisé et anglo-américain.
Il faut le dire sans détour : la gauche contemporaine a renié ses racines historiques en opérant un virage complet sur plusieurs enjeux fondamentaux. Son silence complaisant face aux dérives néolibérales et ses complicités médiatiques en témoignent. Au Québec, par exemple, elle ne s’émeut même pas lorsqu’une figure comme Léa Stréliski, qui se revendique de gauche, prête son image à une publicité électorale du Parti libéral du Canada pour promouvoir l’élection d’un banquier mondialiste. Ce silence en dit long. Il témoigne d’un déplacement profond : cette gauche ne se conçoit plus comme une force de rupture face à l’ordre dominant, mais agit désormais comme auxiliaire consentante du mondialisme néolibéral. Il suffit désormais qu’une personnalité publique emploie les bons codes du lexique identitaire woke pour être automatiquement rangée du côté du progrès, peu importe les intérêts politiques concrets qu’elle défend. Voilà une contradiction révélatrice, non d’une pensée politique cohérente, mais d’un réflexe conformiste entretenu par des institutions médiatiques… ironiquement au service de la droite économique.

Cliquez sur l’image pour lire mon article : Face à la vague Carney, la « gauche » québécoise choisit de se taire… ou de voter libéral
Et inversement, toute personne qui ose s’opposer à cette gauche en toc, qui remet en question son emprise sur le discours public, se voit presque inévitablement cataloguée comme étant d’extrême droite par des cercles militants ou des médias proches de l’ordre établi. Peu importe son parcours, ses valeurs ou son engagement. Le simple fait d’exercer une pensée critique suffit à vous exclure du prétendu « camp du bien ». Et dans bien des cas, cela mène à une tentative d’effacement public : on vous « cancel », on vous réduit au silence, on vous accuse de briser un consensus moral présenté comme absolu. La diversité d’opinions, pourtant essentielle à toute société démocratique, devient dès lors perçue comme une menace. Penser autrement, c’est trahir. Douter, c’est offenser.
Avec le recul que me donne l’expérience du Sommet des Amériques, et les vingt années de dérives qui ont suivi, je demeure convaincu que les valeurs de la gauche classique méritent d’être réhabilitées d’urgence. Non par nostalgie, mais parce qu’elles portaient une vision cohérente, universaliste et profondément démocratique du progrès social. Ces valeurs cherchaient à rassembler autour d’un intérêt commun, à défendre l’égalité des citoyens devant la loi, à garantir les droits sociaux des classes populaires et à favoriser l’émancipation réelle des peuples par la transformation des structures économiques.
Aujourd’hui, ce projet collectif est mis à mal par une gauche identitaire qui valorise la reconnaissance des minorités au détriment de la volonté populaire. En sacrifiant la notion d’intérêt général à celle de réparation communautaire, elle contribue à fragmenter le lien social. Et ce faisant, elle agit, consciemment ou non, comme une avant-garde radicale du néolibéralisme. Elle mène la charge contre les résistances populaires, détourne les colères, et joue le rôle de bouclier idéologique pour l’ordre établi.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’indépendance du Québec doit être réaffirmée. Non pas comme un simple repli nationaliste, mais surtout comme un projet de souveraineté populaire. Une manière concrète de reprendre collectivement le contrôle sur nos institutions, nos ressources et notre destin.
Pour y parvenir, il faut d’abord avoir le courage de revisiter les carrefours oubliés de notre histoire récente. Ces moments où, l’espace d’un instant, l’avenir semblait s’ouvrir. Où l’engagement collectif portait un véritable projet de société. Le Sommet des Amériques fut de ceux-là : un rappel brutal que la rue peut encore parler, que la jeunesse peut encore rêver, que le peuple peut encore dire non.
Car ce qui s’est joué au Sommet des Amériques dépasse les barricades et les gaz lacrymogènes. Ce fut un instant suspendu, un embrasement fugace où s’est cristallisé l’espoir d’un monde meilleur. Une ligne de fracture. Un seuil invisible. Un dernier élan avant que le rouleau du réel n’écrase nos sociétés.
La suite du monde
Près d’un quart de siècle a passé. Les tambours se sont tus, les banderoles ont été repliées, et mes cassettes VHS sont toujours introuvables. Mais ce que nous avons vécu là-bas, au cœur d’un printemps de gaz et de lumière, palpite encore dans mes veines.
Ce n’est pas un souvenir que j’emporte, mais une fréquence. Une onde de fond. Une vérité souterraine que l’amnésie collective n’a jamais pu faire taire.
Je l’entends encore, ce battement. Il traverse le vacarme du présent. Il échappe aux modes, aux cycles, aux mots d’ordre de l’époque ambiante, qu’ils se réclament du progrès ou du conservatisme. Et je sais que d’autres cœurs vibrent toujours à son rythme.
C’est le souffle d’un autre monde. Un monde à libérer. Un monde à rebâtir, sur les braises encore chaudes de nos abdications.
Car cette onde révolutionnaire, ce chaos fécond qui bouscule les systèmes et fissure les dogmes, vibre toujours. Tapie dans les brumes du temps, elle traverse l’ombre des époques. Elle vibrait déjà dans les rues de Québec, ce printemps 2001, quand des milliers de voix s’élevaient contre la mise en tutelle de nos gouvernements par l’économie de marché mondialisée. Elle grondait sous les pavés, entre nos percussions, les éclats de gaz et les regards brûlants d’un peuple debout.
Elle n’a jamais cessé d’exister.
À nous de savoir l’écouter. De l’amplifier.
De faire de la mémoire un levier.
De transformer la colère en courage.
Et la lucidité en élan.
Le souffle est là.
Il veille. Il gronde.
Et tôt ou tard, il se lèvera de nouveau. Dans un visage, une foule, un refus.
Comme un torrent libéré au printemps, il brisera les digues du renoncement, creusera des brèches dans nos certitudes et dévalera les pentes de nos silences pour rejoindre l’océan vaste et profond de nos aspirations communes.
Car aucune révolte authentique ne meurt.
Elle ressurgit, toujours, irrésistible, portée par les forces vives de la justice, de la mémoire et de la liberté.
Un fleuve souterrain de volonté collective, enraciné dans l’inconscient des peuples, qui refait surface lorsque le monde vacille,
pour rappeler que l’émancipation populaire n’est pas une utopie, mais une tension vivante inscrite dans le mouvement même de l’histoire.

Une bière “La Fin du Monde” levée à la mémoire du souffle révolutionnaire
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande encore. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse
– Albert Camus