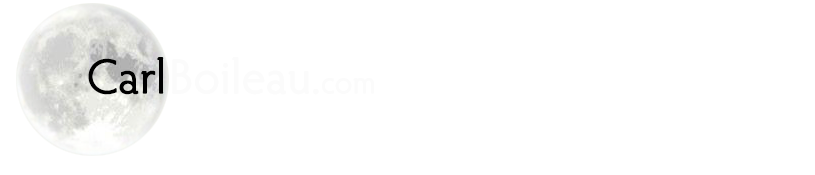Les galériens athéniens et la naissance de la démocratie

Demain soir, j’assisterai à une assemblée du budget participatif dans le Plateau Mont-Royal (district De Lorimier). Ici, vous devez savoir qu’à Montréal, cette activité est, pour l’instant, unique à mon arrondissement. En effet, s’inspirant théoriquement du modèle de Porto Allegre et des vieux rêves du défunt RCM, nous devons cette initiative à la mairesse du Plateau Mont-Royal, Mme Helen Fotopulos (UCIM). Or, si l’exercice est, certes, un pas dans la bonne direction, il en demeure pas moins limité par le ridicule montant alloué à la décision citoyenne. Avant donc de faire une analyse plus approfondie de l’exercice, histoire de me remettre dans le contexte, je vous propose donc ici un vieux travail académique sur les origines de la démocratie. En effet, mes travaux dans le cours Histoire des Grecs contribua à mon extraordinaire note de 94% puis l’obtention de la mention d’honneur en Histoire au gala du Conservatoire Lassalle en 1997.
Les galériens athéniens… ou la naissance de la démocratie
Au Ve siècle av. J.-C., Thémistocle prononça une phrase qui deviendrait une maxime célèbre : « Celui qui est maître de la mer sera, tôt ou tard, maître de l’empire ». Cette assertion, reflet de l’empreinte laissée par Thémistocle, introduit de manière pertinente mon analyse du texte de Jean Rougé, « Les galériens d’Athènes ». Expert en histoire maritime antique, M. Rougé a établi un lien intrinsèque entre le développement de la flotte athénienne et les prémices de la démocratie. Dans ce travail, je m’efforcerai de démontrer, de manière chronologique, comment Athènes, et peut-être l’Occident, doit l’émergence de sa démocratie à une dynamique mettant en exergue le rôle des simples galériens et des individus moins fortunés.
Selon Rougé, aucun peuple n’est naturellement enclin à la navigation maritime ; l’océan, vaste étendue d’eau salée, reste un élément imprévisible et hostile. Les premiers Grecs, originaires des steppes du Caucase, devinrent marins et commerçants par nécessité, apprenant à construire des navires pour braver les vagues et s’aventurer au-delà de la mer Noire. En échangeant huiles et vins contre le blé indispensable à leurs cités naissantes, ils étendirent leur influence commerciale sur toute la Méditerranée orientale, établissant ainsi un réseau de communication maritime dans un pays fragmenté par son relief. Cette expansion maritime attira inévitablement la convoitise des Perses.
Pendant la première guerre médique contre les Perses à Marathon en 490 av. J.-C., les flottes grecques ne jouèrent aucun rôle significatif. Cependant, Thémistocle, préoccupé par la défense maritime d’Athènes, saisit l’opportunité offerte par la découverte de minerais argentifères dans les mines du Laurion. Il proposa d’utiliser ces ressources pour construire une puissante flotte et aménager le port du Pirée. Triomphant dans ses projets politiques et éliminant ses rivaux, tels qu’Aristide, Thémistocle chargea les cent citoyens les plus riches de construire chacun un trirème, dotant Athènes d’une puissance navale sans précédent.

La trière, ou trirème, fut le premier bateau de l’histoire désigné pour la guerre. Stable que par calme plat, il ne devait jamais s’aventurer longtemps loin des côtes, car l’orage pouvait lui être fatal. Probablement inventée en Phénicie, la trière était longue, étroite, et peu élevée sur l’eau. La trière se propulsait grâce à une grand-voile carrée, mais au combat, ou par temps défavorable, elle se muait par la force de ses 170 rameurs. Avec son éperon de bronze, ce type de bâtiment était l’arme navale par excellence.
La victoire décisive de Salamine lors de la seconde guerre médique solidifia la puissance maritime d’Athènes. La cité poursuivit une politique antiperse et forma la ligue de Délos avec les cités insulaires et celles d’Asie Mineure, établissant ainsi un empire athénien dominant l’Égée. C’est à ses vaisseaux qu’Athènes doit son empire et, par extension, l’avènement d’un régime démocratique. Rougé souligne que la démocratie ne s’est pas instaurée immédiatement après les guerres médiques, mais plutôt à la suite de luttes politiques intenses.
La nécessité de pourvoir la flotte de trois cents trirèmes, mobilisant environ 51 000 hommes, a conduit au recrutement des équipages parmi les citoyens athéniens, en particulier parmi les plus pauvres. Ces derniers, en assurant un service naval ardu, méritaient désormais une voix dans les affaires de la cité. Ainsi, les fonctions politiques s’ouvrirent progressivement aux classes moins aisées.

Pour les cités états de la Grèce classique, comme Athènes, et pour la république romaine à ses débuts, la démocratie signifiait d’abord indépendance vis-à-vis de l’extérieur, condition de la libre expression des citoyens de la cité. Ces états pratiquaient la démocratie directe : tous les citoyens pouvaient prendre la parole et voter à l’agora, l’assemblée de la cité. Cependant, la démocratie antique ne reposait pas sur l’égalité de tous les hommes. Les esclaves, les «métèques», et les femmes, exclus de la citoyenneté, n’avaient aucun droit politique.
Cependant, cette démocratie exigeait des ressources financières pour indemniser les citoyens pauvres engagés dans le service de l’État. La triérarchie imposait aux plus riches de s’occuper chacun d’une trirème, couvrant les salaires des marins et les dépenses en campagne, ce qui leur conférait un commandement nominal sur le navire.
En conclusion, Jean Rougé affirme que les riches acceptaient volontiers les lourds sacrifices de la triérarchie, reconnaissant son importance dans la cohérence du système. La flotte, instrument de puissance, permettait de maintenir l’empire, essentiel au financement de la démocratie, qui, à son tour, reconnaissait le rôle militaire crucial de la flotte.
En résumé, l’histoire nous enseigne que l’union économique et la redistribution sociale au sein d’une société ne s’opèrent que face à des menaces communes. Dans cette attente d’un changement, je vous laisse méditer sur cette citation d’Homère, extraite de l’Odyssée :
Il n’est rien de plus terrible que la mer pour dompter un homme
-Homère