La Guerre du Péloponnèse : Une Étude Historique et Politique
Bon, tant qu’à vous refiler un vieux texte sur l’Antiquité… pourquoi pas vous en donner un autre issu de la même époque. D’autre part, ayant vu le film 300 en juillet dernier, je tiens par ce texte à remettre en perspective la réelle nature de l’armée spartiate.
En effet, en glorifiant au possible la phalange spartiate, le réalisateur Zack Snyder a totalement éclipsé la contribution athénienne à notre civilisation dans son film. Si bien que je trouve quelque part inquiétant cette mystification contemporaine du régime oligarchique spartiate, alors en opposition face à la démocratie Athénienne.
Je le rappelle, Sparte mettait l’ensemble de ses ressources dans le développement militaire, et surtout, méprisait le débordement culturel (qu’elle jugeait inutile) de sa rivale. Pourtant, Athènes n’en était pas pour autant démunie militairement. Formellement, onze ans plus tôt à la bataille de Marathon, ce furent les hoplites athéniens qui refoulèrent l’envahisseur perse. Ensuite, à la bataille de Salamine (justement quelques jours après la fameuse bataille des Thermopyles évoquée dans le film 300), ce fut l’expertise navale athénienne qui contribua au retrait décisif de l’armada perse. Alors, avant d’idolâtrer les héros spartiates, il faudrait au moins comprendre qu’Athènes avait une armée à peine moins redoutable… malgré ses choix de société favorisant la démocratie et la culture. Si bien qu’en considérant Sparte pour ce qu’elle était (c’est à dire une oligarchie plutôt qu’une démocratie) il est ironique de constater que le thème central de 300 est l’opposition entre le monde « libre » représenté par les spartiates d’un côté et le monde esclavagistes perse de l’autre… d’autant plus que c’est Sparte, qui finalement, aura anéanti la démocratie athénienne.

La belle image parfaite des héros spartiates selon Zack Snyder
la bande-annonce de 300 ici
La Guerre du Péloponnèse : Une Étude Historique et Politique
Thucydide, un tacticien peut-être incompétent mais historien exemplaire, a profondément marqué l’histographie avec son œuvre « La Guerre du Péloponnèse ». Il est à l’origine d’une perspective historique objective, une première dans le récit d’événements contemporains. En définissant les causes profondes du conflit et en évaluant son impact sur les protagonistes, ce stratège exilé a enrichi la discipline historique, contribuant significativement à notre compréhension de la Grèce classique.
Dans cette étude, j’aborde le texte de Claude Mossé, éminente professeure à l’Université de Paris. Son travail révèle comment cette guerre, longue de vingt-sept ans, a signalé le déclin de l’âge d’or athénien et la fin de sa démocratie. Je m’attacherai à détailler les circonstances qui ont mené les belligérants à entamer le conflit et les changements profonds qu’il a entraînés.
La question fondamentale demeure : qu’est-ce qui pousse des nations à la guerre, à l’extermination mutuelle ? La Guerre du Péloponnèse offre-t-elle un modèle pour comprendre les conflits contemporains ? En remontant aux origines de cette guerre en -431, sous Périclès, nous voyons Athènes, rivalisant avec Sparte, l’autre grande puissance grecque. Les ambitions territoriales et la compétition pour l’influence ont déstabilisé l’équilibre régional. Des entités mineures exploitant ces frictions ont exacerbé les tensions, culminant dans l’incident de Potidée, qui a allumé la mèche du conflit.

Sparte, poussée par ses alliés corinthiens, se trouva contrainte d’initier les hostilités. Ce conflit, dès lors, prit l’allure d’un duel entre Athènes et ses alliés contre Sparte et les siens. Les deux camps luttaient pour rallier les indécis, entraînant ainsi l’ensemble de la Méditerranée hellénique dans une spirale de violence. Cette guerre fut également marquée par une opposition idéologique : la démocratie athénienne face à l’oligarchie spartiate.
Athènes, cité maritime et ouverte, contrastait avec Sparte, repliée et isolée. Malgré son statut de centre intellectuel, Athènes exerçait un contrôle autoritaire sur ses alliés, établissant des normes monétaires et judiciaires strictes. Cette domination rigide, loin de renforcer Athènes, a contribué à son isolement et a affaibli sa position face à Sparte, perçue comme le champion de l’autonomie des cités.
Les troubles internes, exacerbés par une épidémie de peste qui emporta Périclès en -429, ont mené à la chute d’Athènes et à sa soumission temporaire sous la tyrannie de Sparte. Malgré le rétablissement ultérieur de la démocratie, Athènes ne put jamais récupérer complètement. La guerre a irrémédiablement affaibli ses institutions politiques et précipité son déclin.
Selon Claude Mossé, la question demeure de savoir pourquoi Athènes, avec ses ressources considérables, s’est trouvée entraînée dans un désastre si complet. Le conflit a bouleversé le paysage politique grec, préparant le terrain pour l’émergence d’Alexandre le Grand.
Voir ici la bande-annonce du film Alexander
Certains diront que l’histoire est écrite pour raconter et non pas pour prouver. Mais c’est de faire preuve d’intelligence et d’adaptation que d’apprendre de ses fautes et de tirer profit de l’expérience de l’histoire. Pour ma part, je souscris à l’idée que l’histoire est une philosophie enseignée par l’exemple, et par ce fait, nous nous devons de discerner sons sens pour ne jamais oublier la trace de nos prédécesseurs qui ont façonné le monde que nous connaissons aujourd’hui.
La faction Spartiate, vue par Sid Meier dans le jeu vidéo Alpha Centauri
L’histoire, selon Thucydide, se répète inlassablement. Ce constat nous amène à réfléchir sur notre capacité à apprendre du passé. L’histoire, vue comme une philosophie enseignée par l’exemple, nous incite à tirer des leçons de nos prédécesseurs pour façonner un avenir.
Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur –Winston Churchill
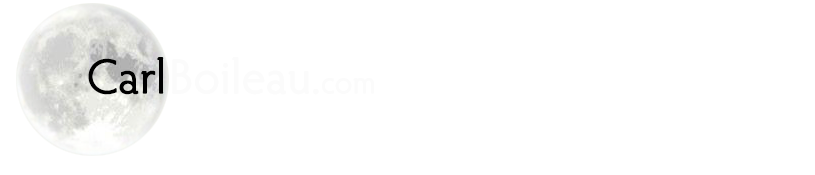




























Très bon article ! 🙂 J’ai beaucoup aimé, même au sujet de la première partie il y a, à mon avis, quelques éléments à nuancer! On ne peut négliger la puissance athénienne au Ve siècle, ni l’importance de sa participation dans les guerres médiques, cependant je pense que ce que veux nous montrer réellement Zack Snyder, ce n’est pas tellement la perfection de la société spartiate. Je pense que le réalisateur veux retranscrire la beauté du sacrifice réel et conscient du roi Léonidas et de ses 300 soldats. Rappelons que ce répit accorder par Léonidas aux Grecs, leurs a permit de se regrouper et de se préparer pour Salamine. En outre, cette bataille ne fut pas uniquement athénienne et beaucoup s’accordent à donner le prix du courage aux Eginettes!
Concernant le « monde libre » il faut reconnaitre que Sparte était loin de pouvoir le représenter, compte tenu de son régime oligarchique et du sort réservé aux Hilotes!
Bonne continuation 😉
Amicalement, Vik.